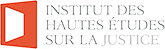Les figures du terrorisme et la démocratie libérale – intervention au séminaire de IHEJ, le 27.02.2017
Bertrand Mazabraud
« Séide : Je crois entendre Dieu ; tu parles, j’obéis.
Mahomet : Obéissez, frappez. Teint du sang d’un impie, méritez par sa mort une éternelle vie.
Séide : Ange de Mahomet, ange exterminateur, mets ta férocité dans mon cœur. »
(Voltaire, Le fanatisme ou Mahomet le Prophète)
Dans la tragédie de Voltaire, Mahomet demande à Séide de tuer Zophire, gardien de la Mecque qui rejette le Coran. Séide, tout comme sa sœur-épouse Palmire, étaient les enfants enlevés de Zophire, ce que n’ignorait pas Mahomet. Or, ce dernier cherche par incitation au parricide à éliminer Séide pour récupérer Palmire comme nouvelle épouse. Dès lors, Mahomet de Voltaire, s’il est un profanateur, violant les interdits de l’inceste et du parricide, est davantage encore un manipulateur. Comme l’énonce Dominique Colas : « Pour Voltaire, toute tragédie est une manipulation délibérée. Mais le message est clair : le fanatisme viole les liens les plus sacrés, il étouffe la voix du sang et ses sectateurs ne reculent devant aucune abomination. »[1]
Très tôt, dans la philosophie occidentale, l’islam a été associé au fanatisme. Cependant, lorsque Voltaire écrivait Mahomet, il usait d’un procédé rhétorique courant, prenant « ailleurs » un point de de vue pour mieux dévisager et critiquer ses contemporains. A travers Mahomet, ce n’est pas tant l’Islam que toute attitude religieuse dogmatique qui est visée, catholique, protestante aussi bien. Pourtant, aujourd’hui, le djihadiste n’est plus un personnage de théâtre, d’un ailleurs exotique, dévoilant littérairement nos propres dévoiements, mais des personnes, en chair et en os, qui font surgir la violence dans les démocraties libérales – démocraties, dont la mythologie repose peut-être sur l’oubli du fanatique, l’insensé, le terroriste.
Comme le suggère Jacques Derrida[2], il faut se méfier du terme « terrorisme », terme piégé, qui permettrait de rejeter les prétentions adverses, sans plus d’examen au fond. Peut-être faut-il suspendre les « vêtements d’idée » que recouvrent les qualifications juridiques (notamment les articles 421, 422 du Code pénal, 706-16 et suivants du code de procédure pénale), et ne retenir, par prudence, que la dimension pragmatique du terrorisme, celui d’un usage tactique de guerre irrégulière[3], ainsi que l’origine du terme : la Terreur pendant la Révolution française. Cela permet, par interpolation ou lecture rétrospective/prospective, de repenser des actions historiques comme terroristes : les Assassins de Hassan el. Sabbat (Le Vieux de la Montagne) ou les Zélotes au temps de l’occupation romaine, etc. Une définition générale apparaît : l’usage de la violence indiscriminée ayant pour objectif d’inspirer la peur à une population et d’en retirer des bénéfices politiques. Autant dire avec Jacques Semelin : « une action terroriste est celle qui vise à tuer n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. »[4] La dimension indiscriminée fait écho à l’anonymat des victimes et des bourreaux et, en ce sens, elle ferait système avec la démocratie libérale[5].
Ces terroristes avec figure absente peuvent cependant – avec la prudence requise – être envisagés quelque peu au regard de leurs motivations idéal-typiques. Au lieu de réduire le terrorisme, il conviendrait de l’entendre autrement, en faire varier les foyers de sens, et selon l’adage ricoeurien « expliquer plus pour le comprendre mieux ». La philosophie herméneutique sera donc requise pour avancer dans la symbolique de l’action terroriste, afin, sans exhaustivité, de chercher les structurations de l’imaginaire terroriste, et de cerner davantage le djihadisme actuel (I).
A l’aune des « foyers de sens » du terrorisme, des corrélations seront susceptibles d’être décelées avec ceux de la démocratie libérale contemporaine, ceci étant entendue que les déclarations idéologiques des djihadistes visent précisément celle-ci comme ennemi. Cela invitera à penser que les réponses au djihadisme ne passeront pas, ou pas uniquement, par un mélange de coercition et de pédagogie, c’est-à-dire de recodage des comportements et des esprits, mais bien par un questionnement sur la démocratie elle-même, dans sa capacité à prendre des décisions, tout en étant à l’écoute de ses citoyens (II).
- Les symboliques de l’action terroriste.
D’emblée, divers termes sont associés à celui de terrorisme. Ils peuvent être regroupés, bien que de manière non exhaustive, de façon cohérente. Un premier groupe recouvre la série : martyr, sacrifice, guerre sainte, pureté, apocalypse. Un second groupe, la série : rebelle, résistant, partisan. Un troisième groupe, la série : fanatique, illuminé, fou, intolérant, intransigeant, sectaire, radicalisé, embrigadé. Ces divers termes participent de la structuration des imaginaires de l’action terroriste, disons de leurs idéologies. Ils en déterminent les motivations/justifications d’action. Cependant, ces divers pôles ou foyers ne saturent pas l’imaginaire de l’action terroriste, ils peuvent se combiner mais pas nécessairement, et d’autres demeurent à penser de façon complémentaire. Ainsi, un résistant peut être fanatique ou non, chercher le martyr ou non, etc. Le couplage des foyers de sens dessine autant de figures du terrorisme, éclairant par variation le concept actuel de « djihadisme ».
- Le guerrier saint et le martyr.
Ce premier « foyer de sens » de l’imaginaire terroriste est presque une perversion de la réduction transcendantale des trois termes de la corrélation : ego, alter ego, monde. Par le martyr, le moi, en quête de pureté, paradoxalement se dissout mais contresigne son moi imaginaire. Par l’excommunication, l’autre est rejeté dans l’impur, ce qui justifie sa mort violente. Par l’apocalypse, le présent du monde est subordonné à la présence d’un temps et d’un ordre supérieur, justifiant le rejet des médiations existantes.
La corrélation entre le guerrier saint et le martyr se retrouve communément, que ce soit dans les traditions chrétiennes, même sécularisées, ou musulmanes[6]. Elle lie une justification d’élimination de l’autre identifié au mal et la purification de soi. Si la culture ou la religion peuvent donner des contenus spécifiques à cette logique, il n’en demeure pas moins, à suivre Jacques Semelin, que certains invariants de l’imaginaire mortifère peuvent être dégagés[7], tenant à l’identité, la pureté, et la sécurité.
D’abord, la dimension identitaire est liée au marquage des différences, de sorte que l’autre, si semblable, doit être posé comme absolument différent – au sens étymologique de séparé, détaché[8]. Cette dimension identitaire, qui essentialise les différences, au point d’instituer des incommensurabilités, permet aussi d’assurer la répétition du modèle essentialisé – puisqu’il ne saurait y avoir de répétition que là où il y a substance[9]. D’un côté, les élus – avec leurs signes – de l’autre les damnés – avec leurs signes. Peu importe dès lors que le modèle imaginaire, le mythe, soit prospectif (l’Homme nouveau[10]) ou rétrospectif (le Califat[11]), c’est lui qu’il faut reproduire à la lettre.
Ensuite, à la dimension identitaire s’associe le motif de la pureté. « La volonté identitaire, qui se construit sur le rejet d’un Autre « différent » exprime au fond ce désir régressif d’une unité parfaite (…) Le désir fusionnel de l’Un avec l’Un ou du Soi avec Soi interdit toute velléité de discussion et de compromis »[12]. La pureté/impureté vient donc redoubler l’identité/différence, d’une part, en accentuant l’essentialisation et, d’autre part, en visant les autres comme ennemis. Cela permet aussi l’inférence de la catégorisation descriptive : « nous »/ « eux » à celle déontique de l’agir purificateur : « nous contre eux ». A ce point, très souvent, l’ennemi désigné est exclu de l’humanité, ce qui facilite la lever de l’interdit du meurtre.
Cette exclusion de l’autre peut aisément recourir aux contenus dogmatiques des religions, celles-ci supposant la relation entre le croyant, la communauté et sa symbolique[13], de sorte que dans leurs aspects de clôture – et malgré leurs aspects d’ouverture – elles favorisent un imaginaire de pureté passant par le rejet de l’hérétique.
Enfin, à la dimension pureté/impureté s’ajoute la peur de l’autre – peur que ce dernier contamine ou nuise la communauté authentique. Si, comme il est désormais banal de le noter, les terroristes n’ont pas de profils psychopathes ou sociopathes types[14], en revanche l’idéologie à laquelle ils adhèrent de façon inconditionnelle présente une structure paranoïaque type : « méfiance, psychorigidité (incapacité à remettre en cause son système de valeur), hypertrophie du Moi (mégalomanie), fausseté du jugement. Les idées sont orientée par une idée a priori. Le raisonnement en apparence hyper-rationnel est en réalité hyper-affectif. »[15]
Dès lors, lorsque l’imaginaire de haine est portée à ses plus fortes tensions, la résolution de celles-ci nécessite le passage à l’acte meurtrier. Or c’est en ce point que la corrélation entre exclusion-élimination de l’autre et le martyr se manifeste. L’acte du combattant, qui peut aller au martyr, pourra s’inscrire dans sa communauté d’interprétation affidée, la renforcer et la validité. Le groupe est à chaque fois refondé. Il se monumentalise, par l’élimination de ses ennemis ; il se certifie par la réception de ses martyrs élus. A ce stade la religion est une réserve herméneutique principale pour réinterpréter et justifier les actes commis au nom et pour le compte du groupe : puisque l’autre était le Mal, alors l’éliminer était un devoir.
Il convient d’ajouter à cette polarisation, celle d’un monde présent dévalué, à l’aune d’un imaginaire apocalyptique. Comme l’a montré N. COHN, avec l’eschaton, si le temps qui vient, de façon imminente est le dernier, alors il justifie le rejet des médiations avec les institutions existantes, les compromis, pour être du côté des élus contre les damnés[16]. L’action terroriste se place sous le temps de l’urgence contre un présent à détruire, soit pour restaurer un passé glorieux, soit au nom d’une utopie future[17]. Plus encore, cet imaginaire apocalyptique renforce les deux autres pôles : moi/autre, en clivant les élus (avant-garde)/damnés.
Le martyr, qui désigne en grec le témoin, se charge en contexte religieux d’être un « témoin de l’idéal ». La psychanalyse peut même y déceler une modalité du travail du deuil, transformant et intériorisant le défunt en objet idéalisé[18]. Il faudrait ajouter alors que le martyr s’inscrit dans une chaine de transmission de témoignages de l’idéal, et que puisqu’il s’agit de témoigner d’un objet idéal, rendre visible celui-ci ne peut passer que par des exhibitions, des objectivations mystiques et artistiques. Dès lors aussi, les comportements extrêmes ne sont acceptables que grâce à une communauté de vie et d’interprétation : seule elle donne sens, réinscrit l’acte du fidèle dans une tradition, et en recueille les bénéfices symboliques. Le martyr a pour la communauté religieuse une fonction essentielle : il est l’assure de sa vérité : « La foi légitime le martyr qui légitime la foi. Seulement, cette preuve ne s’adresse pas au jugement, au bon sens ou à la raison, mais à la vue. Le martyr est la preuve vivante – et surtout visible – de l’existence de Dieu. »[19]
Considérant spécifiquement le martyr dans l’islam, le Shahid, que les djihadistes revendiquent lors de leurs opérations terroristes, il ne prend sa charge polémique qu’aux croisements des ressources herméneutiques traditionnelles et de la rhétorique des mouvements djihadistes.
Le mot « shahid » signifie, comme le mot martyr, le témoin. Il contient les lettres radicales sh. h. d qui renvoient à la notion de « présence », de « savoir » et d’acte d’informer[20]. Si le shahid bénéfice au paradis de nombreux délices, il ne voit pas Dieu, ne participe pas à la vie de Dieu, à la différence du martyr chrétien. Cependant, par le shahid, il va vers Dieu, pour être certifié par Lui, il se rend évident à Dieu et à ses anges. Dans cette optique, le shahid peut porter témoignage par le djihad armé, lorsque dans un combat il est tué par l’adversaire de Dieu. Cependant, il est une clause restrictive : le suicide est interdit. Pour faire tomber cette clause, la rhétorique djihadiste combine trois facteurs.
D’abord, tactique : la récupération par l’islam sunnite (Hamas, Djihad islamique, puis Al-Qaïda et l’Etat islamique) des opérations suicides développées par les Bassidji iraniens puis le Hezbollah libanais (l’islam chiite)[21].
Ensuite, une justification textuelle, qui outre l’argument de la nécessité, du mode d’action désespéré ou de la légitime défense, s’appuyait notamment sur la sourate La Génisse énonçant : « Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts. Ils sont vivants », de sorte que celui qui se suicide ne suicide pas vraiment puisqu’il est toujours en vie, ne passe pas même par la mort, pour se rendre présent au regard de Dieu.
Enfin, et cela rejoint les considérations précédentes sur le lien entre martyr et purification, l’imaginaire djihadiste lie shahid, djihad et takfir et discours apocalyptique. Cette notion de takfir recouvre l’excommunication et l’hérésie. Elle dénonce l’autre comme apostat (ridday) ou mécréant. Bref la mise en dehors de la religion authentique. Elle fut exploitée par la secte de Kharijites au VIIe siècle et reprise par les djihadistes contemporains, reprenant un hadith du Prophète selon lequel le sang ne pourrait être versé que comme châtiment du meurtre, de l’infidélité conjugale ou d’apostasie[22]. La communauté djihadiste – en tant qu’unique communauté authentique et pure – se considère seule apte à décider qui est apostat et donc légitime de tuer.
Dès lors, l’aspiration de la mort au combat est considérée comme la meilleure façon de quitter la vie – d’autant que ce n’est pas vraiment la quitter, mais la purifier devant Dieu, et acquérir le statut de héros au sein de la communauté de vie et d’interprétation djihadiste, relayée par les médias. Le terroriste, dans cette occurrence de guerrier saint-martyr trouve une singularité dans la mort, au regard de Dieu et au regard de la communauté. Il s’agit désormais d’un processus paradoxal d’individualisation et de dissolution dans le groupe – d’où aussi la réceptivité des adolescents à ces doctrines dites radicales : son nom et son prénom qu’il choisit lui-même (kunya) mais qui le rattache à sa communauté élective, les enregistrements audio-visuels et les déclarations des affidés lui assurent une mémoire magnifiée. Et tout de suite, une première question de confiance : pour quelles raisons les processus d’individualisation des démocraties libérales sont court-circuités ?
- Le résistant, le rebelle, le partisan.
Les terroristes justifient souvent leurs actions par un discours de révolte ou de résistance à un ordre qu’ils estiment injuste. Ils se font les porte-voix d’opprimés, enrôlés sous leurs bannières. Sous cette acception, s’ils ne sont pas nécessairement des martyres/guerriers saints ou encore des fanatiques, ils peuvent s’associer à ces figures, selon leurs engagements existentiels et l’imaginaire politique auquel ils adhèrent.
Le rebelle, c’est celui qui se retourne contre l’ordre établi pour le contester, c’est la figure du révolutionnaire. Le résistant, c’est celui qui lutte contre un ordre qu’on tente de lui imposer ou qu’on lui a imposé. Le rapport à l’ordre à restaurer ou à inventer commande la différence, et l’un tire sa légitimité d’une validité de l’ordre futur, quand l’autre tire sa légitimité de la validité de l’ordre passé.
La légitimité de la résistance/rébellion a nourri la philosophique politique occidentale dans le cadre des guerres de religions. Il suffit de rappeler à cet égard la célèbre position de Luther contre les paysans insurgés et anabaptistes qui entendaient créer le Royaume de Dieu et réaliser immédiatement le message biblique dans tous ses aspects politiques, sociaux, religieux (communauté des biens et polygamie)[23]. Luther exhortait ainsi les Princes dans Contre les bandes pillardes et meurtrières de paysans (1525 : « C’est pourquoi, chers seigneurs, délivrez, sauvez, secourez, ayez miséricorde de ces pauvres gens (qui sont menacés par les paysans).Poignardez, pourfendez et égorgez à qui mieux mieux. Si vous y trouvez la mort, tant mieux, tant mieux pour vous : jamais vous ne pourrez rencontrer mort qui fasse mieux votre salut (…) Si tout cela paraît trop dur à quelqu’un, qu’il songe que la rébellion est chose intolérable, et qu’à tout moment, il faut s’attendre à la destruction du monde. »[24]
Sur fond de controverses textuelles, le droit de se rebeller était ou non légitimé. Par exemple, les arguments de légitimations étaient : certes le Souverain a une autorité qui vient de Dieu, selon la formule de Saint Paul (Romain, 13,1). Cependant, qu’était-il si le Souverain n’était qu’un « usurpateur », cela étant impliqué qu’un tyran était nécessairement un usurpateur ? Ou encore, avec les monarchomaques protestants germa l’idée d’un droit d’insoumission partielle délégué aux magistrats et états généraux[25].
Contre de tels arguments, Hobbes posa le rebelle comme « ennemi », celui-ci sortant du pacte constitutif de l’Etat. En menaçant la paix, il perd le statut de sujet et se retrouve face au souverain dans un rapport d’état de nature, donc de lutte à mort. En tant qu’ennemi, il est légitime de l’éliminer : « Pour les sujets qui, délibérément, nient l’autorité de l’Etat établi, il est licite d’étendre la guerre également jusqu’à eux (…) Il en est ainsi parce que la nature du délit consiste à avoir renoncé à la sujétion, ce qui est un retour à l’état de guerre, couramment appelé rébellion. Or ceux qui commettent ce délit ont à souffrir non comme sujets, mais comme ennemis, car la rébellion n’est que le recommencement de la guerre. »[26] Le rebelle est un insensé, qui ne fait pas un calcul d’intérêt sur le long terme et se contredit lui-même[27]. Il reste que Hobbes légitime le « droit de résistance »[28], celui-ci étant une occurrence du droit de nature, lié à la conservation de la vie[29]. Cependant, la résistance risque s’avérer vaine au regard du différentiel de puissances qui s’établit entre le Souverain et le sujet, différentiel que le pacte a pour objet d’instituer.
Kant, qui pouvait s’enthousiasmer pour l’événement de la Révolution française en ce que celle-ci était le signe historique des dispositions morales de l’humanité, condamnait en revanche dans son principe la rébellion, toujours illégitime, en ce qu’elle ouvrait à un retour à « l’état de nature », c’est-à-dire, un état de socialité provisoire où aucun référent public n’étant fixé le conflit serait permanent. A cet égard le §42 de la Doctrine du droit[30] fait de la sortie de l’état de nature pour un état public, où les règles sont publiées et opposables à tous, un impératif catégorique. Seule la voie de la réforme par conseils au souverain est légitime, une réforme par l’exercice de l’opinion éclairée et critique.
Bref, les termes de l’équation sont les suivants : pour justifier la rébellion/résistance, il faut contester la légitimer de l’ordre établi – il s’agit d’une usurpation, d’une falsification, ou encore un autre ordre est davantage légitime. Inversement, pour contester la rébellion/résistance, il convient de de le qualifier d’ennemi, sapant les conditions de possibilité de vie en commun.
Dans cette équation classique, où le terroriste peut se parer des vertus du rebelle ou du résistant, C. Schmitt a apporté dans Théorie du partisan des ressources complémentaires pour en penser les enjeux actuels. Le partisan désigne d’abord le combattant irrégulier, avec un intense engagement politique, mobile dans sa tactique de guerre, usant d’escarmouche et de guérilla[31]. Mais surtout, C. Schmitt opère une distinction entre partisan tellurique, défendant l’existence d’un peuple, et partisan absolu, se battant pour une Idée, sans lieu assignable. Or, avec ce déplacement, précise Schmitt, le conflit n’aurait de cesse que par l’extermination de l’ennemi, considéré comme ennemi du genre humain. La transformation du cadre est la suivante : « Si la lutte comporte une criminalisation de l’adversaire dans sa totalité (…) la force explosive révolutionnaire de cette criminalisation de l’ennemi a pour effet de faire du partisan le véritable héros de la guerre. Il est celui qui exécute l’arrêt de mort prononcé contre le criminel, et il risque de son côté d’être traité comme un criminel ou comme un élément nuisible. »[32]
A cet égard, il est notable que les palinodies au sein des mouvances djihadistes actuelles s’articulent précisément sur cette distinction « tellurique/absolu ». Tandis que Al-Qaida pouvait prôner le djihad global, sans lieu assignable, et rechercher à atteindre l’ennemi proche via l’ennemi lointain, en revanche l’organisation Etat islamique a dans un premier temps affirmé sa préoccupation pour un djihad tellurique, puis en position de repli, et selon l’exhortation en 2014 de Al-ADNANI, a prôné le djihad global, cherchant à terrifier l’ennemi où qu’il se trouvât.
- Le fanatique.
La troisième série de termes associés au terroriste (fou, intransigeant, radicalisé, embrigadé, etc.) peut se regroupé autour de la notion de fanatique. L’étymologie de fanatique est déjà riche d’enseignements, selon qu’elle est dérivée de fana (ce qui est la dérivation correcte) : le « temple », et donc est liée au sacré, le fanatique pro-fanant les temples de l’autre, ou selon qu’elle est dérivée de façon polémique de phantasia (imagination, fantaisie) et la relègue dans le domaine du délire, de la folie.
Le fanatique est conçu soit comme extérieure à la raison, c’est une adhésion partisane pathologique ou une irrationalité cléricale (Voltaire[33]), soit il s’agit d’une « passion abstraite, inconditionnelle » intrinsèque à la raison, qui se lie aussi à la politique d’émancipation[34]. A cet égard, Hegel prolonge la démarche kantienne qui débusque dans la raison elle-même, la possibilité du fanatisme. Pire, ce moment se révèle nécessaire, en raison de la négativité inhérente de la volonté. La manière de Hegel de considérer le fanatique offre, d’une part, une compréhension d’une possibilité de la volonté de l’individu moderne, et d’autre part, le déchiffrement dans les représentations religieuses ou politiques des ressorts amenant cette possibilité à l’effectivité.
1) Le fanatisme : liberté du vide et passion de l’abstraction.
Hegel élabore la question du fanatisme dans le domaine de la religion, du droit et de l’histoire. Il consacre à cette question le célèbre chapitre VI de la Phénoménologie de l’Esprit « La liberté absolue et la Terreur », mais peut-être aussi « la Loi du cœur et la présomption ». Il reprend la question dans les §5, §33, §140 et §241 des Principes de philosophie du droit. Le §5 des Principes de philosophie du droit donne le contenu le plus précis du fanatisme comme « liberté du vide ».
« La volonté contient l’élément de la pure indétermination ou de la pure réflexion du moi au-dedans de soi, dans laquelle sont dissous toute restriction, tout contenu immédiatement présent-là (…) l’infinité sans bornes de l’abstraction absolue ou de l’universalité, la pure pensée de soi-même. (…) Quand le premier aspect de la volonté ici déterminé [à savoir] cette possibilité absolue de pouvoir faire abstraction de toute détermination dans laquelle je me trouve ou que j’ai posée en moi, quand la fuite hors de tout contenu, en tant qu’il serait une borne, est ce à quoi la volonté se détermine, ou bien est ce qui, pour soi, est tenu fermement par la représentation de la liberté, c’est la liberté négative ou la liberté d’entendement – c’est la liberté du vide. Celle-ci érigée en figure effective et en passion, et demeurant en l’occurrence simplement théorique, devient dans le domaine religieux le fanatisme de la pure contemplation indienne, mais lorsqu’elle se tourne vers l’effectivité, elle devient, dans le domaine politique comme dans le domaine religieux, le fanatisme de la dévastation de tout ordre social subsistant et l’élimination des individus soupçonnés d’être partisans d’un ordre, de même qu’elle devient l’anéantissement de toute organisation qui veut à nouveau se profiler. C’est seulement lorsqu’elle détruit quelque chose que cette volonté négative a le sentiment de son être-là ; elle est bien d’opinion qu’elle veut un quelconque état positif, par exemple l’état d’égalité universelle ou de vie religieuse universelle, mais en fait elle ne veut pas l’effectivité positive de cet état, car celle-ci occasionne aussitôt un ordre quelconque, une détermination particulière et de la détermination objective que surgit, pour cette liberté négative, la conscience qu’elle a de soi. Ainsi ce qu’elle a l’opinion de vouloir peut déjà pour soi-même n’être qu’une représentation abstraite, et l’effectuation de celle-ci ne peut être que la furie de la destruction. »[35]
Dans ce §5, introductif aux Principes, Hegel rappelle que la volonté humaine est libre car elle est auto-détermination et libre d’elle-même. Elle comporte trois moments : négation, négation de négation, affirmation (infini abstrait, fini, infini concret). Si, les deux premiers sont des abstractions, seul le dernier est concret et effectif[36].
Or, il apparaît une figure inquiétante de la volonté qui consiste à se poser comme volonté de volonté pure, volonté se voulant elle-même en tant que volonté sans objet : elle opère le passage d’une possibilité dans la réalité, celle de s’abstraire de tout et de dénier toute déterminité. C’est ce que Hegel désigne comme liberté négative – liberté du vide. Comme le commente Philippe Soual : « C’est un renversement de la volonté qui ne veut rien en volonté qui veut le rien. »[37]
Le fanatisme ne tient donc pas à une pathologie, mais à une potentialité inhérente à la volonté. Celle-ci, en principe, est possibilité de se déterminer, et de reprendre sur soi cette détermination. Dans le fanatisme, la volonté reste indéterminée, elle se veut elle-même abstraitement. La liberté du vide ne devient fanatique que si elle se tourne vers l’effectivité, pour accomplir sans médiation (particularités, différences) ses idéaux universels. Comme l’énonce Hegel dans la remarque du §5 à propos de la Terreur : « le fanatisme veut quelque chose d’abstrait, il ne veut aucune structuration : là où des différences se mettent en relief, il trouve que cela contrevient à sa propre indéterminité et il les abolit ». Il convient de relever que le fanatisme est une volonté vide, de l’abstraction, qui s’attaque à toutes les différences (qui supposeraient une détermination) pour rester pure volonté.
Cependant, si la liberté du vide peut s’égarer en fanatisme, elle est aussi un moment de la liberté, et elle est liée à la subjectivité morale telle qu’elle apparue avec la modernité. Hegel développe cette dimension aux §140 des Principes de philosophie du droit, dans la Moralität (subjectivité morale – non proprement juridique – mais qui est l’intériorité de la personne juridique, son côté subjectif). Elle correspond au mal radical kantien, comme perversion de l’ordre des maximes d’action, affirmant comme bon ce qui a un contenu négatif.
Puis Hegel resitue cette conscience vide dans le cadre de l’Etat concret au §270 des Principes de philosophie du droit. Le fanatique est alors le croyant qui se pense comme délié de toute loi humaine et posera sa Conscience ou son Intérieur vide, comme source de l’agir et de la justice. Il pourra ainsi condamner « en tant qu’irreligieux » ceux qui voudraient résister à son oppression[38]. Les communautés religieuses ou politiques fanatiques cherchent ainsi à « conférer une objectivité à leur doctrine (conçue par le biais de la représentation) face à l’Etat »[39]. Autrement dit, le fanatique a une haine du droit – de ce qui est légalement déterminé différemment de sa conviction – parce qu’il a une volonté d’indétermination.
- Terreur et Islam : le côté Robespierre de Mahomet dans les Leçons de philosophie de l’histoire.
Pour Hegel, l’Islam est par essence fanatique[40]. Il soutient ainsi : « Tandis qu’en Occident commence à se fixer à demeure dans la contingence, la complexité et la particularité, la direction contraire devait apparaître dans le monde pour intégrer la totalité ; cela arriva dans la Révolution de l’Orient qui brisa toute particularité et toute dépendance, éclairant et purifiant parfaitement l’âme, en faisant de l’Un abstrait seul, l’objet absolu et de même de la pure conscience subjective, de la science de cet Un seul, l’unique fin de la réalité – de l’inconditionné, la condition de l’existence. »[41] Il s’agit de la réaffirmation du principe des religions orientales qui nient toute particularité, cependant avec l’Islam l’Un déstabiliserait toute détermination. L’Islam aurait comme principe une négation continue. C’est ainsi que Hegel poursuit : « L’abstraction dominait les mahométans ; leur but était de faire valoir le culte abstrait ; et ils y ont tendu avec le plus grand enthousiasme. Cet enthousiasme était du fanatisme, c’est-à-dire, l’enthousiasme pour un abstrait, pour une idée abstraite, qui se comporte négativement à l’égard de ce qui existe. Le fanatisme ne consiste essentiellement qu’à se comporter à l’égard du concret en dévastateur et en destructeur (…) Leur principe était la religion et la terreur, comme celui de Robespierre la liberté et la terreur »[42].
Reste que Hegel n’était pas prophète comme l’atteste sa conclusion : « Actuellement l’Islam (…) a disparu depuis longtemps déjà du domaine de l’histoire universelle, et est rentré dans la nonchalance et le calme de l’Orient. »[43]
Le rapprochement de Robespierre et de l’Islam tient au fait que le fanatisme n’est pas seulement volonté d’imposer aux mondes ses croyances particulières, mais est une forme d’universalité. Or la religion islamique et la subjectivité musulmane tendent à l’universel, et se rapprochent en conséquence de la subjectivité morale de l’individu moderne européen[44]. Autrement dit, entre l’individu et l’universel, sans relâche l’individu doit s’effacer : aucune liberté déterminée ne peut résister, ce qui pousserait à une négation conquérante perpétuelle[45].
Les djihadistes correspondent au fanatique décrit pas Hegel. Ils s’arment d’une politique de l’Un (Tawîd) comme principe d’action indifférenciée, abstraite, et donc destructrice de toutes déterminations déjà existantes. Leur posture subjective est un « enthousiasme pour l’abstrait ». Il n’est pas envisageable de transiger avec eux. Reste un renversement remarquable au rapprochement de l’Islam et de la Terreur. En effet, le djihadisme actuel tend non pas à une indétermination, mais sur la base d’un Islam de type salafiste et d’une reconstruction mythologie de la vie des premiers compagnons du Prophète, à imposer un mode de vie extrêmement déterminé. Autrement dit, si l’analyse de « l’enthousiasme pour l’abstrait » est valide, cet enthousiasme ne cherche pas à rester dans le vide.
Il semble qu’à l’émancipation continuelle des démocraties libérales, ils opposent une contre-émancipation, une émancipation de l’émancipation, puisqu’ils cherchent à retourner aux traditions et aux autorités. Dès lors, la question lancinante est « pourquoi ce refus ? » L’idéal d’émancipation doit-il être remis en cause ? Ou n’est-ce pas plutôt qu’il n’a pas opéré pour tous, que les individus isolés, atomisés, non-reconnus, ont été vidés, de sorte qu’ils luttent pour la « détermination », là où il n’y a que du vide. Comme si l’Occident était « fanatique » avec l’imposition d’une « abstraction » celle de « l’individu libre », par-delà toute hétéronomie et traditions.
- Les corrélations entre le terrorisme et la démocratie.
Avant de considérer comment le « terrorisme » est corrélé à la « démocratie libérale », il convient d’abord de cerner les présupposés, les principes, de celle-ci. Si la démocratie et Etat de droit peuvent être compris, sous certaines conditions, comme équivalents, et si la démocratie suppose des institutions spécifiques (élection libre et suffrage universel, séparation des pouvoirs, etc.) elle ne serait se réduire à ces institutions elles-mêmes. Elle repose sur des principes qui structurent son régime, son mode d’être démocratique. Une fois ceux-ci dégagés, les corrélations avec les figures du terrorisme apparaîtront comme autant d’axes de symétrie dans un miroir. Alors, peut-être pourrait commencer la réflexion ?
- Régime d’être et malaise de la démocratie libérale.
En suivant la pensée de Paul Ricœur, Claude Lefort et de Jürgen Habermas, les ressorts structurant la démocratie libérale peuvent être explicités et justifiés. Deux axes principaux seront abordés : le vide de fondement (I) et la séparation de la société civile et de l’Etat (II). La démocratie libérale est le régime politique qui met à son programme le paradoxe politique continué.
1) Le problème du fondement : vide et auto-fondation.
Dans la manière de considérer l’avènement de la « démocratie moderne », Lefort comme Habermas indiquent ces éléments constitutifs. Les deux auteurs considèrent que sous l’Ancien régime, le pouvoir du souverain, incarné dans la personne du Roi, était assujetti à un droit indisponible, parce que sacré, d’origine divine. Ce droit sacré lui assurait sa légitimité. Habermas explique ainsi : « Dans ses traits essentiels, on retrouve, toutefois, la structure connue dans toutes les civilisations développées, à savoir la division en droit sacré et droit profane, le droit sacré étant intégré, du point de vue des grandes religions universelles, à l’ordre cosmique ou à l’ordre d’un processus sotériologique. Ce droit divin ou « naturel » n’est pas à la disposition du souverain politique. Il offre bien plutôt le cadre de légitimation à l’intérieur duquel le souverain exerce sa domination profane à travers les fonctions de la justice et de la législation bureaucratique. »[46].
Or soutient Habermas, avec la modernité, entendue comme sécularisation des sociétés (la religion est conçue comme une croyance privée), l’équilibre du système politique s’est rompu : le droit se serait réduit à sa dimension instrumentale, disponible pour le pouvoir. Par contrecoup, le droit ne peut assurer au pouvoir aucune légitimité. C’est ici, du reste, que s’ancre la critique de C. Schmitt contre le positivisme et la démocratie libérale, tels que pensés par H. Kelsen : l’idée que le droit n’est plus matériel, mais purement formel, fonctionnel et provisoire, n’étant que ce que décide la majorité d’un peuple à un moment[47]. C’est pourquoi, continue Habermas, il a fallu trouver un substitut au « droit sacré », indisponible et légitimant – ce substitut serait « l’éthique de la discussion »[48], ce que ratifierait Ricœur, la démocratie étant pensée comme l’institutionnalisation de la discussion[49].
Lefort ne se sépare pas de cette analyse historique, cependant il considère que les Droits de l’Homme constituent le « droit indisponible » qui offre le cadre de légitimation et qui préside à la dynamique démocratique. Comme il l’énonce : « C’est donc un tout autre mode d’extériorité au pouvoir qui s’instaure, dès lors qu’il n’y a plus de point d’attache du droit. Cette dernière formule peut paraître outrancière. Un nouveau point d’attache est fixé : l’homme. »[50]
De quelle humanité s’agit-il ? Une humanité sans qualité, mais une humanité qui, dans l’acception kantienne, est plurielle et est en capacité de substituer à la nature la culture, c’est-à-dire de se dénaturer, de ne pas rester fixée dans une détermination, autrement dit, d’être libre. Continuons analytiquement, si l’homme est possibilité de « se déterminer », si telle est le sens de sa liberté, alors les déterminations héritées, les rangs sociaux, les ordres d’appartenance ne sauraient être que provisoires et non péremptoires, et comme l’a parfaitement compris Tocqueville, la démocratie moderne repose sur un « principe d’égalisation des conditions ».
Mais il faut ajouter, si l’on suit Lefort que « l’idée de l’homme sans détermination ne se dissocie pas de celle de l’indéterminable. Les droits de l’homme ramènent le droit à un fondement qui, en dépit de sa dénomination, est sans figure, se donne comme intérieur à lui et, en ceci, se dérobe à tout pouvoir qui prétendrait s’en emparer – religieux ou mythique, monarchique ou populaire. Ils sont, en conséquence, en excès sur toute formulation advenue : ce que signifie encore que leur formulation contient l’exigence de leur reformulation. »[51]
A cet homme indéterminable, correspond le peuple indéterminable de la démocratie. Comme le dit encore Lefort : « La légitimité du pouvoir se fonde sur le peuple ; mais à l’image de la souveraineté populaire se joint celle d’un lieu vide, impossible à occuper, tel que ceux qui exercent l’autorité publique ne sauraient prétendre se l’approprier. La démocratie allie ces deux principes apparemment contradictoires : l’un, que le pouvoir émane du peuple ; l’autre : qu’il n’est le pouvoir de personne. Or, elle vit de cette contradiction. Pour peu que celle-ci risque d’être tranchée ou le soit, la voilà près de se défaire ou déjà détruite. »[52]
Si Ricœur émet des réserves égard de la thèse défendue d’une auto-fondation, d’un régime fondé sur rien, rien d’autre que lui-même, il ratifie, d’une part, « le passage par un moment de vide » et d’autre part soutient l’idée d’un « oublié » au fondement du pouvoir, un moment de fondation toujours déjà recouvert, mais qui relève du concert d’actions, d’une puissance de rassemblement[53].
De cela s’ensuit aussi une définition de la démocratie classique, reposant sur l’idée régulatrice d’un Contrat social, formalisé par Kant au §46-47 de la Doctrine du droit, et qu’Habermas énonce de cette manière : « Etat démocratique est un ordre voulu par le peuple lui-même, légitimé par la formation libre de l’opinion et de la volonté de ce même peuple, ordre qui permet aux destinataires du droit de se comprendre en même temps comme ses auteurs »[54].
2) L’Idée de séparation de la société civile et de l’Etat comme base de la démocratie libérale.
Cette seconde idée, est liée à la première : si l’homme est libéré des déterminations traditionnelles, s’il peut exercer les Droits de l’homme négatifs, mais surtout positifs (liberté d’association, de communication et d’expression), alors le pouvoir démocratique suppose la séparation de la société civile et de l’Etat, d’un espace public et d’un domaine privé[55].
Cette distinction société civile/ Etat n’existe pas avant sa conceptualisation par Hegel. En effet, ce dernier, le terme « société civile » était la traduction de l’expression societas civilis elle-même traduction de la koinonia politike pensée par Aristote (Les politiques 1252a), et désignant la communauté politique au sens d’Etat.
Or la distinction société civile/Etat s’appuie sur au moins deux axes. D’une part, les guerres de religions, qui conduisirent les Etats, sous l’idée de tolérance, à reléguer les prétentions religieuses antagonistes dans la sphère privée, et d’autre part, l’économie de marché, comme sphère des intérêts égoïstes antagonistes.
Mais il y a plus. Avec l’Etat moderne – entendu comme post-révolutionnaire – est pris en compte l’individu, avec sa subjectivité morale et l’exercice de la raison pratique. Dès lors, la société civile (bürgerliche Gesellschaft) est conçue avec ses deux piliers : la famille et les corporations (comme régulation du système des besoins et du travail). L’individu est lâché de l’en soi familial, de la substance, il est négation de celle-ci, et se retrouve dans le pour-soi de l’économie et des corporations de métiers. Cette sphère de la société civile n’est donc pas chez Hegel uniquement économique (système des besoins) puisqu’elle est aussi familiale. Mais il reste qu’elle tend à libérer des individus qui cherchent à satisfaire leur désir selon une logique utilitaire. Or, selon Hegel, cette logique conduirait à un état de nature, un conflit de tous contre tous, avec un accroissement des inégalités, si l’Etat, comme sphère publique, n’intervenait pas pour réguler et maintenir l’individu dans l’universel concret. Dès lors, l’Etat de droit se comprend comme la tension dynamique du syllogisme Universel-Particulier-Singulier, où s’articule les trois moments de l’Etat, la société civile et l’individu.
Cette distinction société civile/ Etat est constitutive de la démocratie libérale. D’une part, le principe de laïcité commande que l’unique référent des droits soit l’individu libre de sa religion, et non une quelconque communauté religieuse, et que l’Etat ne saurait aucunement prendre des positions en matière religieuse. D’autre part, elle implique une autonomie de la sphère économique, du libre marché, bien qu’il doive veiller à la régulation de ce marché. Pour le dire encore en des termes hégéliens, si la Cité grecque reposait sur la « particularité », sans l’universel/singulier, la loi publique, du jour, des mâles s’articulant sur la loi familiale, de la nuit, des femmes, celle-ci étant l’inconscient, et celle-là la conscience de la Cité, alors avec l’Etat de droit moderne, l’inconscient est la sphère économique où est libéré la personne comme référent des droits, tandis que la conscience est la politique.
Il n’en demeure pas moins, comme l’a remarqué Ricœur[56], que la sphère économique ne saurait être considérée hors du cadre politique, puisque seul celui-ci la libère et lui garantie une autonomie relative. Penser l’économie sans l’Etat, c’est abstraire d’un tout structurellement agencé un des moments et le poser comme subsistant par soi. Or, avec la mondialisation, cette abstraction a tendance à devenir effective, réelle, et le monde lui-même tend à devenir plus abstrait. Il s’ensuit une limitation de la légitimité de l’Etat mais aussi de la force du droit. Il s’ensuit aussi une abstraction de toutes les traditions, communautés de vie, qui sont en quelque sorte décodées et ramenées à une dimension utilitaire pour des subjectivités vides.
Un corollaire de la séparation société civile/ Etat est que la société au sein de l’Etat est divisée, conflictuelle, en crise perpétuelle. Comme le soutient Ri cœur : « A cet égard il est vain – quand il n’est pas dangereux – d’escompter un consensus qui mettrait fin aux conflits. La démocratie n’est pas un régime politique sans conflits, mais un régime dans lequel les conflits sont ouverts et négociables selon des règles d’arbitrage connues. »[57]
L’unité n’est que latente, elle est à toujours différer – le totalitarisme serait précisément la tendance à dé-différencier la société civile et l’Etat, et imposée trop tôt une Unité rêvée. La société démocratique est à cet égard l’opposé de l’idée de fusion communautaire[58].
- Le terrorisme en miroir de la démocratie libérale.
Une fois dégagés certains des principes structurant le régime d’être de la démocratie libérale, il devient assez clair que le terrorisme, dans son occurrence actuelle de djihadisme, s’attaque précisément à ces principes (1). Mais dès lors aussi que l’on retient que les terroristes placent leurs actions sous une symbolique structurée, les motivations de leurs actions donnent à repenser les fragilités de la démocratie (2).
1) Symétries inversées ou système terrorisme-démocratie.
Les terroristes djihadistes s’attaquent à la démocratie libérale dans chacun de ses principes structurels : l’indétermination radicale du pouvoir, du savoir et de la loi, ou le vide de fondement, le principe de l’institutionnalisation de la discussion, le principe d’autonomie de la personne, et le principe d’égalisation des conditions, le principe de séparation de la société civile et de l’Etat. En ce sens, le terrorisme globalisé, emprunte nécessairement à la logique totalitaire, comme vis-à-vis de la démocratie.
Ce qui est évident en premier lieu, et que les djihadiste partagent avec tous les « fanatiques », c’est le refus des compromis, des négociations, le refus de la logique du principe majoritaire[59]. Les djihadistes invoquent également la charia (Loi de Dieu) comme unique source de droit et de légitimité de l’action, dès lors, ils s’opposent à l’autonomie relative et l’auto-fondation des régimes démocratiques. Ils cherchent donc à déterminer l’origine du Pouvoir, du Savoir et de la Loi, à combler le « vide » des démocraties. Ils s’opposent aussi à l’égalisation des conditions, mais établissent de différences de rôles et de droits selon les hommes, les femmes, les esclaves, les dimi (gens du Livre, « ceux pour lesquels on est responsable, mais qui doivent payer un impôt), les koufar (celui qui est rejeté de Dieu). Ils font primer l’appartenance religieuse sur tout concept de citoyenneté, c’est-à-dire de participation au pouvoir[60]. A cela il faudrait ajouter, une dimension sotériologique forte et imminente, là où la démocratie est la société historique par essence, elle-même décidant de son histoire (le verrum ipsum factum des Modernes).
Enfin, ils refusent la distinction de la société civile et de l’Etat. Comme l’écrit Dominique Colas : « Dès lors que la société civile est le lieu licite de la recherche par chacun de l’utile et du sien, le fanatisme en est la forme antagonique qui mobilise les fidèles d’un Prince qui n’est pas de ce monde, ou qui rassemble les opprimés qui font entendre la prophétie d’une Cité juste. Car la promotion de la société civile comme valeur est aussi bien celle de la tolérance que celle du bourgeois, la promotion de la liberté de pensée que celle du libre marché. Aussi les ennemis de la société civile prennent-ils au moins deux figures qui peuvent se combiner. Le fanatique, qui rejette les médiations et les représentations et veut instaurer sans délai et sans institutions un monde nouveau (…) mais c’est aussi l’anarchiste, iconoclaste, révolté par la bonne conscience des gardiens du temple adorateur d’idoles. »[61]
Par conséquent, le terrorisme et la démocratie ne font pas système : l’une et l’autre ne se définissent pas par leurs positions et leurs rapports. Mais la démocratie est fragile, sa fragilité tient à son paradoxe constitutif. Elle tient à l’individualisme de l’homo oeconomicus et à la fabrique de l’opinion publique par les médias, qui empêchent l’événement et la pensée de s’élaborer par un effet de saturation et de perpétuelle actualité. Elle tient aux ressentiments communautaires fondés sur une exclusion de l’espace social, voire public. Autrement dit, elle tient aux dispositifs qui court-circuite la citoyenneté.
2) « Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images ».
Comme on vient de le voir, le djihadisme est en symétrie inversée avec les principes de la démocratie libérale. Il s’exprime par le terrorisme avec une stratégie bien étayée, en deux temps, visant : 1) à diviser la communauté politique, pour que les musulmans soient rejetés, ce qui les feraient adhérer à l’idéologie djihadiste ; 2) engendrer une répression disproportionnée de l’Etat qui accentuerait la division et le basculement, au point d’entrainer une guerre civile[62].
La démocratie libérale doit donc en tirer des leçons.
D’abord, les théories de l’agir communicationnel, même avec des correctifs de participation de chacun à l’élaboration mais aussi à l’application en contexte des normes, bref le cadre d’une discussion réglée, sur fonds d’argumentation raisonnable et de révisions possibles[63], ne peut oublier qu’il est possible de refuser la discussion, d’être irrationnel et de prôner comme mode d’action politique la violence. Habermas pouvait se demander après le 11 septembre si sa théorie n’était pas caduque[64]. Autrement dit, il convient de prendre en compte l’Insensé, de l’écouter et de le réfuter – la démocratie ne pouvant être uniquement une discussion qu’avec les individus sensés, ou avec une rationalité abstraite.
Ensuite, une autre leçon consisterait à faire réfléchir les médias qui participent constitutivement de la propagande djihadiste, d’une part, en relayant en continue les informations de ceux-ci, et d’autre part, en participant au maintien de l’angoisse dans les populations. Plus encore, le djihadiste comme héros négatif est largement un produit médiatique : s’il cherche à s’individualiser aux yeux de Dieu, il cherche aussi l’enregistrement par la communauté, qui va le fêter, faire son récit, etc.
Enfin, une autre leçon encore consisterait à écouter les motivations des jeunes français, d’horizons divers, souhaitant partir faire le djihad ? N’est-ce pas le signe d’un malaise, d’une démotivation politique dans le libéralisme global ? Pour le dire d’un mot, les principes de la démocratie libérale ne peuvent pas se passer de communautés de vie, religieuse et affective, qui l’animent. A l’inverse, l’individualisme est isolement pour la plupart et épanouissement pour peu. Dès lors, sauf à imposer les principes démocratiques non plus comme cadre politique mais comme principes d’existence – ce qui impliquerait une vie absurde – alors il convient de veiller à un pluralisme ouvert dans l’espace social. C’est peut-être la question de confiance de la société actuelle.
[1] D. COLAS, Le Glaive et le Fléau, éd. Grasset, 1992, p. 89.
[2] J. DERRIDA, « Auto-immunités, suicides réels et symbolique » in Le « concept » du 11 septembre, J. DERRIDA, J. HABERMAS, G. BORRADI, éd. Galilée, 2004, p. 162-163.
[3] G. CHALIAND, Terrorisme et politique, éd. CNRS, 2017, p. 9-10 : « ce qui importe pour définir un mouvement, ce n’est pas sa finalité, qui peut être utopique, mais son mode opératoire » et l’auteur précise que le terrorisme et la guérilla visent « à contrôler non tant un territoire qu’administrativement, les populations »
[4] J. SEMELIN, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, éd. Seuil, 2005, p. 419.
[5] A. GARAPON, « Comment lutter démocratiquement contre le terrorisme ? » in L’Herne Ricœur , 2004, p. 338 et suiv.
[6] Ph. BUC, Guerre sainte, martyre et terreur, éd. Gallimard, 2017, p.454-458.
[7] J. SEMELIN, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, éd. Seuil, 2005, p. 26.
[8] Ibid., p. 46-47 : « Ce qu’ils sont ou ce qu’ils croient être, ils l’essentialisent afin d’en faire la substance même de leur combat. Or la construction de cette communauté du « nous » va s’opérer au prix du rejet d’un « Autre » perçu comme un « eux » foncièrement différent. »
[9] H. BLUMENBERG, La légitimité des Temps modernes, éd. Gallimard, 1999, p. 18 : « Il n’y a de répétitions, de recouvrements et de dissociations, mais aussi de travestissements et de dévoilements que là où la catégorie de substance domine la compréhension de l’histoire ».
[10] Ph. BUC, Guerre sainte, martyre et terreur, op. cit., p. 98, p. 111-112.
[11] N. MOULINE, Le califat. Histoire politique de l’islam, éd. Flammarion, 2016, p. 138-145.
[12] J. SEMELIN, Purifier et détruire, op. cit., p. 52.
[13] J.-L. VEILLARD-BARON, La Religion et la cité, éd. Le félin, 2010, p. 15-16.
[14] Ph. BUC, Guerre sainte, martyre et terreur, op. cit., p. 224.
[15] J. SEMELIN, Purifier et détruire, op. cit., p. 66-67.
[16] N. COHN, Les fanatiques de l’apocalypse. Courants millénaristes révolutionnaires du XIe au XVIe siècle, éd. Aden, 2011 (1957), p. 9-10.
[17] Ph. BUC, Guerre sainte, martyre et terreur, op. cit., p. 109-110.
[18] G. BONNET, « Le martyr, témoin de l’idéal », Topique 4/2010, p. 74 sq.
[19] B. BOURRIT, « Martyrs et reliques en Occident », Revue de l’histoire des religions, 4/2008, p. 455.
[20] A. COURBAN, « Martyr(e) Témoin de vie ou témoin de mort ? », Topique 4/2010, p. 57-71.
[21] G. KEPEL, Terreur et martyr, éd. Flammarion, 2008, p. 89 et suiv.
[22] En ce qui concerne l’apostasie (ridday), selon un hadith (Man baddala dinahou fa’qtoulouhou : celui qui change sa religion tuez-le), les apostats doivent être condamnés à mort. Même s’ils ne sont pas exécutés réellement, ils sont considérés comme « mort civilement », de sorte que leurs successions sont ouvertes, et leurs biens ne peuvent être dévolus qu’à des musulmans (en principe le Trésor public). Cf. A. YAGI, Droit musulman, Publisud, 2004, p. 99 et suiv.
[23] N. COHN, Les fanatiques de l’apocalypse, op. cit., p. 381 et suiv.
[24] D. COLAS, Le Glaive et le Fléau, op. cit., p. 111.
[25] Q. SKINNER, Les fondements de la pensée politique moderne, éd. A. MICHEL, 2009, p. 761 et suiv.
[26] HOBBES, Léviathan, XXVIII, éd. Gallimard 2000, trad. G. MAIRET, p. 472.
[27] S. SPECTOR, Eloge de l’injustice, éd. Seuil, p. 71.
[28] HOBBES, Léviathan, XXVIII, op. cit., p. 463 : « personne n’est censé être contraint par une convention de ne pas résister à la violence ; par conséquent, il ne peut être entendu que j’aie donné à un autre le droit d’exercer des violences sur ma personne. »
[29] Y.Ch. ZARKA, Hobbes et la pensée politique moderne, éd. PUF, 3ème éd. 2012, p. 245-247.
[30] KANT, Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, §42, AK, VI, 307-308, éd. Pléiade p. 573-574 ; Projet de paix perpétuelle, AK, VIII, 382, éd. Pléiade, t.3, p. 378-379.
[31] C. SCHMITT, Théorie du partisan, éd. Flammarion, p. 223.
[32] Ibid., p. 235.
[33] VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, éd. Gallimard 1994, p. 263-265.
[34] A. TOSCANO, Le fanatisme, mode d’emploi, éd. La fabrique, 2011, p. 12.
[35] HEGEL, Principes de philosophie du droit, §5, p. 153-154 (trad. J.-F. KERVEGAN)
[36] Ph. SOUAL, Le sens de l’Etat, éd. Louvain, p. 41
[37] Ibid., p. 43.
[38] Ibid., p. 564
[39] A. TOSCANO, Le fanatisme, op. cit., p. 193
[40]HEGEL, Leçons sur la philosophie de l’histoire, éd. Vrin, 1998, trad. GIBELIN, p. 275-278.
[41] Ibid., p. 275.
[42] Ibid., p. 276.
[43] Ibid., p. 278.
[44] A. TOSCANO, op. cit., p. 189.
[45] Ibid., p. 190.
[46] J. HABERMAS, Tanner Lectures, droit et morale, éd. Seuil, 1997, p. 72.
[47] C. SCHMITT, Légalité et légitimité, éd. Les Presses de l’Université de Montréal, 1930 (trad. 2015), p. 18-20, spéc. p. 18 : « Le législateur fait ce qu’il veut avec la procédure législative ; c’est toujours la « loi » et celle-ci crée toujours du « droit ». La voie est ainsi ouverte à une conception de la légalité complètement « neutre », sans valeur et sans qualité, formaliste et fonctionnaliste tant elle est dépourvue de contenu. »
[48] J. HABERMAS, Droit et démocratie, entre faits et normes, éd. Gallimard, 1992, p. 135 et suiv.
[49] P. RICŒUR, Histoire et Vérité, éd. Seuil, 1967, p. 321 : « La démocratie, c’est la discussion. Il faut donc que d’une manière ou d’une autre cette discussion soit organisée. »
[50] C. LEFORT, L’invention démocratique, op. cit., p. 65.
[51] Ibid., p. 67.
[52] Ibid., p. 92.
[53] P. RICŒUR, La critique et la conviction, p. 157 : « Sur ce point de doctrine je me sépare de Claude Lefort, qui, devant cette même énigme de l’origine du pouvoir, insiste sur l’absence de fondement propre à la démocratie ; pour lui la démocratie est le premier régime qui se soit fondé sur rien, mais sur lui-même, c’est-à-dire sur le vide. D’où son extrême fragilité. J’essaie de dire, pour ma part, qu’il est toujours fondé sur l’antériorité de lui-même par rapport à lui-même. Peut-on appeler cela une fondation ? Si oui, ce serait au sens où l’on parle d’événements fondateurs. Mais ces événements fondateurs présumés n’échappent pas à l’énigme de l’origine fuyante ou, pour mieux dire, à la dialectique de l’origine immémoriale et du commencement daté. »
[54] J. HABERMAS, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, éd. Fayard, 1998, Hachette, 2013, trad. fr. R. ROCHLITZ, p. 53.
[55] C. LEFORT, L’invention démocratique, op. cit. p. 92.
[56] P. RICOEUR, Du texte à l’action. Essai d’herméneutique II, éd. Seuil, 1986, p. 434-438.
[57] P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, éd. Seuil, 1990, p. 302.
[58] C. LEFORT, L’invention démocratique, op. cit., p. 76.
[59] A. TOSCANO, op. cit., p. 11.
[60] D. COLAS, op. cit, p. 312 : « Ce primat de la citoyenneté sur la nationalité, de la politique sur la biologie, se heurte au fanatisme moderne le plus virulent, celui qui est étayé sur le fantasme de la communauté (de sang et/ou de religion) pour lequel l’individu n’existe pas en tant que détenteur de droits politiques mais en tant que porteurs d’emblèmes glorieux ou de stigmates honteux : l’individu est ainsi assigné dans une identité qui absorbe ses droits personnels et fonctionne avec la rigidité des pierres en l’inscrivant dans un groupe dont il ne peut s’extraire, même mort. »
[61] D. COLAS, op. cit. p. 12.
[62] G. CHALIAND, Terrorisme et politique, p. 43.
[63] J. LENOBLE et M. MAESSCHALK,
[64] J. HABERMAS XXX ; C. SPECTOR, Eloge de l’injusice, op. cit.
Date / Heure
Date(s) - 27/02/2017
18:00 - 20:00
Emplacement
Ecole nationale de la magistrature
Catégories