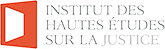Le 3 décembre 2014, la Chambre de première instance a rejeté la nouvelle demande d’ajournement du procès présentée par l’Accusation le 5 septembre 2014. La Chambre a indiqué que l’approche appropriée serait un retrait des charges par l’Accusation, à moins que le niveau d’éléments de preuve se soit suffisamment amélioré pour permettre la poursuite du procès (télécharger la décision, en anglais seulement).
De plus, dans une décision parallèle, les juges ont usé de leur pouvoir discrétionnaire pour ne pas faire suite à la demande du Procureur de saisir l’Assemblée des États Parties à propos du manque de coopération du Gouvernement kényan, au titre de l’art. 87(7) du Statut (télécharger la décision).
La réponse n’a pas tardé : deux jours plus tard, le Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé le retrait des charges contre M. Kenyatta au vu du manque de preuves à sa disposition à ce jour.
Un échec pour le Bureau du Procureur qui cependant…n’a pas dit son dernier mot
Certes, ce qui apparait comme un camouflet pour le Procureur, peut être relativisé. Car même si la décision des juges avait été favorable aux demandes du Procureur, celui-ci n’était évidemment pas assuré pour autant d’obtenir les pièces qu’il réclamait aux autorités kényanes ni même que celles-ci, si elles lui étaient fournies, puissent constituer des éléments de preuve suffisants. Et bien sûr, la perspective d’une possible condamnation n’était pas non plus, de toute façon, pour demain. Or le retrait des charges auquel le Procureur a dû se résigner ne signifie pas l’abandon définitif de tout procès ou condamnation de Kenyatta. Ils sont juste (un peu ?) plus incertains et plus lointains.
En effet, le Procureur peut toujours, lorsqu’il obtiendra des éléments plus solides revenir sur l’affaire comme précisé dans sa déclaration : « J’ai déposé une notification aux fins de retrait des charges et je le fais sans préjudice de la possibilité de présenter une nouvelle affaire si de nouveaux éléments de preuves étaient portés ma connaissance ». Ce rebond du procès Kenyatta pourrait notamment se faire à la faveur d’un retournement de situation au Kenya qui destituerait Kenyatta ou d’un échec aux prochaines élections qui le relégueraient dans l’opposition, le laissant « à la merci » de la justice (nationale ou internationale)
Par ailleurs, le retrait des charges contre le président kényan ne signifie pas la fin de l’action judiciaire de la Cour vis-à-vis des violences post-électorales de 2007-2008, qui ont fait plus de 1300 morts. Elles restent l’objet du procès, ouvert le 10 septembre 2013, contre le vice-président William S. Ruto et Joshua Arap Sang (responsable des opérations à la radio kenyane Kass FM). Même si les faiblesses du dossier en rendent l’issue incertaine, le procès est toujours en cours.
Cependant le coup est rude, non seulement pour les victimes qui espéraient un procès, mais aussi, à titre plus personnel, pour le Procureur. Il s’agissait en effet de la première affaire ouverte de sa propre initiative, en novembre 2009. L’accord de la Chambre préliminaire II avait été rendu en mars 2010 (télécharger la décision). A l’époque, le Bureau du Procureur était dirigé par Luis Moreno Ocampo. Il est vrai qu’à ce moment, la configuration politique pouvait paraître plus propice à une arrestation et un procès de Kenyatta et de Ruto. Lors de la confirmation des charges, le 23 janvier 2012, les suspects n’avaient pas encore gagné les élections et la démarche de l’Accusation ne portait pas à controverse. Elle apparaissait même comme une initiative prometteuse pour enquêter sur des violences de masse liées à la tenue d’élections (comme par la suite pour la Côte d’Ivoire).
La dimension préventive était également mise en avant, le scrutin du printemps 2013 se déroulant dans un climat de violence effectivement jugulé. Cependant, le renversement des alliances (le rapprochement des deux anciens rivaux Kenyatta et Ruto) et le renversement de majorité (Kenyatta gagne la présidence en avril 2013) ont radicalement changé la donne. Bien qu’ils n’aient pas été poursuivis en tant que président et vice-président du pays, l’inculpation de Kenyatta et Ruto s’est au fil du temps muée en un face-à-face entre la Cour et les autorités en place d’un État Partie. Une configuration qui a débouché sur l’impasse que l’on sait aujourd’hui.
Mais cette impasse est aussi un témoignage de plus du problème de la qualité et des difficultés des enquêtes du Bureau du Procureur. Ce problème, complexe et peut-être en partie structurel, va au-delà du seul manque de coopération avec le Kenya. Notamment, le Bureau du Procureur a mis en avant le décès de personnes détenant des informations clés, la peur d’autres de témoigner à charge ainsi que le retrait de certains témoignages entravant la bonne marche de l’enquête. Cette inefficacité met en avant la nécessité d’un renforcement des moyens du Bureau du Procureur (celui-ci a d’ailleurs demandé une augmentation significative dans son budget de la part allouée aux enquêtes).
Un échec pour la Cour qui manque de recours pour contraindre les États à coopérer
Les juges ont reproché au Bureau du Procureur d’avoir accumulé des retards dans la conduite de son enquête et de ne pas avoir soulevé la question de la non-coopération à un stade antérieur ce qui aurait sans doute permis d’ «atténuer l’impact que ce manquement a eu sur la procédure dans cette affaire ». Bien qu’ils aient noté la mauvaise foi et les manquements du gouvernement kényan dans sa collaboration avec la CPI et admis que cela avait nui au travail du Procureur, les juges ont refusé d’en référer à l’Assemblée des États Parties (AEP), peu convaincus de l’utilité de cette démarche.
A ce stade on peut donc considérer qu’il n’existe donc pas encore d’outil pour condamner efficacement le manque de collaboration des États, non seulement dans le cas des États non parties comme le Soudan ou la Libye mais y compris dans le cas des États Parties. C’est pourtant là un défi crucial et un point de préoccupation majeur pour un meilleur fonctionnement de la justice internationale.
Hélène Calame et Joël Hubrecht