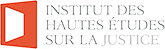Réparations individuelles et collectives
dans le dispositif conçu par les juges pour l’affaire Katanga (CPI)
Crédit photo: à Bogoro, les communautés suivent la projection de l’audience sur l’ordonnance de réparation dans l’affaire Katanga (source : hashtag Bogoro sur Twitter)
À ce jour, quatre affaires de la Cour pénale internationale sont arrivées dans la phase de détermination des réparations : la plus avancée est l’affaire Lubanga (République démocratique du Congo), alors que l’affaire Bemba (République centrafricaine) et l’affaire Al Mahdi (Mali) en sont encore au regroupement des demandes et des observations des parties. La chambre de première instance II a quant à elle rendu le 24 mars 2017, dans le cadre de l’affaire Germain Katanga (République démocratique du Congo) son ordonnance de réparation. Pour mémoire, Germain Katanga avait été, le 7 mars 2014, déclaré coupable, en tant que complice, d’un chef de crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre chefs de crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l’attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l’Ituri en RDC.
L’ordonnance de réparation, tout en s’inscrivant en partie dans le sillage de celle délivrée précédemment dans l’affaire Lubanga, développe de nouvelles proposition et tente, pour la première fois à la Cour, de clarifier les définitions des réparations collectives et des réparations individuelles. La chambre explicite aussi en détails les critères sur lesquelles elle s’est basée pour retenir ou non les demandes de réparation et établir les modalités des réparations collectives ciblées (aide au logement, soutien à une activité rémunératrice, aide à l’éducation, soutien psychologique) et le montant des réparations individuelles sous forme d’indemnisation par un montant symbolique de 250 $ par victime. 297 victimes ont été reconnues éligibles à ces réparations.
Critères retenus et conclusions tirées par la chambre II
En plus de celle des victimes qui avaient été autorisées à participer à la procédure lors de la phase du procès, de nouvelles demandes ont été transmises, élevant leur nombre à 304 début 2016.
Pour reconnaitre le statut de victime aux demandeurs dans la phase de réparations, les juges ont appliqué les mêmes conditions requises au stade du procès de Germain Katanga (définies par la chambre d’appel dans l’affaire Lubanga dans son arrêt du 11 juillet 2008) mais en se limitant aux crimes pour lesquels la culpabilité de Katanga avait été effectivement retenue. Ainsi bien que la chambre de première instance avait reconnu dans son jugement que des viols avaient été commis lors de l’attaque du village et que des enfants soldats avaient été mobilisés, l’accusé Germain Katanga ayant été acquitté des charges rattachées à ces crimes, les demandes qui y étaient rattachées ne pouvaient être prises en compte dans la phase de réparation. Toutefois, comme le Fonds au profit des victimes le souhaitait, la chambre invite expressément dans son ordonnance le Fonds à « tenir compte de ces demandeurs, dans la mesure du possible, dans le cadre de son mandat d’assistance » (par. 154 et 161), le second mandat du Fonds en faveur des victimes dans les pays où la Cour a ouvert une enquête mais sans qu’il y ait un lien avec un procès ouvert.
La chambre détaille les critères de preuves retenus pour déterminer si une personne qui demande des réparations a prouvé les faits qu’elle allègue (identité, préjudice, lien de causalité). Comme la chambre d’appel l’avait recommandé dans l’affaire Lubanga, c’est la norme de « l’hypothèse la plus probable », en usage devant d’autres juridictions internationales et dans certains mécanismes de justice transitionnelle, qui est retenue. Une norme un peu plus souple que celle de de la preuve dite « au-delà de toute doute raisonnable » afin de tenir compte des difficultés auxquelles se heurtent les victimes pour obtenir, souvent des années après le crime (ici, 12 ans après), des pièces justificatives et des preuves probantes. La jurisprudence relative à l’établissement de l’identité a ainsi été appliquée pour les documents à l’appui des préjudices allégués : sont considérés comme suffisamment probants des documents signés par une personne ayant qualité officielle ou, à défaut, par deux témoins crédibles. Concernant par exemple les destructions de maisons et de locaux professionnels, la chambre constate que les attestations de logement portent le sceau officiel de la RDC et qu’elles ont été également signées par le témoin P-166, considéré comme fiable et crédible et dont le témoignage avait été utilisé par la chambre précédente du procès pour corroborer différents éléments sur la population de Bogoro et les évènements avant, pendant et après l’attaque. Comme les attestations de résidence ne fournissent pas de détails sur les biens immobiliers, mais que le pillage a bien été établi lors du procès, la chambre a estimé que si elle n’était pas en mesure de déterminer le type et la quantité de meubles et affaires possédés, il était raisonnable de « présumer que la grande majorité des personnes qui vivaient à Bogoro possédaient des biens essentiels à la vie quotidienne » et qu’ils subsistaient en partie en élevant du bétail et en cultivant les champs. N’étant généralement pas en mesure de se prononcer sur la quantité de bétail perdu, la chambre a adopté la « perte d’un cheptel moyen » comme la norme. A la suite de l’analyse individuelle des demandes, elle note que, grâce notamment à un premier travail de vérification du représentant légal des victimes, celles-ci sont « relativement similaires » et ne « semblent apriori pas contenir des allégations exagérées ou extraordinaires et apparaissent crédibles ». 74 demandeurs ont établi le pillage d’affaires personnelles, 1 de marchandises, 130 le pillage de bétail, 9 de champs et de récoltes.
Les préjudices physiques ont été plus difficiles à intégrer (2 seulement) car les rapports médicaux produits ne permettaient pas, dans la plupart des cas, de prouver, même sur la base de l’hypothèse la plus probable, le lien de causalité avec les crimes pour lesquels Germain Katanga a été condamné. La chambre développe aussi longuement son approche et ses conclusions pour les préjudices psychologiques. Elle a distingué les traumatismes liés au décès d’un parent proche (201 cas) ou éloigné (284 cas) et le traumatisme lié au vécu de l’attaque elle-même (297 cas). Faute de preuve suffisante sur le lien de causalité elle n’a cependant pas retenu le préjudice transgénérationnel (demandé par cinq enfants nés après l’attaque) bien qu’elle ne remet pas en cause la réalité de ce préjudice.
L’estimation monétaire des préjudices matériels étaient relativement facile et n’a pas donné lieu à de fortes divergences entre le représentant légal des victimes et la défense de l’accusé. Elle s’est faite sur la base des prix et du marché local d’Ituri où l’attaque avait été conduite (mais en tenant compte de la valeur actualisé et non celle de 2003). Pour les préjudices extrapatrimoniaux, la chambre a par contre considéré que l’évaluation ne devait pas être rabattue sur la situation économique (misérable) de l’Ituri mais en s’inspirant des pratiques devant d’autres cours ou organes internationaux (commission de l’ONU en matière d’indemnisation, Cour interaméricaine, cours françaises et belges…) a arbitré entre, cette fois, les propositions sensiblement différentes du représentant légal et de la défense (qui suggérait un montant environ deux fois moindre), sans s’en tenir à un simple arbitrage puisqu’elle n’a pas retenu la même catégorisation que celle avancée par les parties, et évalué l’indemnisation du préjudice psychologique pour la perte d’un proche à 8 000 $, d’un parent éloigné à 4 000 $, et pour le traumatisme lié au vécu de l’attaque à 2 000 $.
Pour les réparations collectives, la chambre rappelle que les victimes ont explicitement exprimé une préférence pour des mesures dites « financières/de développement économique » alors que d’autres modalités, comme les évènements commémoratifs, la diffusion du procès, la construction de monuments ou la recherche des disparus ont été rejetés par crainte de créer un nouveau traumatisme ou d’augmenter les tensions et l’insécurité (par. 301). Les juges estiment les réparations collectives appropriées mais celles-ci doivent « cibler les victimes individuellement au maximum » (par.294). C’est dans cette perspective que les « réparations individuelles et collectives ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être accordés concurremment » (par.265) et qu’il faut lire la cohérence de cette ordonnance de réparation.
Les enjeux de la mise en œuvre effective par le Fonds des ordonnances de la Cour
La chambre considère que ce n’est pas aux victimes qu’il faut faire supporter les conséquences de l’indigence du coupable – que celle-ci ne peut donc être le facteur déterminant pour ordonner ou non des réparations individuelles – et, tout en reconnaissant que le Fonds n’y est pas obligé par son règlement qui n’est explicitement contraignant que pour les réparations accordées à titre collectif (règle 56), elle enjoint le Fonds au profit des victimes à « examiner avec bienveillance la possibilité d’avoir recours à l’indemnisation, en dehors des réparations collectives, et d’accepter de fournir des ressources pour compléter les réparations individuelles ». Jusqu’alors le Fonds faisait valoir que les réparations individuelles devaient être financées par la personne reconnue coupable et que les Etats-parties ont volontairement adopté un règlement qui n’oblige pas le Fonds à compléter financièrement ce type de réparation. Deux points sur lesquels la chambre propose donc une nouvelle approche.
Est-ce que le conseil de direction du Fonds (élu par l’Assemblée des Etats-parties), qui fait volontiers valoir son indépendance vis-à-vis de la Cour (même si celle-ci n’est bien sûr pas totale), se rangera aux arguments mis en avant par les juges ? Ou continuera-t-il à revendiquer le contrôle de l’ensemble du processus, de la désignation des victimes, de l’évaluation du préjudice, aux modalités de réparations et jusqu’au montant monétaire à leur consacrer ? Présentera-t-il dans les 3 mois un plan de mise en œuvre des réparations plus convaincant qu’il ne l’avait fait pour l’affaire Lubanga (sur le flou du premier projet, voir l’ordonnance du 9 février 2016, enjoignant au Fonds de compléter son plan de mise en œuvre) ? Ou sous couvert d’un appel de la défense ou du procureur, assistera-t-on à une nouvelle passe d’armes feutrée entre le Fonds et les juges ? Le dialogue entre la Cour et le Fonds aurait sans doute été plus facile et plus claire si une seule Chambre consacrée aux réparations avait été mise en place. Mais puisque tel n’a pas été l’option choisie, il faut espérer que le Fonds ne jouera pas sur cette pluralité d’interlocuteurs et que les échanges entre les deux institutions s’avèreront suffisamment constructifs pour ne pas mettre en péril l’effectivité d’un régime de réparation que les juges de l’affaire Lubanga ont qualifié comme étant une des caractéristiques essentielles de la Cour (« Le succès de la Cour est, dans une certaine mesure, lié au succès de son système de réparation »).
L’ordonnance du 24 mars 2017 rappelle que les victimes devraient obtenir « des réparations appropriées, adéquates et rapides » (par. 267). Les particularités de l’affaire (nombre relativement limité de victimes dans le cadre d’une seule attaque et par rapport à un éventail de crimes lui aussi relativement limité) devraient faciliter la mise en œuvre de l’ensemble des réparations prévues par l’ordonnance. Certes les obstacles pratiques et financiers sont réels. Le projet de mise en œuvre doit être concret et ciblé et éviter les contre-effets de réparations qui, par nature, ne bénéficieront qu’à un nombre relativement limité de victimes. Sur le plan financier, les juges ont évalué la valeur monétaire totale de l’ampleur du préjudice à 3 millions 752 mille et 620 $ (Tableau F, p. 88 de la version française de l’ordonnance). Le montant de la responsabilité de Germain Katanga en matière de réparation a été fixé par la chambre à 1 million de $ mais, comme nous l’avons dit, l’accusé est déclaré indigent et ne pourra guère contribuer au processus de réparation qu’en présentant volontairement ses excuses aux victimes (p.315). Mais la somme dévolue aux réparations individuelles ne représente que 7% environ du montant total des réparations ordonnés. Une « somme modeste » donc comme le soulignent les juges pour qui l’ordonnance « manquerait une majeure partie de son but » si elle devait se réduire uniquement aux réparations collectives. Le Fonds finance ses programmes d’assistance et verse les indemnités de réparation ordonnées par la Cour grâce à des contributions volontaires et des dons. Mais ses revenus annuels ont diminué en 2015 et 2016 (à environ 2 millions d’euros). Selon l’estimation du Conseil, le Fonds nécessiterait un revenu annuel de 10 millions d’euros pour pouvoir améliorer et maintenir sa capacité à remplir ses mandats. La Chambre se réserve la possibilité de demander (en vertu de l’art. 75-4 du Statut) l’assistance d’Etats-partie si cela s’avérait nécessaire. La balle est maintenant dans le camp des parties, en particulier la Défense qui pourrait faire appel, et du Fonds qui pourrait encourager la remise en cause des définitions des réparations collectives et individuelles avancées par la chambre de première instance II ou, au contraire, aller dans le sens de la Cour et élaborer un plan de mise en œuvre adapté aux définitions proposées par les juges.
Joël Hubrecht