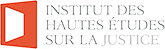[Télécharger le PDF] du décryptage
Les nouvelles technologies dans les juridictions de l’Ordre judiciaire en Belgique : entre contingences politiques et valeurs fondamentales
Par Kevin Munungu Lungungu, Avocat au barreau de Bruxelles et Doctorant à l’Université libre de Bruxelles
En Juin 2014
Depuis la seconde moitié des années 1990, le système judiciaire belge fait l’objet de nombreuses réformes qui visent à en renforcer l’efficacité, l’efficience et la qualité. Jusqu’à présent, ces réformes se sont orientées dans deux directions.
La première vague de réformes cherche à repenser les règles et principes qui gouvernent les procédures judiciaires en attribuant, par exemple, un rôle plus actif au juge à plusieurs stades de la procédure civile (alors que celle-ci constitue, dans les pays continentaux du moins, la « chose des parties »)[1] ou encore en renforçant la place de la victime dans la procédure pénale[2].
Parallèlement à ces réformes procédurales, le pouvoir politique s’efforce également de « moderniser » le fonctionnement des juridictions[3]. Au cœur de cette seconde vague de réformes, se situe l’idée que pour rencontrer les attentes des citoyens, l’activité judiciaire gagne à être imprégnée d’une logique managériale, c’est-à-dire tournée vers les résultats et la maitrise de coûts[4]. C’est dans ce cadre que s’inscrit notamment la loi relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire adopté le 18 février 2014[5] dont l’objectif est de « permettre une justice moderne, accessible et rapide »[6] en transférant la responsabilité de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières au pouvoir judiciaire et en assujettissant le financement des juridictions à la conclusion d’un contrat de gestion. C’est également à ce même effort que participe la loi du 1er décembre 2013 qui redessine le paysage judiciaire afin de favoriser la spécialisation et la mobilité des magistrats[7].
L’informatisation de la justice se situe au carrefour de ces deux mouvements. Il s’agit bien souvent d’offrir aux divers acteurs du procès de nouveaux modes de communication (volet procédural) qui, compte tenu des économies que leur utilisation implique, contribue à garantir l’efficience de la justice, c’est-à-dire son efficacité à moindre coût (volet plus managérial).
Indépendamment des fonctions qui leur sont dévolues, la mise en place des nouvelles technologies dans l’appareil judiciaire belge se situe au cœur d’une tension permanente entre le souci de moderniser le fonctionnement de la justice afin de répondre aux attentes des justiciables et le besoin de préserver certaines valeurs fondamentales qui sont inhérentes à l’exercice de la fonction de juger. C’est en tout cas l’hypothèse que nous faisons dans cette étude et que nous tenterons de vérifier au départ de deux cas d’étude. Le premier concerne la mise en place d’un système informatique général au sein de l’appareil judiciaire (le projet dit « Phénix ») tandis que le second porte sur l’utilisation de la visioconférence dans le cadre du procès pénal. Notre but n’est pas tant d’évaluer l’effectivité de ces réformes mais surtout, conformément aux prémisses qui servent de « fil rouge » à la présente recherche collective[8], de mettre en perspective et d’évaluer la manière dont les auteurs de ces réformes se sont efforcés de concilier le souci de moderniser la justice et celui de préserver les valeurs fondamentales de justice. C’est donc une analyse fonctionnelle et critique de certaines nouvelles technologies que nous proposons de réaliser dans les lignes qui suivent.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques précisions méthodologiques. Tout d’abord, pour les besoins de cette étude, nous nous sommes principalement appuyés sur la littérature juridique consacrée aux deux dispositifs sélectionnés ainsi que sur de la littérature plus secondaire comme des articles de presse ou des rapports d’information. Ce matériau a été, ensuite, complété par une étude de terrain à vocation exploratoire. Dans ce cadre, nous avons notamment rencontré quelques acteurs clés de la vie judiciaire dont trois magistrats (deux juges des tribunaux de première instance de taille différente et un président d’un tribunal de première instance), trois fonctionnaires (le premier ayant travaillé au ministère de la justice tandis que les deux autres étaient encore récemment membres de la Commission de modernisation de l’ordre judiciaire), un avocat spécialiste de la procédure civile et qui enseigne cette matière à l’Université et deux membres du greffe d’un tribunal de première instance. Il va sans dire que cette étude de terrain ne prétend pas dégager une image fidèle et exhaustive de la pratique dans ce domaine en Belgique. Elle avait essentiellement pour vocation de tester certaines intuitions qui ont émergées après la revue de la littérature.
Ensuite, cette étude ne s’intéresse pas à la transposition des nouvelles technologies dans les juridictions administratives et dans la Cour constitutionnelle. Force est, en effet, de constater que la littérature consacrée au fonctionnement interne de ces juridictions et à la mise en place des nouvelles technologies en leur sein est très en friche à l’heure actuelle et cette lacune n’aurait pu être comblé que par une étude de terrain sensiblement plus approfondie. Face à cette carence, notre attention s’est rapidement portée sur les juridictions judiciaires qui connaissent un nombre de contentieux plus conséquent et ressentent donc probablement davantage le besoin de recourir à des nouvelles technologies.
Enfin, si tous les professionnels du droit s’accordent sur la nécessité de mettre en place des applications technologiques pour moderniser le fonctionnement de l’institution judiciaire, ce processus est très loin d’être avancé en Belgique. « Nous sommes encore à l’âge du bronze », confesse d’emblée un président d’une juridiction belge lors de notre entretien. Cette réaction ressort de l’ensemble des entretiens que nous avons menés tant auprès des magistrats que des avocats. L’exercice qui nous est demandé dans ce rapport a donc été très difficile puisqu’il s’agit somme toute de réfléchir que les difficultés que soulèvent les nouvelles technologies au regard de certaines valeurs fondamentales… alors qu’elles sont, précisément, fort peu répandues dans le paysage judiciaire belge.
Ces diverses précisions effectuées, il reste à présenter les différentes étapes de ce rapport. Celui-ci est divisé en trois parties[9]. Dans la première partie, nous proposons un survol du système politique et judiciaire en Belgique (Section 1). La deuxième partie s’intéresse à l’informatisation de la justice civile et pénale en Belgique telle qu’elle a été portée par le projet Phénix (Section 2). La troisième et dernière partie analyse la transposition de la vidéoconférence dans les juridictions belges (Section 3).
Section 1. Aperçu du système politique et judiciaire belge
Contrairement à la France, la Belgique est un État fédéral composé de trois régions et trois communautés[10] qui sont autonomes dans l’exercice de leurs compétences normatives et participent, dans une certaine mesure, aux décisions prises à l’échelle fédérale[11]. Cette superposition de niveaux de pouvoir ne concerne toutefois pas la justice judiciaire, qui demeure – pour le moment – organisée par l’autorité fédérale sur le territoire national. En Belgique, il n’existe donc qu’une seule organisation judiciaire au sommet de laquelle se situe une seule Cour de cassation chargée d’assurer l’uniformité de l’application du droit[12].
La Constitution belge consacre le principe de la séparation des pouvoirs et attribue les trois fonctions essentielles à trois organes distincts, à savoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs implique, à tout le moins, que chacun des trois organes de l’État possède des attributions qui lui sont propres et qui ne peuvent être exercées par les autres[13]. Ainsi, les pouvoirs législatif et exécutif ne peuvent adresser des injonctions et des directives aux autorités judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Ceci dit, il convient de distinguer les juges (aussi désignés de magistrats « assis ») des officiers du ministère public (aussi appelés magistrats « debout »[14]). Au contraire de la magistrature assise, les officiers du ministère public forment un corps hiérarchisé et placé sous l’autorité du ministre de la justice[15]. Certes, la Constitution prévoit que les magistrats du ministère public sont indépendants dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles[16]. Toutefois, le ministre de la justice[17] est compétent pour arrêter les directives de politique criminelles qui possèdent une force contraignante pour tous les membres du ministère public[18].
Les magistrats assis sont, quant à eux, dotés d’un statut qui leur garantit une indépendance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles[19]. Ce statut implique, plus précisément, que les juges disposent de la liberté de trancher, au cas par cas et sans contraintes, les litiges soumis à leur connaissance de la manière qui leur paraît le plus conforme aux règles de droit et de procédure. Il interdit également qu’une autorité interne ou externe au pouvoir judiciaire oriente le sens dans lequel le juge décidera dans une hypothèse déterminée que ce soit en lui formulant des instructions directes mais aussi en l’obligeant de se justifier quant au sens dans lequel il a tranché un litige déterminé[20]. La Constitution prévoit, en outre, qu’ils sont nommés à vie, inamovibles et irrévocables durant leur carrière[21]. Ceci dit, tant les magistrats du ministère public que les juges sont nommés par le Roi[22] selon une procédure qui implique l’intervention du Conseil supérieur de la justice, institué dans la foulée de la réforme dite Octopus réalisé en 1998[23].
Du reste, l’organisation judiciaire belge présente de fortes similitudes avec le système français[24]. A l’instar de la France, la Belgique connaît une juridiction ordinaire (le tribunal de première instance) et de plusieurs juridictions d’exception qui sont nanties de compétences spéciales ou exclusives[25] (le juge de paix, le tribunal de police, le tribunal de commerce et le tribunal du travail). Le tribunal de première instance (l’équivalent du tribunal de grande instance en France[26]) dispose d’une compétence dite ordinaire en ce sens qu’elle connaît non seulement tous les litiges qui ne sont pas expressément confiés à un autre organe du pouvoir judiciaire mais aussi, sous certaines conditions, ceux qui sont spécialement attribués à un autre juge[27]. Depuis le 1er septembre 2014[28], le tribunal de premier instance est composée de quatre sections, à savoir, le tribunal civil, le tribunal de la famille et de la jeunesse, le tribunal correctionnel et le tribunal de l’application des peines[29].
A l’échelle supérieure, la Belgique connaît des cours d’appel compétentes pour connaître des appels formés contre les décisions des juridictions précitées, sauf le juge de paix (dont les décisions peuvent être attaquées devant la chambre civile du tribunal de première instance) et le tribunal de travail (dont les décisions peuvent être attaquées devant la Cour de travail). A ce tableau, il convient de rajouter la Cour d’assises qui est compétente pour juger les crimes ainsi que la Cour de cassation dont la mission est d’assurer l’application uniforme des règles de droit et de procédure par les cours et tribunaux sur le territoire national.
Enfin, l’organisation interne des juridictions vient de faire l’objet d’une réforme majeure qui vise à améliorer l’efficience de la justice.
Ainsi, depuis le 1er avril 2014, chaque juridiction est dirigée par un comité de direction dont la composition précise est fixée par la loi[30]. Cet organe a pour but d’assister le chef de corps de la juridiction[31] dans la direction, l’organisation et la gestion de celle-ci[32] – dans le respect de l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. La nouvelle loi sur la gestion autonome du pouvoir judiciaire crée, en outre, à l’échelle nationale cette fois, deux organes qui sont en charge de gérer les ressources allouées à la justice par le ministère de la justice : le Collège des cours et tribunaux d’une part, et le Collège du ministère public, d’autre part. Ces moyens leur seront attribués sur la base d’un contrat de gestion qui sera conclu pour une période de trois ans entre le pouvoir judiciaire et le ministère de la justice[33]. Ce contrat fixera les objectifs opérationnels que doivent atteindre les juridictions pendant la période considérée. Si cette réforme suscite des critiques sur le plan de sa constitutionnalité[34], elle s’inscrit en tout cas dans une vague de réformes gestionnaires entreprises en Europe et parmi lesquels les tentatives d’informatisation de la justice font également partie intégrante.
Section 2. Le projet Phénix d’informatisation des procédures civile et pénale
Dans le cadre d’une étude dédiée à la transposition des nouvelles technologies dans l’appareil judiciaire belge, il est difficile de faire l’économie du projet visant à mettre en place au sein des juridictions judiciaires le système informatique Phénix (ci-après « projet Phénix »). Si l’entrée en vigueur des législations relatives à ce système informatique ne cesse d’être repoussée, il n’en reste pas moins que le projet Phénix constitue le projet le plus novateur dans ce domaine en Belgique et mérite, à ce titre, que l’on s’y attarde quelque peu. Ainsi, après avoir brièvement mis en perspective les différentes initiatives antérieures à ce projet (I), nous exposerons les principaux traits de ce projet (II) avant de s’appésantir sur les différents obstacles qui jalonnent sa mise en œuvre dans la pratique (III).
- – Les antécédents du projet Phénix
À l’instar de ses homologues européens, le législateur belge s’est laissé convaincre de la nécessité de moderniser la justice en général, et la justice judiciaire en particulier, par son informatisation[35]. C’est ainsi qu’en 2005, trois projets de loi ont été déposés à la Chambre des représentants de Belgique (ci-après, la « Chambre ») en vue d’établir un cadre légal pour la réalisation d’une telle entreprise, appelée projet Phenix[36]. Ces textes visaient notamment à uniformiser les diverses applications informatiques utilisées au sein de l’Ordre judiciaire, à permettre – en légalisant – la transmission et l’exécution d’actes de procédure par voie électronique ainsi qu’à renforcer, par ce biais, l’efficacité et l’efficience de l’institution judiciaire[37]. Ils ont été coulé dans trois législations différentes, à savoir la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix[38] (ci-après « la loi du 10 août 2005 »), la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique[39] (ci-après « la loi du 10 juillet 2006) et la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique[40] (ci-après « la loi du 5 août 2006).
Cela étant, le souhait de transposer des nouvelles technologies dans l’appareil judiciaire avait déjà été partiellement concrétisé au début des années 2000. En atteste, par exemple, la loi du 20 octobre 2000 visant à introduire l’utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire[41] . Il s’agit, pour certains auteurs, de la première tentative d’informatisation globale de la procédure judiciaire[42]. L’objectif restait toutefois relativement modeste dans la mesure où seule était permise l’utilisation du fax et du courrier électronique dans les échanges entre parties et entre les parties et le greffe[43]. Nous songeons également à la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central des avis de saisies, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes[44]. Dans cette même perspective d’informatisation sectorielle et ciblée, le législateur a autorisé en 2000 le recours à la vidéoconférence pour permettre au tribunal et au président de la cour d’assises de faire comparaitre un témoin mineur lorsqu’ils estiment que cette comparution est nécessaire à la manifestation de la vérité[45].
De même, la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels[46] permet également l’audition d’un témoin par le biais de cette technologie moyennant la réunion de certaines conditions restrictives. Comme nous le verrons plus loin, il faut qu’il s’agisse soit d’un témoin qui bénéficie d’une mesure de protection octroyée par la Commission de protection des témoins ou d’un témoin souspçonné résidant à l’étranger s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’il comparaisse en personne. Enfin, il convient de signaler l’expérience pilote initiée en avril 1998 de l’utilisation du dispositif de surveillance électronique des condamnés, qui sera finalement consacrée par une loi du 17 mai 2006[47].
À côté de ces réformes législatives, nous pouvons noter que certains auteurs avaient déjà identifié au milieu des années 80 des tentatives similaires mais qui n’ont pas été coulées dans un texte législatif. Celles-ci visaient principalement à accélerer l’administration de la justice par le biais de pièces de procédure standardisées[48]. Ce constat n’a toutefois pas été corroboré par d’autres sources.
Ces différentes initiatives participaient donc au même effort : mettre en place en place des nouvelles technologies au sein de l’appareil judiciaire afin de moderniser son fonctionnement et de rencontrer, par ce biais, les préoccupations et attentes des citoyens. C’est toutefois le projet Phénix qui inscrit )l’institution judiciaire belge dans l’ère de l’informatisation. En effet, « [si] l’informatique avait déjà quelque peu – et non sans difficultés – risqué un premier pas dans nos augustes et vénérables prétoires, l’ambition de Phénix entend imposer les technologies modernes de l’information et de la communication comme une seconde nature de l’appareil judiciaire »[49]. Le prochain point s’attache à présenter les ressorts de ce projet et, plus particulièrement, les fonctions que ses auteurs lui ont assignées ainsi que la manière dont ils se sont efforcés à rencontrer les difficultés posées au regard des valeurs fondamentales.
- – L’essentiel du projet Phénix
La mise en place du système informatique Phénix avait pour but d’appréhender « la gestion de l’ensemble du déroulement des procédures à tous les niveaux de juridiction, à assurer la gestion dynamique du dossier et de son contenu et à faciliter l’organisation des cours et tribunaux »[50]. Elle s’est concrétisée, dans les faits, par l’adoption de trois législations différentes vouées à mettre à jour les règles en vigueur pour correspondre aux espoirs portés par le projet Phénix[51].
La première d’entre elles tend à consacrer la banque de données Phénix et lui assigne six principales fonctions : la communication interne et externe nécessaire au fonctionnement de la Justice, la gestion et conservation des dossiers judiciaires, l’instauration d’un rôle national, la constitution d’une banque de données de jurisprudence, l’élaboration de statistiques et l’aide à la gestion et à l’administration des cours et tribunaux[52].
Cette loi met également en place trois organes chargés de diriger ce projet : un comité de gestion (chargé de « gérer » Phénix et de prendre toute initiative pertinente à cette fin[53]), un comité de surveillance (qui a pour mission de vérifier le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel[54]) et un comité d’utilisateurs (qui, comme son nom l’indique, est formé d’utilisateurs de Phénix et peuvent proposer des initiatives en vue d’améliorer l’utilisation de celui-ci[55]). La désignation, la composition et le mode de fonctionnement de ces différents organes ont été pensés afin d’assurer un équilibre entre le trois pouvoirs de l’État[56].
Encore fallait-il adapter les règles procédurales en vigueur pour rendre possible et légal l’utilisation de l’application informatique Phénix.
C’est l’objet des deux autres lois[57] adoptées à la faveur de cette réforme.
Les aménagements apportés aux règles procédurales diffèrent selon qu’il s’agit de la procédure civile ou de la procédure pénale. En effet, en matière civile, le législateur a préconisé une réglementation neutre et susceptible de s’appliquer indépendamment de la nature (électronique ou papier) de l’acte de procédure[58]. Ainsi, l’article 5 de la loi du 10 juillet 2006 prévoit-il qu’à moins que la loi en dispose autrement, « une pièce de procédure créée, déposée, communiquée et conservée électroniquement est assimilée à une pièce établie sur support papier ». Les auteurs de ce projet se sont, ensuite, attachés à « réécrire » les dispositions relatives, par exemple, aux actes introductifs d’instance, au dépôt des conclusions, à la communication des pièces ou encore au contenu du dossier judiciaire « afin de les rendre indifférents à la nature de leur support »[59].
En revanche, compte tenu du nombre souvent important d’acteurs susceptibles d’intervenir dans le cours d’un procès pénal[60], le législateur a mis en place une réglementation autonome spécifiquement au dossier électronique dans ce domaine. Il ne s’indique pas d’entrer en profondeur sur chacune de ces règles qui ne sont, au demeurant, pas encore en vigueur.
Il convient toutefois de signaler que, dans les deux cas, le législateur a été sensible à la nécessité de préserver l’effectivité de l’accès à la justice. C’est ainsi qu’il est prévu que nul ne peut être contraint de recourir à la procédure par voie électronique[61]. Les justiciables conservent donc le choix entre la procédure traditionnelle et la procédure électronique. Toutefois, il est prévu que le pouvoir exécutif peut contraindre certains professionnels du droit, notamment les huissiers et les avocats[62], d’exercer certaines activités exclusivement par voie électronique.
En marge de la mise sur pied de la procédure électronique, le projet Phénix comporte également un volet relatif à la diffusion des décisions de justice[63].
En effet, la loi du 10 août 2005 qui institue le système d’information Phénix met en place deux banques de données de jurisprudence. La première est une banque de données interne et reprend toutes les décisions des juridictions dans leur intégralité (et ne fait donc l’objet d’aucune anonymisation). L’utilisation de cette banque de données est toutefois fortement encadrée. D’une part, « les décisions de chaque juridiction sont accessibles aux seuls membres de cette juridiction »[64]. D’autre part, il est prévu que les magistrats ne peuvent accéder et utiliser ces données qu’afin d’exercer leur activité professionnelle[65].
La seconde banque de données de jurisprudence est accessible au public mais ne comprend que les décisions sélectionnées par chaque juridiction conformément aux règles de sélection déterminées par le comité de gestion en coordination avec le comité des utilisateurs[66]. Celles-ci sont, en règle générale, anonymisées. Le 30 juin 2014, la Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire[67] a consacré un numéro sur la publication des décisions de justice et notamment une analyse chiffrée de l’utilisation de la banque de données Juridat. Selon ce rapport, environ 145.279 décisions étaient encodées au 3 octobre 2013. Ces décisions ont été sélectionnées selon les différents critères tels que leur retentissement dans la société, l’argumentation (traditionnelle ou inédite) qui est mobilisée par le juge, son objet (notamment si la compétence du tribunal concerné était remis en cause par les parties). Il appert, en outre, que ne sont en tout cas pas sélectionnées, par exemple, les décisions qui est rédigée selon une formule standard ou qui ne présentent manifestement pas une plus-value ajoutée par rapport à la jurisprudence constante en la matière.
- Dernier volet de la réforme Phénix : la mise en place d’un système facilitant l’élaboration des statistiques internes et externes des juridictions[68]. Les statistiques internes sont élaborés à la demande du chef des corps en vue d’assurer une bonne gestion de sa juridiction. Les statistiques externes sont, quant à elles, établies par le comité de gestion de Phénix notamment à la demande du ministre de la justice ou du Conseil supérieur de la justice. Les sources qui nous sont parvenues n’analysent jamais la visée managériale du projet Phénix. Cette lacune a été partiellement confirmée par les recherches empiriques que nous avons réalisées au sein des juridictions. Bien entendu, des statistiques sont effectuées au sein des juridictions : ces données permettent notamment de « chiffrer » l’activité juridictionnelle des magistrats et interviennent notamment dans le cadre de leur évaluation[69]. En revanche, nous n’avons pas vu vérifier si des statistiques externes sont effectivement « commandées » dans la pratique…
III. – L’échec du projet Phénix
L’exposé qui précède montre combien le projet Phénix se situe au carrefour des trois catégories posées par les concepteurs de cette recherche collective, même si le poids respectif des trois fonctions (procédure, transparence du processus de décision judiciaire, management) est très inégal. Il s’agissait effectivement, par la mise en place de cette gigantesque banque de données[70], à la fois et dans le respect des valeurs fondamentales, de faciliter la communication entre les divers acteurs du procès, d’améliorer la gestion des juridiction (notamment par l’élaboration des statistiques internes et externes) et d’influer sur le processus de décision judiciaire via une diffusion plus étendue de la jurisprudence.
Ceci dit, l’importance du projet Phenix doit être relativisée dès lors que la mise en œuvre concrète du projet n’a pas été à la hauteur de ses ambitions. En effet, la banque des données « Phénix » n’a jamais vu le jour suite à la rupture du contrat qui liait l’État à la société Unisys (firme qui était chargée de fournir les outils technologiques) « vu les retards accumulés par la firme et le manque manifeste de qualité des prestations fournies »[71].
Ce projet a toutefois largement inspiré les réformes ultérieures entreprises par les ministres de la justice. Citons, à titre d’exemple, le plan Cheops qui consiste principalement en la modernisation, la centralisation et la généralisation de l’application « Mammouth » (MACH) utilisée par les justices de paix et les parquets des tribunaux de police[72]. Songeons également à une application spécifique (Prisma) prévue pour le contentieux du règlement collectif de dettes et qui vise à dématérialiser les nouveaux dossiers. Signalons, enfin, l’intention de permettre le dépôt digital des pieces de procédure par les avocats, huissiers et notaires à l’aide de boite postale électronique au sein des juridictions.
A défaut de banques de données suffisamemnt fiable, l’entrée en vigueur des lois relatives à la procédure électronique ne cessent d’être repousée[73]. Elle est actuellement fixée au 1er janvier 2015. C’est d’ailleurs pour contester cette carence du pouvoir politique que Hans van Bossuyt, vice-président du comité de gestion Phénix, a déposé sa démission dès décembre 2009[74]. Dans le dernier rapport d’activités du comité de gestion qui portait sur les « réalisations » en 2010, le président du comité de gestion, Carmelo Zaïti, poussait un « nouveau cri d’alarme » sur l’avancée de ce projet dans ces termes: « En vain, car rien ne s’est amélioré ! Et personne n’a bougé et personne ne bouge ! A l’exception de quelques interpellations parlementaires dont on sort en effectuant quelques pirouettes verbales, le sujet ne semble en effet intéresser personne. A l’évidence, même dans les milieux particulièrement concernés par l’incontestable intérêt que représente l’indispensable informatisation sérieuse et globale de la justice, on se satisfait des explications laconiques qui cachent une évolution en la matière à la vitesse de l’escargot. »[75]
Jusqu’à présent, seule la banque de données de jurisprudence externe – juridat – a été effectivement mise sur pied. Cela étant, son utilisation par les professionnels du droit (en ce compris par les juges !) reste fort limitée (environ 50.000 consultations par mois[76]). En effet, il existe d’ores et déjà en Belgique des moteurs de recherche mis en place par des firmes privées (notamment Jura, Strada ou Jurisquare) et qui recensent les décisions de justice publiées dans les revues juridiques et qui, compte tenu de leur exhaustivité, sont bien plus utilisées dans la pratique.
L’échec du projet Phénix en Belgique permet en tout cas de nuancer quelque peu la prémisse initiale de cette recherche collective. Au delà des questions qui touchent aux valeurs fondamentales, ce sont des considérations techniques (difficulté de trouver un système informatique fiable) et politiques (priorités des ministres de la justice[77]) qui freinent la mise en place de cette nouvelle technologie pourtant indispensable pour le bon fonctionnement de l’institution judiciaire.
Section 3 – L’exemple de la vidéoconférence en matière pénale
La présente section cherche à vérifier l’hypothèse de travail que nous avons posée dans l’introduction de cette étude au départ de l’exemple de la vidéoconférence. Plus précisément, nous montrerons dans l’exposé qui suit comment le besoin de préserver certaines valeurs fondamentales sert actuellement de frein à l’épanouissement de ce dispositif en droit belge. Pour cela, nous faisons nôtre la définition proposée par Sophie de Biolley dans le cadre de ses travaux sur la vidéoconférence en Belgique[78]. D’après de Biolley, la vidéoconférence est « un dispositif qui permet à des personnes situées sur deux sites distants de se voir et de dialoguer mutuellement en temps réel grâce à un écran tel que celui d’une télévision ou d’un ordinateur »[79]. Dans le cadre du procès pénal, la vidéoconférence est généralement utilisée « dans le but d’auditionner ou permettre à l’un ou l’autre acteur concerné de participer à distance à une audience ou à un devoir d’enquête »[80], étant entendu que ces lieux peuvent se trouver dans des pays différents[81]. À la différence de Sophie de Biolley, nous préférons toutefois le terme « vidéoconférence » plutôt que « visioconférence ». Si le deuxième terme a le mérite de respecter à la langue française[82], la première formule est celle qui est principalement mobilisée par le législateur belge[83].
Les prochaines lignes proposent une analyse diachronique de la mise en place de la vidéoconférence comme mode de communication entre certains parties dans le cadre d’un procès pénal. Nous montrerons, plus précisément, que le recours à ce dispositif reste, pour l’heure, encadré de manière rigoureuse par le législateur compte tenu des différentes valeurs fondamentales qui sont potentiellement mises en danger (I). L’extension du cadre légal existant demeure toutefois au cœur de nombreuses querelles entre le politique et le judiciaire (II).
- – État des lieux
C’est au début des années 2000 que le législateur autorise, pour la première fois en Belgique, le recours à la vidéoconférence comme outil de communication entre les parties à un procès pénal. Le but officiel de l’intégration de ce dispositif est de protéger certaines catégories de personnes en raison de leur âge ou de la nature des infractions concernées. A titre accessoire, il s’agit également de contribuer à maitriser les frais de justice en matière pénale en facilitant l’audition des personnes situées à l’étranger.
La première initiative en faveur de l’utilisation de la vidéoconférence est la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs. Cette législation admet la possibilité d’entendre un témoin mineur[84] via une vidéoconférence lorsque la cour[85] ou le tribunal l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité[86]. En règle, comme l’indique Christian de Valkeneer, procureur général de Liège, l’article 100 du Code d’instruction criminelle consacre « le principe de la non-comparution du mineur à l’audience d’une juridiction de fond, la comparution étant remplacée par le recours à l’entregistrement et aux procès-verbaux réalisés aux stades de l’information et de l’instruction »[87]. La juridiction de fond concernée peut toutefois juger nécessaire d’entendre le témoin mineur pour mener à bien sa mission. Dans ce cas[88], l’audition doit être réalisée via une vidéoconférence selon les modalités prescrites par le Code d’instruction criminelle, sauf si le témoin émet le souhait de témoigner en personne à l’audience[89]. Cette « audition à distance » se déroule dans une pièce séparée (ce qui est bien logique) en présence de certaines personnes déterminées dont une personne majeure choisi par le témoin mineur[90], de son avocat, d’un technicien et, selon les cas, d’un expert psychiatrique ou d’un psychologue[91]. De plus, le tribunal peut valablement limiter ou exclure tout contact visuel entre le mineur entendu à distance et le prévenu présent à l’audience[92]. Enfin, la possibilité d’enregistrer l’audition vidéofilmée du mineur est fortement encadrée par le législateur[93].
C’est de ce même esprit que procède la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels[94].
La raison d’être de cette loi ressort très clairement du discours du ministre de la justice durant les débats parlementaires : « La possibilité d’entendre des personnes à distance est particulièrement intéressante dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Le besoin croissant de déclarations à charge faites par des témoins et des collaborateurs de la justice impose le développement d’un régime de protection de ces personnes contre l’intimidation, la menace et la violence. Le recours aux moyens de télécommunication précités permet de garantir, d’une manière relativement simple et peu onéreuse, la sécurité de la personne entendue. Le lieu de l’audition peut en effet être tenu secret vu que le témoin n’est pas entendu dans la salle d’audience. En outre, le recours à l’altération de l’image et de la voix permet d’accorder un certain anonymat à l’intéressé. L’audition à distance a également pour avantage qu’une personne appelée à faire des déclarations au bénéfice d’une procédure pénale étrangère ne doit pas se déplacer. L’utilisation de techniques de télécommunication audiovisuelle permet donc de réduire sensiblement les frais et d’économiser beaucoup de temps »[95].
On le voit, à la lecture de cet extrait, la loi du 2 août 2002 poursuit deux principales fonctions. D’une part, à l’instar du système mis en place par la loi du 28 novembre 2000, il s’agit de protéger une catégorie de personnes (à savoir, les témoins menacés). D’autre part, la loi du 2 août 2002 procède de l’effort de maîtriser les frais de justice en matière pénale en facilitant l’audition de certaines personnes situées à l’étranger.
Cela étant, dès lors que « la technique audio-visuelle (…) déroge au principe de la présence personnelle du témoin, de l’expert ou du prévenu lors de son audition au stade de l’instruction ou devant le tribunal »[96], le législateur a encadré son recours de certaines conditions très restrictives, plus restrictives d’ailleurs que celles prévues par la loi sur la protection pénale des mineurs. Plus concrètement, le procureur du Roi et le juge d’instruction[97] peuvent entendre un témoin qui bénéficie d’une mesure de protection octroyée par la Commission de protection des témoins ou un témoin, un expert ou une personne souspçonnée résidant à l’étranger[98], avec son accord, s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’il comparaisse en personne.
Le même principe vaut pour les juridictions de fond[99] sous réserve de deux nuances : d’une part, la personne soupsçonnée résidant à l’étranger ne peut être auditionnée par cette voie et, d’autre part, la décision de recourir à la vidéoconférence ne peut être prise que sur réquisition motivée du ministère public de sorte que la personne poursuivie et la partie civile doivent obtenir l’accord de celui-ci pour que l’audition d’un témoin se déroule par vidéoconférence[100]. Enfin, aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de non-respect de ces conditions. Aussi, leur violation n’emporte la nullité de la pièce concernée que si elles impliquent une violation des droits de la défense ou hypothèque la fiabilité du témoignage[101].
Pour le surplus, la loi organise de manière précise la procédure par laquelle les témoignages sont receuillis par vidéoconférence. Ainsi, la loi admet que la voix et l’image de la personne entendue puissent être altérées ; cependant, dans ce cas, la force probante des informations obtenues par ce biais est plus faible puisqu’elles doivent être corroborées par d’autres moyens de preuve pour être prises en considération à titre de preuve[102].
Comme l’ont souligné certains auteurs[103], les conditions ainsi posées par le législateur sont difficilement compatibles avec certaines valeurs perçues comme fondamentales en Belgique[104]. D’une part, elles sont problématiques au regard du principe d’indépendance du juge dans l’exercice de ses compétences[105] dès lors que la possibilité pour le juge de recourir à un moyen de preuve est assujetti à la décision de l’une des parties au procès, à savoir le ministère public. D’autre part, en rapport avec le principe d’égalité des armes, le système mis en place crée un déséquilibre injustifié entre les pouvoirs respectifs du ministère public et des autres parties au procès pénal. En effet, alors que le ministère public peut solliciter le recours à la vidéoconférence dans les cas prévus par la loi, cette possibilité est exclue pour la partie poursuivie. Celle-ci ne peut, par exemple, pas solliciter l’audition d’un expert résidant à l’étranger afin d’augmenter ses chances d’obtenir une décision plus favorable.
Enfin, il échet de signaler que ce cadre légal ne permet pas aux autorités judiciaires de faire comparaître les personnes poursuivies par vidéoconférence devant les juridictions de fond. Cette lacune est critiquée dans la doctrine, notamment néerlandophone[106], qui s’appuie notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui est favorable au recours de ce dispositif sous certaines conditions[107]. Nous monterons, dans les lignes qui suivent, combien cette question demeure actuellement fortement débattue en Belgique : la raison tenant notamment à une divergence de vues sur la portée du « principe de présence » des personnes poursuivies à l’audience.
- – La comparution d’une personne poursuivie par vidéoconférence ou une « déshumanisation » de la justice pénale ?
La loi du 2 août 2002 n’autorise pas le recours à la vidéoconférence pour faire comparaître une personne poursuivie (que l’on désigne, en Belgique, par le terme « détenu ou inculpé » lors de la phase préliminaire du procès, « prévenu » lorsqu’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel et, enfin, « accusé » lorsqu’il est poursuivi devant la cour d’assises). Cette carence est perçue, à tort ou à raison, par d’aucuns comme une lacune qui constitue un frein à la maîtrise des frais de justice en matière pénale.
C’est afin de pallier cette lacune qu’un projet pilote a pris place à Charleroi et à Louvain sur base d’une initiative du ministre de la justice Marc Verwilghen. Ce projet tendait à permettre que les détenus maintenus en prison soient entendus, avec leur consentement, par la Chambre du conseil via un dispositif de vidéoconférence. Un arrêt de la chambre des mises en accusation de Mons a, toutefois, mis fin à ce projet-pilote – qui avait alors quatre mois – au motif que la comparution d’un détenu par vidéoconférence devant la Chambre du conseil était illégale car la loi relative à la détention préventive ne reconnaît pas cette manière de comparaitre à l’audience[108]. Nous n’avons toutefois pas pu prendre connaissance de la version originale de cet arrêt de la Cour d’appel de sorte qu’il est difficile d’étayer les arguments qui ont été précisément convoqués afin de mettre fin à l’utilisation de la vidéoconférence.
Cette décision de la Chambre des mises en accusation n’est pas en soi surprenante. En effet, s’il est parfaitement louable d’encourager le recours aux nouvelles technologies pour des motifs d’efficacité, les juridictions belges se détachent difficilement des règles procédurales prévues dans le Code judiciaire et le Code d’instruction criminelle, en ce compris les modes traditionnels de transmission d’acte de procédure Il en va du respect du principe de légalité de la procédure qui ne peut être hypothéqué à des fins purement gestionnaires. Un arrêt de la Cour de cassation belge du 25 janvier 2008 peut illustrer cette dernière considération dès lors que la Cour décide « qu’un message électronique ne répond à aucune des conditions requises pour constituer une demande en justice, et spécialement une demande en récusation, en sorte qu’il ne produit aucun effet et qu’aucune suite judiciaire ne doit lui être réservée »[109]. Certains auteurs voient, dans cet arrêt de principe, le rejet de la théorie des équivalents fonctionnels comme principe général du droit[110].
Afin de rencontrer la critique formulée par la chambre des mises en accusation, Christine Defraigne, sénatrice libérale francophone (Mouvement réformateur), a déposé à deux reprises une proposition de loi visant à permettre l’utilisation de la vidéoconférence pour faire comparaître à distance les détenus devant les juridictions d’instruction[111]. Cette proposition de la loi partait du constat que le projet pilote mis sur pied avait permis de réduire substantiellement le nombre d’heures nécessaires pour transférer les détenus et avait contribué à réduire les budgets et le nombre d’évasions. Cette proposition prévoit que l’inculpé en détention préventive peut comparaître par vidéoconférence, à moins de s’y opposer formellement.
Cette proposition de loi rejoint, pour partie, celle déposée à la Chambre des représentants par quatre parlementaires du groupe politique N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)[112]. Celle-ci visait également à légaliser l’utilisation de la vidéoconférence par les juridictions pénales – à ceci près que le consentement de l’inculpé n’était aucunement requis. Selon les auteurs de la proposition de loi, « un juge indépendant est le mieux placé pour décider de la forme de comparution la plus adéquate et pour veiller au respect du droit à un procès équitable, pendant la totalité de l’instruction. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation considère qu’une comparution par vidéoconférence porte atteinte de manière irrémédiable aux droits de la défense, elle peut encore décider de faire comparaître personnellement l’inculpé à l’audience, comme le prévoit déjà aujourd’hui le Code d’instruction criminelle »[113].
Enfin, il semble qu’au cours de l’année 2012 le pouvoir politique envisageait déposer un avant-projet de loi qui imposait le recours à la vidéoconférence aux magistrats pour faire comparaître les personnes poursuivies – et ce, sans le consentement de ces dernières[114]. Afin d’être en phase avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les auteurs de cet avant-projet de loi lui assignaient trois principaux objectifs : maîtriser les frais de justice en évitant des déplacement couteux, assurer la sécurité au sein des tribunaux (tout en évitant les risques d’évasion) et protéger les intérêts des victimes.
Ce projet a immédiatement suscité des critiques virulentes dans le milieu judiciaire, notamment au barreau de Bruxelles qui y voyait une entorse au principe de présence des personnes poursuivies consacré par la Convention européenne des droits de l’homme : « La justice est rendue par des êtres humains, et pour les êtres humains. Les contacts directs sont nécessaires, et cela tout autant lorsqu’il est question d’apprécier les critères de détention préventif que devant le juge du fond. Le fait de limiter ce contact à une relation par vidéo-conférence, le détenu étant en prison, est inacceptable. (…) cette forme de comparution (est) manifestement contraire au droit des détenus de comparaître personnellement, droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. »[115] C’est dans ce même esprit qu’une lettre ouverte a été rédigé et signé par plusieurs associations professionnelles (avocats, magistrats, personnel penitentiaire, etc.) notamment afin de dénoncer l’inadéquation de ce projet avec les préoccupations de terrain[116].
Les informations qui nous sont parvenues ne nous permettent pas de déterminer l’état d’avancé de ce projet. Ceci dit, il est fort possible que les négociateurs de la prochaine coalition gouvernementale (notamment composée du Mouvement Réformateur et de la NVA) tenteront de faire aboutir ce projet au cours de la prochaine législature. Affaire à suivre donc…
La présente étude visait à vérifier l’hypothèse suivant laquelle la mise en place des nouvelles technologies dans l’appareil judiciaire belge se situe au cœur d’une tension permanente entre le besoin de moderniser le fonctionnement de la justice pour rencontrer les préoccupations des usagers de la justice (professionnels ou profanes) et celui de préserver certaines valeurs fondamentales inhérentes à l’exercice de la fonction de juger. Une telle entreprise était très difficile dans la mesure où les nouvelles technologies restent très peu répandues dans les juridictions belges.
Toutefois, nous avons montré comment différentes valeurs fondamentales ont limité la marge de manœuvre du pouvoir politique lorsqu’il s’est attelé à transposer certaines technologies au sein de l’appareil judiciaire en Belgique. L’étude du projet Phénix a permis de montrer comment la volonté de préserver, par exemple, l’accès à la justice, la séparation des pouvoirs, la vie privée des justiciables ou d’autres principes fondamentaux se traduit dans le cadre légal qui met en place ce système informatique. Les conditions particulières strictes qui encadrent le recours à la vidéoconférence dans la procédure pénale poursuivent également ce même dessein, même si, nous l’avons vu, certaines valeurs restent protégées de manière insuffisante.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que diverses contingences politiques[117] ont hypothéqué l’aboutissement de certains projets des nouvelles technologies au sein de l’appareil judiciaire en Belgique. L’extension du cadre légal de la vidéoconférence sera-t-elle véritablement à la table des négociations ? Le projet Phénix, adopté en 2005, verra-t-il son entrée en vigueur (prévu pour 2015) encore une fois repoussé par le pouvoir politique ? Et quel sera l’impact, à court ou moyen terme, de la création du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public à la faveur de la réforme de la gestion des juridictions votée en 2014 et qui auront la responsabilité de travailler en faveur d’une « justice plus efficace » ?
Ces questions restent, pour le moment, très ouvertes…
* Au cours de la rédaction d’une première mouture de ce texte, Elodie Falla, alors coauteur, a dû suspendre son activité professionnelle pour des raisons de santé. Depuis lors, celui-ci a fait l’objet de nombreuses modifications substantielles apportées par Kevin Munungu Lungungu et dont il porte seul la responsabilité. Il est fait observer que les recherches bibliographiques sur lesquels ce texte s’appuie ont été arrêtées le 1er juin 2014.
[1] Loi du 27 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, M.B., 12 juin 2007 – Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, M.B., 7 juin 2007 – Loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil, M.B., 3 août 2012 – Loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, M.B., 27 septembre 2013. Sur les effets de cette accélération du temps judiciaire, voir récemment B. Bastard, D. Delvaux, C. Mouhanna et F. Schoenaers, L’esprit du temps. L’accélération dans l’institution judiciaire en France et en Belgique, résultats d’une recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice, Juillet 2012.[2] Loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction, M.B., 2 avril 1998. Sur ce point, voir La place de la victime dans le procès pénal. Actes du colloque organisé le 28 octobre 2004 à la Maison des Parlementaires à Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, coll. Les cahiers de l’Institut d’études de la justice, 2004.
[3] J.-P. Janssens, « Le management judiciaire, un danger pour les droits de l’homme ? », Les droits de l’homme et l’efficacité de la justice, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 35-52.
[4] C. Vigour, « Ethos et légitimité professionnels à l’épreuve de l’approche managériale: le cas de la justice belge », Sociologie du travail, 2008, pp. 78 et s.
[5] M.B., 4 mars 2014.
[6] Loi relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, M.B., 4 mars 2014.
[7] M.B., 10 décembre 2013.
[8] H. Épineuse, « « Technologies et justice » Document d’orientation thématique du programme « Politiques de justice », 1er mars 2013.
[9] Contrairement à ce qui se pratique dans le monde scientifique français, non seulement la « structure en deux parties » ne présente pas de caractère obligatoire en Belgique mais il fait, en outre, l’objet de nombreuses critiques dans la littérature juridique. Voir, notamment, F. Ost, « La thèse de doctorat en droit : du projet à la soutenance », Annales de Droit de Louvain, 2006, p. 16 : « La thèse en deux parties comme illustration d’une conception positiviste et réductrice de la recherche en droit ».
[10] Constitution, art. 1er.
[11] Sur les traits saillants du système fédéral belge : M. Uyttendaele, Trente leçons de droit constitutionnel, Limal, Anthémis, 2014, 22ème leçon – Le fédéralisme belge, n°6 et s.
[12] Constitution, art. 147.
[13] Proc. Gén. F. Dumon, « Le Pouvoir Judiciaire. Cet inconnu et ce méconnu », traduction du discours prononcé du 1er septembre 1981 à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, J.T., 1981, p. 458.
[14] Parce qu’au contraire des juges, ils se lèvent à l’audience lorsqu’ils présentent oralement leurs réquisitions (M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2012, p. 46).
[15] G. de Leval et F. Georges, Précis de droit judiciaire, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2010, p. 221 et s.
[16] Constitution, art. 151.
[17] Il convient toutefois de signaler que la sixième réforme de l’État aménage quelque peu cette règle. Ainsi, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les entités fédérées jouissent d’un droit d’injonction positive. Voir aussi l’accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité. Cet accord organise les modalités suivant lesquels les directions contraignantes adressées au ministère public seront arrêtées dans les matières relevant des compétences des Régions et des Communautés (Doc. Parl., Parlement Wallon, sess. 2013-2014, n°1029-1030).
[18] Constitution, art. 151.
[19] Constitution, art. 151.
[20] M. Adams, « Vrijheid en verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht », in Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 142-143 – X. De Riemaecker et G. Londers, « La place du pouvoir judiciaire dans l’État et son corollaire, l’indépendance des magistrats », in X. De Riemaecker et G. Londers (dir.), Statut et déontologie du magistrat, Bruxelles, La Charte, 2000, p. 29 – J.-F. van Drooghenbroeck et S. van Drooghenbroeck, « Les garanties constitutionnelles de l’indépendance de l’autorité judiciaire », in E. Dirix et Y.-H. Leleu (dir.), The Belgian reports at the Congress of Utrecht of the International Academy of Comparative Law, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 548
[21] Constitution, art. 152.
[22] Pour les juges, Constitution art. 151§4 ; pour les officiers du parquet, Constitution art. 153.
[23] Constitution, art. 151§2.
[24] Pour les fins de ce rapport de recherche, nous nous appuierons essentiellement sur J. Bell, Judiciaries within Europe. A Comparative Review, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 46-106.
[25] Code judiciaire, art. 9.
[26] J. Bell, op. cit., p. 45.
[27] Sauf si le défendeur soulève, avant tout autre moyen (in limine litis), un déclinatoire de compétence (Code judiciaire, art. 568 §1 et §2). Cette prorogation de compétence ne vaut toutefois pas pour les compétences exclusives des autres juridictions.
[28] Date de l’entrée en vigueur de la loi portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse), le tribunal de première instance sera désormais composée (Code judiciaire, art. 76).
[29] Code judiciaire, art. 76. Ceci dit, seuls les tribunaux de première instance dont le siège est le ressort de la Cour d’appel comprennent une chambre d’application des peines.
[30] Code judiciaire art. 185/2.
[31] En Belgique, sont considérés comme « chefs de corps », « le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur du Roi, auditeur du travail, (…) premier président de la cour d’appel et de la cour du travail (…), procureur général près la cour d’appel et la cour du travail, (…) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation » (art. 58bis).
[32] Code judiciaire, art. 185/2, §5.
[33] Code judiciaire, art. 185/4. Il faut toutefois noter que le loi réserve un sort particulier à la Cour de cassation et au parquet général près la Cour de cassation dont les comités de direction négocieront directement leur financement avec le pouvoir politique.
[34] Sur ce point, voir K. Munungu Lungungu, « Le management judiciaire ou le glas de l’indépendance du juge ? Un éclairage de droit constitutionnel belge », B. Blero et K. Munungu Lungungu (coord. scient.), Le management de la justice : un défi à l’indépendance du juge ?, Revue de droit et de criminologie de l’ULB, 2014/1-2, à paraître. Trois recours sont actuellement formés contre cette législation devant la Cour constitutionnelle.
[35] I. Verougstraete et V. Lamberts, « Le dossier électronique : concept, création, gestion », in J.-F. Henrotte (coord.), Phénix et la procédure électronique, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 18-19.
[36] Projet de loi instituant le système d’information Phenix, Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, n°51, 1645/001 – Projet de loi modifiant l’article 610 du Code judiciaire, Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, n°51, 1646/001 – Projet de loi relatif à la procédure électronique, Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, n°51, 1701/001
[37] D. Mougenot, « La procédure par voie électronique – Les modifications de la procédure civile (Lois des 10 juillet et 5 août 2006) », J.T., 2007, p. 161.
[38] M.B., 1 septembre 2005.
[39] M.B., 7 septembre 2006.
[40] M.B., 7 septembre 2006.
[41] M.B., 22 décembre 2000.
[42] L. Guinotte, « L’informatisation de la justice (lois des 10 juillet et 5 août 2006). A quand la concrétisation? Quelles interactions entre celles-ci et le fichier central informatisé? », Ius & Actores, 2011, pp. 153-180.
[43] Ibid.
[44] M.B., 29 mai 2000.
[45] Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, M.B., 17 mars 2001. Sur ce point, voir infra.
[46] M.B., 12 septembre 2002.
[47] M.B., 15 juin 2006.
[48] J. Dumortier et C. Goemans, « How ‘Digital’ Are Belgian Courts? », M. Fabri et F. Contini (eds), Justice and Technology in Europe : How ICT is Changing the Judicial Business, Kluwer Law International, 2001, p. 126-127.
[49] Y. Poullet et D. Moreau, « La justice au risque de la vie privée », p. 87.
[50] I. Verougstraete et V. Lamberts, « Le dossier électronique : concept, création, gestion », in J.-F. Henrotte (coord.), Phénix et la procédure électronique, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 18-19.
[51] C. Fontaine, « Le point sur les derniers développements en matière de procédure électronique », Revue du droit des technologies de l’information, 2013, p. 24.
[52] Loi précitée du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix, art. 2.
[53] Ibid., art. 17.
[54] Ibid., art. 24§1er.
[55] Ibid., art. 27.
[56] Y. Poullet et D. Moreau, « La justice au risque de la vie privée », in Phénix et la procédure électronique, op. cit., n°26.
[57] Ce sont des motivations d’ordre constitutionnel qui ont imposé de scinder en deux lois le projet de loi unique à l’origine de ces deux législations. Sur ce point, C. Fontaine, op. cit., Revue du droit des technologies de l’information, p. 25.
[58] D. Mougenot, « La procédure par voie électronique – Les modifications de la procédure civile (Lois des 10 juillet et 5 août 2006) », J.T., 2007, p. 162.
[59] J.-F. Henrotte, A. Lefebvre, S. Dusollier, C. De Terwangne, « Éditorial. La réforme Phénix de la procédure : la réalisation d’un mythe ? », Revue du Droit des Technologies de l’Information, 2005, p. 4.
[60] D. Mougenot, ibid. – D. Vandermeersch, « Phénix à l’épreuve de la procédure pénale », Phénix – Les tribunaux à l’ère électronique, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 108-113.
[61] Loi du 10 juillet 2006, art. 4.
[62] D. Mougenot, « La procédure par voie électronique… », op. cit., p. 162.
[63] C. Zaiti, « Que devient le projet Phénix ? Suite et pas fin… », J.T., 2007, p. 410.
[64] Loi du 10 août 2005, art. 8 §2.
[65] Loi du 10 août 2005, art. 8 §3.
[66] Loi du 10 août 2005, art. 9.
[67] Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, « Rapport consacré à la question de la publication des décisions judiciaires. La plume, le Pélikan et le nuage », rapport du 30 juin 2014, disponible sur le site de la Commission.
[68] Loi du 10 août 2005, art. 10.
[69] Sur l’évaluation des juges judiciaires, voir Code judiciaire, art. 259nonies.
[70] L. Guinotte, op. cit., p. 157.
[71] R.P., « Onkelinx jette Unisys hors du projet “Phénix” », La Libre.be, 8 mars 2007.
[72] Note de politique générale du Ministre de la Justice, Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2008-2009, 5 novembre 2008, p. 27-28.
[73] Hormis certains pans qui sont entrés en vigueur dans l’incompréhension générale.
[74] Comité de gestion “Informatique de l’Ordre judiciaire”, Rapport d’activités de l’année 2010. H. Van Bossuyt, « L’informatisation de la justice en Belgique », J.T., 2009, p. 678.
[75] Comité de gestion “Informatique de l’Ordre judiciaire”, ibid.
[76] Rapport précité de la Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire.
[77] Il faut dire que depuis l’adoption des lois Phénix (2005-2006), cinq ministres différents se sont succédés à la tête du service public de la justice, à savoir Laurette Onkelinx (socialiste), Jo Vandeurzen (socio-démocrate), Stefaan De Clerck (socio-démocrate), Annemie Turtelboom (libérale) et, aujourd’hui, Maggie de Block (libérale).
[78] S. de Biolley, « La vidéoconférence pénale. État des lieux et des recherches scientifiques en Europe et en Belgique », Rev. Dr. Pén. Crim., 2010, p. 1096-1116 – S. de Biolley, « La vidéo-comparution en Belgique : une solution sans problème », Déviance et Société, 2013, p. 305-321.
[79] S. de Biolley, « La vidéoconférence pénale. État des lieux et des recherches scientifiques en Europe et en Belgique », Rev. Dr. Pén. Crim., 2010, p. 1097.
[80] S. de Biolley, « La vidéoconférence pénale. État des lieux et des recherches scientifiques en Europe et en Belgique », Rev. Dr. Pén. Crim., 2010, p. 1097.
[81] C. De Valkeneer, Manuel de l’enquête pénale, Larcier, 2010, p. 199.
[82] La « vidéoconférence » procède d’un anglicisme du terme videoconferencing.
[83] Voir infra.
[84] Cette disposition s’applique également aux mineurs victimes ou témoins de certaines infractions pénales spécifiques mais qui ont atteint la majorité au moment de l’audience (lecture conjointe des articles 190bis et 92 du Code d’instruction criminelle).
[85] Une disposition similaire existe pour la procédure devant la Cour d’assises (Code d’instruction criminelle, art. 311).
[86] Code d’instruction criminelle, art. 190bis.
[87] C. De Valkeneer, Manuel de l’enquête pénale, Larcier, 2010, p. 207.
[88] Il convient de signaler que le juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire sur ce point. Il doit spécialement indiquer les raisons qui justifient la comparution du témoin mineur (C. De Valkeneer, ibid).
[89] Code d’instruction criminelle, art. 190bis.
[90] Code d’instruction criminelle, lecture conjointe des articles 190bis et 91bis.
[91] Code d’instruction criminelle, art. 190bis.
[92] Code d’instruction criminelle, art. 190bis.
[93] Voir les articles 92 et suivants du Code d’instruction criminelle.
[94] M.B., 12 septembre 2002.
[95] Exposé introductif du Ministre de la justice, Projet de loi relatif à l’enregistrement de déclaration au moyen de médias audiovisuels, Rapport fait au nom de la Commission, Doc. Parl., Chambre des représentants, 50-1590/004, p. 3
[96] Projet de loi relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels, rapport fait au nom de la commission de la justice par Mmes De Schamphelaere et Taelman, Doc. Parl., Sénat de Belgique, 2001-2002, n°2-1155/3, p. 5.
[97] Code d’instruction criminelle, art. 112. Il convient de signaler que tant le procureur du Roi que le juge d’instruction peut également décider d’entendre un témoin qui bénéficie d’une mesure de protection par la Commission de protection des témoins par le biais d’un circuit de télévision fermé. Il s’agit d’une « liaison, dans un même bâtiment, entre deux locaux où dans l’un se trouve l’autorité qui procède à l’audition et dans l’autre le témoin » (C. De Valkeneer, op. cit., p. 199). Cette possibilité n’existe toutefois pas devant les juridictions de fond.
[98] Pour peu qu’il existe un accord de réciprocité avec l’État où se situe cette personne.
[99] Code d’instruction criminelle, art. 298 (pour la Cour d’assises), art. 158bis (pour le tribunal de police et, par extension [art. 189], pour le tribunal correctionnel).
[100] L. Kennes, op. cit., p. 31.
[101] L. Kennes, op. cit., p. 120.
[102] Code d’instruction criminelle, art. 158bis et 317quater. S. De Biolley, « La visioconférence pénale… », op. cit., p. 1103.
[103] L. Kennes, op. cit., p. 119 – C. De Valkeneer, op. cit., p. 205.
[104] Pour une recension récente de ces valeurs en matière pénale, voir M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, la Charte, 2012, p. 8-28.
[105] C. De Valkeneer, ibid.
[106] B. De Smet, « Videoconferenties voor verdachten en beklaagden », R.W., 2009-10, p. 1458-1467.
[107] M. Chiavario, « La vidéoconférence comme moyen de participation aux audiences pénales », commentaire de Cour européenne des droits de l’homme (3e section), Marcello Viola c. Italie, 5 octobre 2006, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2008, p. 223-237 – S. de Biolley, « La vidéoconférence pénale. État des lieux et des recherches scientifiques en Europe et en Belgique », Rev. Dr. Pén. Crim., 2010, p. 1105-1110.
[108] S. de Biolley, « La vidéoconférence pénale. État des lieux et des recherches scientifiques en Europe et en Belgique », Rev. Dr. Pén. Crim., 2010, p. 1104.
[109] Cass., 25 janvier 2008, Pas., 2008, pp. 217 et 218
[110] D. Mougenot, « Peut-on former une demande en récusation par voie électronique ? », commentaire sous Cass., 25 janvier 2008, P.&B., 2008, p. 217-221.
[111] Proposition de loi visant à instaurer la comparution des détenus devant les juridictions d’instruction par vidéoconférence, déposée le 18 octobre 2007 par Christine Defraigne, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 2007-2008, n°4-287/1.
[112] Proposition de loi relative à l’utilisation de la vidéoconférence par la comparution d’inculpés en détention préventive, déposée le 27 septembre 2013 par M. Koenraad Degroote et Mmes Daphné Dumery, Sarah Smeyers et Kristen Van Vaerenbergh, Doc. Parl., Chambre des représentants, n°53-3030/001.
[113] Ibid., p. 3.
[114] S. de Biolley, « La vidéo-comparution en Belgique : une solution sans problème », Déviance et Société, 2013, p. 315.
[115] Voir H. Louveaux, « Dossier prison. Siéger à la prison, comparaître par Skype… Et les droits fondamentaux dans tout ça ? », Justine, n°39, juin 2014, p. 4.
[116] Lettre ouverte au gouvernement fédéral, 3 juillet 2012, http://www.liguedh.be/2012/1511-sos-justice.
[117] La Belgique a notamment connu une crise politique hors du commun en 2010-2011.