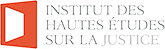De l’exaltation de l’office du juge à sa limitation, Boris Bernabé, professeur d’histoire du droit à l’université de Franche-Comté et chercheur associé à l’IHEJ, a distingué, au cours de cette première séance du séminaire sur l’office du juge, les temps forts d’une évolution remontant à l’Antiquité romaine.
L’office du juge se situe au cœur de la réforme du code de procédure civile de 1975. Éminent professeur de droit et l’un des principaux rédacteurs du projet, le doyen Gérard Cornu en explique la place prépondérante : « L’une des tendances majeures du code est d’exalter l’office du juge, non seulement dans la marche de l’instance pour son bon déroulement (…) mais sur la matière du procès dans l’exercice plénier du pouvoir juridictionnel » [1].
La pratique est cependant allée dans le sens inverse de cet esprit, et ce, particulièrement depuis le milieu des années 1990. Ce fût le cas notamment avec le décret de 1998 qui modifie les articles relatifs à l’assignation en imposant que la demande soit argumentée en fait et en droit. Un autre exemple en témoigne encore une décennie plus tard : l’arrêt de la Cour de cassation rendu en 2007 qui encadre et réduit le champ de l’article 12 du code [2].

Cet arrêt met une sorte de point final à cette évolution jurisprudentielle qui tend à restreindre les pouvoirs du juge civil sur le droit. De manière explicite, la Cour affirme que le juge ne dispose pas du pouvoir de requalification d’office. Elle place donc désormais le juge en retrait dans le procès, et presque exclusivement entre les mains des parties. Il s’agit donc d’une réduction considérable de l’office du juge depuis 1975 au profit de la rigueur de la règle, tout le contraire donc de la nature historique de l’office du juge, celle issue de la construction des siècles.
Comment analyser cet écart entre 1975 et aujourd’hui ? Comment expliquer la vision des rédacteurs du nouveau code de procédure civile, celle d’une exaltation de l’office du juge tournée autour de l’équité ? Comment expliquer à l’inverse la volonté récente de réduire cet office du juge de la part de la Cour de cassation elle-même ? Pour Boris Bernabé, cette évolution s’explique par des raisons historiques dont il distingue trois temps forts : l’Antiquité romaine, le Moyen-Age et l’entrée dans la modernité.
L’Antiquité romaine ou les méandres de l’office du juge
A l’époque romaine, deux moments se succèdent. Au long de la première phase qui se situe avant l’entrée en vigueur de la procédure impériale dite « extraordinaire » (du IIIème siècle avant notre ère à la fin de Ier siècle de notre ère), le schéma procédural se joue devant deux personnages distincts. Dans le cadre de la procédure archaïque comme dans celui de la procédure classique, le premier temps du procès se passe devant celui que les Romains nomment le magistrat ou le « prêteur », qui a des pouvoirs politiques, militaires et religieux. Ces pouvoirs se développent grâce à trois éléments dont il est dépositaire : l’auctoritas – la force (d’essence religieuse), la potestas – le pouvoir (la légitimité) – et l’imperium, qui est la mise en œuvre de la potestas (le commandement). Le magistrat, à Rome, est celui qui octroie l’action. Sans passage devant ce magistrat, il est donc impossible de faire valoir un droit. Une fois que cette action est octroyée, le magistrat accorde aux parties le droit de passer devant un juge. C’est alors le second temps du procès qui se tient devant le judex (le juge). Durant la période pré-classique ou archaïque, le juge est un particulier et bénéficie d’une marge d’appréciation. Il est l’arbitre, celui qui voit sans être vu, et qui apprécie en fonction des circonstances le droit qui a été déduit par le magistrat.
Mais avec l’arrivée de la période classique, c’est-à-dire de la procédure formulaire, le juge ne pourra plus apprécier la cause du point de vue de l’équité, il est désormais limité par la formule, qui est un texte rédigé par le magistrat avec les parties, contenant la demande et les moyens de défense. Il n’a ni auctoritas, ni potestas, ni imperium.
Au cours de cette période, on constate donc un transfert d’équité. Le mot « justice » est très peu employé, on parle d’equitas : le jus est un vocable religieux (adéquat à la loi des dieux) très rigide qui s’oppose souvent à la justice. C’est pourquoi on retrouve souvent, en particulier chez Cicéron, la formule suivante : « Plus rigoureux est le droit, plus grande sera l’injustice ». A partir du second siècle de notre ère, l’équité est donc mise en œuvre pour tempérer la rigueur du droit. Or la capacité d’agir en équité devait nécessairement être offerte à un tiers autoritaire (doté de l’auctoritas), c’est donc au magistrat que revient le pouvoir d’exercer une part d’équité et non plus au juge.
Arrivent ensuite, sous l’Empire, la procédure extraordinaire et la construction pyramidale d’une administration. Une situation ambiguë, que nous connaissons bien encore aujourd’hui, se met alors en place : le juge est aussi un magistrat. On retrouve dans cette figure du juge-magistrat, celui qui a l’auctoritas, délivre le droit, recherche la vérité et offre les garanties procédurales, mais également celui qui tranche le procès. C’est l’Empereur qui est source de la légitimité des juges, il est le premier juge comme le premier magistrat, et il leur délègue l’auctoritas, la potestas et l’imperium. Dans cette construction pyramidale de la justice, la loi n’est pas interprétable par les juges mais uniquement par l’Empereur. Seuls quelques juristes peuvent, sur délégation expresse de l’Empereur, interpréter la loi : ce sont les professeurs, les « prudents » – dont les interprétations lient le juge – d’où la naissance du mot « jurisprudence ». L’office du juge impérial est donc assez technique puisqu’il est soumis à la parole impériale. Les Institutes le rappellent sous Justinien : « Le juge ne doit juger que conformément aux lois, aux constitutions du Prince et aux coutumes ».
Nous assistons alors à l’abandon d’une vision cicéronienne sur les « vertus ». Dans Les devoirs, Cicéron traite des devoirs non seulement du juge, mais du citoyen, et le premier de ces devoirs est la justice dont le fondement est la bonne foi. À l’époque impériale, c’est le Prince qui met en place l’organisation judiciaire et les conditions du procès équitable. L’Empereur chrétien Justinien est par exemple à l’origine du mécanisme de récusation (la suspicio) et de la loyauté dans le procès par l’instauration du serment dit « de calomnie ».
Ce rapport à l’auctoritas sous Justinien est redécouvert au XIIème siècle, au moment où les seigneurs s’affrontent et cherchent les moyens juridiques de leur domination. C’est à cette époque, à Bologne, que l’on retrouve les textes romains. C’est sûrement aussi l’un des plus grands épisodes de l’histoire du droit.
Le retour de l’équité au Moyen Age
Au Moyen Age, le juge est plus qu’un simple garant comme il pouvait l’être dans le droit romain impérial, il représente l’autorité. Non seulement il garantit une équitable procédure, mais il permet que le procès soit légitime. Il est en effet celui qui reçoit le serment de calomnie (où les parties jurent de ne pas agir malicieusement avec les autres parties), il est comme un prêtre garant d’autres serments. Son office est un ministère (comme celui du prêtre) : le procès est un rite dont l’objet final est que la vérité resplendisse. Dans sa quête, le juge-magistrat est doté de pouvoirs spéciaux. Le juriste Guillaume Durand décrit cet office étendu du juge médiéval grâce notamment à son pouvoir inquisitorial : il a l’obligation d’enquêter, d’engager une pleine recherche, de jauger la qualité des témoins et éventuellement, d’en récuser certains. Il peut accorder des délais et doit rendre la justice gratuitement. Tous les verbes utilisés par Durand traduisent l’autorité dont est dépositaire le juge médiéval. L’équité revient donc au cœur de l’office du juge après l’éclipse du droit romain impérial, et ce, à travers l’auctoritas.
Pour repenser l’office du juge médiéval, les juristes de l’époque (Tancrède, Durand, Thomas d’Aquin, Beaumanoir) redécouvrent Aristote et sa conception de la justice. Les deux grands canonistes du Moyen Age, Tancrède de Bologne et Guillaume Durand, distinguent deux offices : l’office noble (qui s’exerce indépendamment de toute demande et s’appuie sur le pouvoir inquisitorial du juge – cet office a notamment permis de pourchasser d’office les hérétiques) et l’office mercenaire (qui est au contraire au service de l’action – cet office permet par exemple au juge, une fois le procès engagé, de donner un avocat à la partie qui n’en a pas, garantissant ainsi le procès équitable). Au XIIIème siècle, Saint Thomas écrit sa Somme théologique : il utilise l’Ethique à Nicomaque d’Aristote (lié à un système mathématique, de proportion) alors que les Romains avaient utilisé la Réthorique (lié à l’individu, au cas particulier).
À la même époque, Beaumanoir, bailli royal (juge de première instance), rédige en 1284 Les coutumes de Beauvaisis en s’inspirant toutefois très largement du droit romain et du droit canonique. La qualité première du juge est la sagesse (sapiens) qui recouvre l’équité, à la fois substantielle (statuer en équité) et procédurale (garantir le procès équitable). Le juge doit également être loyal, c’est-à-dire ne pas être plus favorable à une partie plus qu’à l’autre. Il doit être sans amour et sans haine, sans convoitise et sans peur. C’est le retour des vertus du juge dans l’office grâce aux apports de Saint Thomas d’Aquin. La loi est ainsi corrigée par l’équité aristotélicienne selon le cas d’espèce.
A partir de là s’instaure un jeu ambigu entre les juges et le roi. Le roi protège les juges de la malice des plaideurs, mais il les contraint aussi et ce, d’autant plus à mesure que son pouvoir augmente à partir du XIIIème siècle et jusqu’à la Révolution. Cette ambiguïté nourrit toute la modernité.
L’époque moderne et les derniers soubresauts
A l’époque moderne, les juges prennent leur indépendance par rapport au pouvoir royal. Ils deviennent propriétaires de leurs charges : grâce au système de la patrimonialité des offices, le roi ne peut plus les révoquer. Ils agissent au départ à la fois au nom du bien commun et pour le roi. Pourtant commencent à apparaître des ouvrages de morale judiciaire et des ouvrages de procédure rédigés par ces juges devenus indépendants. C’est l’office du juge qui transparait à travers ces ouvrages. À l’audience, le juge doit avoir une bonne apparence (par exemple avoir une barbe pleine et fournie, ne pas être parfumé à l’excès, ni trop bien habillé). Le roi, quant à lui, est prisonnier d’un ordre qui le fait premier juge et non premier législateur. Il faudra attendre la Révolution pour que le souverain soit le législateur et non pas le juge.
La Révolution va définitivement trancher dans le sens de la séparation des pouvoirs et des autorités. Elle met également fin à la figure du juge-prêtre pour en faire un juge-automate. S’agissant de l’appel par exemple, les révolutionnaires mettent en place un système circulaire et non pas hiérarchique pour ne surtout pas recréer un esprit de corps [3]. La révolution instaure donc le légicentrisme, la toute puissance de la loi : le juge a défense d’interpréter la loi (avec le mécanisme du référé législatif), il applique littéralement la loi. Juger n’est plus un métier.
Avec les codes Napoléon, le code civil (1804) et le code de procédure civile (1806), la révolution contre la justice est faite et les juges sont mis au pas. Le préambule du projet de code civil de Portalis explique toutefois que le fait d’avoir automatisé la fonction de juger a été une grande erreur dans la mesure où la loi est excellente : si la loi est générale et impersonnelle, alors il faut un juge pour l’interpréter au regard du cas particulier. Cette vision de Portalis n’est pas pour autant un retour à l’Ancien Régime puisque le juge du XIXème siècle est pleinement maîtrisé, son office est désormais procédural. « La juridiction, jurisdictio, est le pouvoir du juge, la compétence est la mesure de ce pouvoir » résume ainsi Boncenne dans sa Théorie de la procédure civile (1828).
Ce légicentrisme va ensuite être mis de côté par les rédacteurs du code de procédure civile de 1975. C’est d’ailleurs par un règlement que ce code a vu le jour, et c’est essentiellement la doctrine qui en fût à l’origine (Foyer, Motulski). La loi ne fait donc pas la procédure. Mais si l’équité refait surface, quelle est-elle ? Et comment éviter l’arbitraire ? L’équité est ce qui permet de corriger la loi en fonction du cas particulier, ce qui implique alors que la loi soit parfaite, c’est-à-dire générale, abstraite et impersonnelle. Trois qualités qui aujourd’hui font de plus en plus défaut à la loi promulguée. L’arbitraire, quant à lui, est contenu par les principes procéduraux qui consacrent, dans le code de procédure civile, « le procès équitable à la française ».
Avec l’avènement du code de 1975, c’est un office renouvelé du juge que l’on voit apparaître qui s’oppose à l’empire de la loi. Depuis lors, la loi a pourtant très vite repris ses droits par le truchement non seulement du pouvoir règlementaire, mais également des juges eux-mêmes. L’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 en est sans doute l’exemple le plus topique.
Edouard Jourdain et Claire Finance
> Télécharger les extraits des œuvres citées