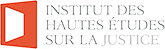À quelques semaines des prochaines élections au Parlement européen, nous poursuivons la publication d’une série d’articles consacrée à “l’idée d’Europe”. « L’idée d’Europe » était le thème du séminaire d’initiation à la philosophie politique organisé par l’École nationale de la magistrature entre le 28 janvier et le 1er février 2019, avec l’IHEJ et la revue Esprit. Ce texte est adapté d’une conférence préparée à cette occasion. Les auteurs se tournent vers l’époque contemporaine, pour éclairer les défis auxquels l’Europe est aujourd’hui confrontée. Ainsi, Pierre Vimont propose ici de déplacer le regard de l’idée d’Europe à l’idée d’Union européenne : quelle a été la dynamique de l’intégration européenne, pourquoi est-elle cassée et que faudrait-il transformer, en profondeur, pour pouvoir la relancer ?
—
L’Europe est en panne. Tous ceux qui s’intéressent au projet européen, qu’ils le soutiennent ou le critiquent, en font le constat. Les mêmes divergent pourtant lorsqu’il s’agit d’en expliquer les blocages. Plus particulièrement, la nature exacte de l’inertie dans laquelle l’Europe s’enlise, ses causes et ses conséquences pour l’avenir de l’Union européenne, nourrissent de multiples réflexions, souvent contradictoires, mais qui toutes laissent ouverte, faute d’une solution réellement convaincante, la réponse à apporter pour sortir l’Europe de l’ornière. Il manque dans ces efforts d’explication une « grille de lecture » capable d’aider les dirigeants européens à dissiper le sentiment d’impuissance et d’immobilisme qui fait douter de la capacité du système européen à rebondir.
Dans cette perspective, mettre l’accent sur le processus d’intégration tel qu’il s’est développé depuis l’origine du projet européen offre l’avantage d’une démarche aussi objective que possible, délivrée des préjugés idéologiques qui trop souvent accompagnent la réflexion sur l’UE. De fait, les débats éternellement recommencés sur la définition d’un authentique fédéralisme européen n’ont jamais pu aboutir, faute d’un minimum de consensus entre les membres de cette Union, et son élargissement progressif à 28 pays n’a fait que compliquer cette discussion. En revanche, pendant longtemps, la volonté partagée par les dirigeants des États membres de faire avancer de manière pragmatique leur intégration commune a su tracer un chemin. Par des partages de souveraineté dans des domaines de compétence de plus en plus élargis et par des progrès réels dans la mise en place de politiques communes, cette démarche de type fonctionnaliste, prônée par les pères fondateurs, a permis d’avancer sur la voie de « l’ Union sans cesse plus étroite » inscrite dans le préambule des traités européens. On lui doit la plupart des avancées de l’Europe au cours des soixante dernières années, et c’est bien parce que cette démarche paraît aujourd’hui rencontrer ses limites que la question se pose la question de savoir si cette perte d’efficacité correspond à une baisse de régime ou si cette panne ne serait pas plutôt le symptôme d’un dysfonctionnement plus profond. Crise conjoncturelle ou bouleversement de nature structurelle nécessitant le passage à un autre modèle d’intégration, ces deux interprétations sous-tendent le débat actuel sur l’Europe et éclairent les choix à faire pour relancer l’entreprise européenne.
Les trois phases de l’intégration européenne
L’histoire de l’intégration européenne s’est inscrite autour de trois périodes aux caractéristiques bien marquées : la phase de construction (1958-1984), les « vingt glorieuses » (1985-2004) et la période de crises qui, à partir de 2008, a constitué le paysage devenu malheureusement familier dans lequel l’Europe se débat aujourd’hui.
La première étape de ce long cheminement part de l’adoption du traité de Rome et s’étend jusqu’à l’accord sur la contribution budgétaire du Royaume-Uni. Elle permet la mise en place des premières politiques communes à travers de difficiles négociations entre la France qui défend les intérêts de son agriculture et l’Allemagne qui prône le développement de son industrie. Au milieu de divergences idéologiques profondes entre les partisans d’une approche fédérale ambitieuse et ceux d’une conception inter-gouvernementale de l’intégration, elle définit non sans mal les grands principes de son fonctionnement (le « compromis de Luxembourg »), complète son organisation institutionnelle (installation du Conseil européen, élections directes au Parlement européen), procède à un premier élargissement (Royaume-Uni, Irlande, Danemark) et s’essaye timidement à quelques pas dans le domaine de la politique étrangère (institution de la coopération politique européenne). Cette période ne connaît pas de traité autre que le traité de Rome et l’essentiel des grands principes du droit communautaire qui s’imposent alors s’élabore à partir des arrêts de la Cour Européenne de Justice et non par l’intermédiaire des États eux-mêmes. L’esprit qui anime les négociateurs d’alors relève d’un libéralisme économique assez classique (baisse des droits de douane entre les pays de l’Union), tempéré par le souci de protéger les intérêts externes de ce nouvel ensemble et ceux, internes, de chaque membre, qu’il s’agisse de l’agriculture, de la pêche ou de la sidérurgie. Enfin, l’action extérieure de l’Europe reste marquée pour l’essentiel par une vision postcoloniale de ses intérêts, focalisée sur le voisinage immédiat des partenaires de l’Afrique et des pays méditerranéens.
Dans la deuxième phase de l’intégration européenne, la construction européenne passe à un nouveau stade de développement, plus intégré et plus large, en phase avec le mouvement de globalisation de l’économie mondiale. Le projet européen se renforce et s’approfondit (personnalité morale de l’Union, marché unique, union économique et monétaire, accord de Schengen et conventions de Dublin, développement des politiques judiciaire ou environnementale). Les traités se succèdent, jusqu’au traité de Lisbonne adopté en 2009 ; les compétences et l’activité législative de l’Union se développent ; les élargissements se multiplient avec le passage de 10 à 28 membres. Les compétences européennes s’étendent et embrassent pratiquement tous les champs de l’action publique. Parallèlement, l’activité législative de l’Union, induite par l’achèvement du marché intérieur, tourne à plein : ce sont les riches heures de la méthode communautaire, où la Commission propose les textes que le Conseil des ministres et le Parlement européen approuvent au terme de longues négociations, souvent difficiles mais en général fructueuses. L’esprit qui domine est celui de l’adaptation de l’économie européenne à la concurrence mondiale, et l’affirmation de son modèle de puissance normative sur la scène internationale. On parle moins de protection que d’ouverture des réseaux publics à la compétition et d’accords de libre-échange. En matière de politique étrangère et de sécurité, l’Europe s’aventure au-delà de son simple voisinage et se voit en nouvel acteur global, capable d’imposer son modèle de puissance normative sur l’ensemble de la scène internationale. Javier Solana peut alors écrire, dans la stratégie européenne de sécurité qu’il présente en 2003, que l’Europe « n’a jamais été aussi prospère, aussi sûre, ni aussi libre » et qu’elle est en mesure d’apporter une contribution majeure aux défis de notre monde.
La troisième et actuelle phase constitue un réveil douloureux. Déstabilisée par la crise financière de 2008, prise entre les soubresauts d’un ordre économique mondial en pleine mutation sous l’effet de la concurrence croissante de la Chine et des autres pays émergents, et la lente transformation du paysage géopolitique planétaire, l’Union européenne repousse non sans mal les crises de toutes sortes qui l’assaillent (dette grecque, immigration, terrorisme). Dans le même temps, elle observe avec impuissance la montée dans les États membres d’une vague nationaliste et populiste qui conteste jusqu’aux principes mêmes du projet européen. Le référendum britannique de 2016 ouvre pour la première fois la voie au retrait d’un pays membre et introduit un doute existentiel au cœur de l’Union, qui semble découvrir la possibilité de sa propre fin. Face à ces ferments de désintégration, l’heure n’est plus à l’expansion ni au libéralisme triomphant. Sur les trois fronts déjà mentionnés, les différences avec la phase précédente sont criantes : l’idée même d’un nouveau traité paraît hors de propos tant son éventuelle ratification par les pays membres semble irréaliste dans l’atmosphère générale d’euroscepticisme ; la prolifération législative qui avait dominé les années antérieures est désormais sous étroite tutelle de la Commission elle-même. Un discours plus en ligne avec les inquiétudes des citoyens européens commence à apparaître ; la nécessité d’une plus grande protection face à la concurrence internationale est ouvertement affichée et le thème de l’Europe sociale reprend des couleurs. Enfin, la diplomatie européenne rencontre ses limites ; elle doit rabattre de ses prétentions et procéder à des ajustements pour tenir compte d’une volonté croissante des pays membres d’agir sans grande discipline collective.
Sortir de cette phase d’inertie et du sentiment grandissant que l’Europe n’a plus les ressources nécessaires pour rebondir est aujourd’hui l’objectif affiché par les responsables européens. L’agenda de Bratislava, adopté peu après le référendum du Brexit, le Livre Blanc de la Commission détaillant les possibles options pour relancer le processus d’intégration européen, les réflexions esquissées par les différents responsables de l’Union invités à venir présenter leurs idées sur l’avenir de l’Europe au Parlement de Strasbourg, le sommet informel de Sibiu prévu en mai de cette année pour avancer sur de nécessaires réformes sont la manifestation de cette fébrilité qui a gagné l’ensemble de la classe dirigeante européenne. Cette période de doute et d’interrogation produit une curieuse contradiction : les divisions politiques paraissent s’accentuer entre les gouvernements de sensibilité populiste et leurs homologues pro-européens qui s’opposent de plus en plus rudement entre eux; en revanche, une unité exemplaire domine parmi les 27 membres de l’Union dans la négociation avec le Royaume-Uni sur le retrait britannique. L’explication tient sans doute à l’intérêt que ces pays trouvent dans l’appartenance à l’Europe, laquelle garde suffisamment d’attrait pour surmonter le sentiment que l’Union, loin de faire la force, fonctionne aujourd’hui à rebours de sa vocation initiale et se métamorphose en une source de faiblesse.
Les ferments d’une transformation en profondeur
Mieux comprendre les raisons de cette panne du processus d’intégration devient alors essentiel pour retrouver la voie d’un réel progrès européen. Les raisons de l’immobilisme voire du délitement qui semble gagner aujourd’hui le projet européen ont été souvent exposées : le contexte mondial marqué par l’émergence d’un nouvel ordre économique et géopolitique dans lequel l’Europe peine à trouver sa place ; les effets de plusieurs vagues d’élargissement qui ont profondément modifié le fonctionnement des institutions sans que toutes les conséquences en aient été tirées ; la nature même des négociations conduites à Bruxelles et des compromis obtenus, marqués par une approche diplomatique trop classique, produisant des résultats incertains là où les intérêts en jeu, de nature souvent économique, réclament des décisions plus tranchées et courageuses. Les difficultés de la zone euro lors de la crise financière de 2008 ou les faiblesses des règles européennes en matière de droit d’asile face à la vague migratoire de 2015 sont là pour souligner les limites d’un processus de décision qui a trop souvent conduit les négociateurs de l’Union monétaire ou des accords de Dublin – au demeurant en pleine connaissance de cause – à éviter les choix difficiles au risque de conduire à des réveils douloureux. Il faut cependant se demander si les difficultés auxquelles est confronté le processus d’intégration européen ne correspondent pas à des bouleversements plus profonds qui traduisent une incapacité d’adaptation à des défis touchant au cœur même du projet européen. Deux de ces défis méritent une particulière attention.
Le premier est d’ordre interne. Il concerne le passage d’un système européen jusqu’à présent géré de manière essentiellement technocratique à un processus désormais directement soumis aux enjeux politiques discutés dans les pays membres. La voie technocratique était probablement justifiée dans les premières phases de la construction européenne afin de réaliser les objectifs de réconciliation et de rapprochement entre les nations européennes, qui n’allaient pas de soi dans un contexte encore marqué par les affrontements de la guerre. Les termes du débat public sont aujourd’hui d’une autre nature. Ils portent sur de nouveaux enjeux, tout particulièrement la capacité de l’Union à défendre son modèle politique, économique et culturel dans le monde, et s’inscrivent dans un contexte politique profondément renouvelé. Les débats politiques nationaux sont en effet désormais étroitement imbriqués dans la négociation européenne et l’inverse est tout aussi vrai, annonçant probablement des réalignements à venir parmi les partis politiques d’un certain nombre de pays membres. L’espace politique, longtemps confiné au seul niveau national, s’est élargi à l’ensemble de l’Union ; il manifeste une vigueur plus prometteuse que beaucoup de propositions artificielles faites dans le passé pour animer au niveau européen un débat démocratique qui n’a jamais vraiment pris forme. À sa manière, cette Europe qui fait enfin de la politique représente une réponse aux critiques passées sur le déficit démocratique du système européen. On peut penser que cette réalité-là ne cessera plus de se développer. Elle prendra des formes variées et les échanges souvent vifs que l’on observe aujourd’hui entre dirigeants français, hongrois, italiens ou polonais doivent être compris comme les premières manifestations de ce nouvel espace politique européen. Cette transformation ne se fera pas sans peine ; elle obligera les responsables politiques nationaux à inventer des pratiques nouvelles, peut-être même à organiser différemment leurs débats au sein du Conseil européen, appelé plus que jamais à être le théâtre central de cette politisation de l’Europe. Pour autant, cette évolution marque bien les débuts d’un vrai débat démocratique européen.
L’autre défi est de nature externe et porte sur la capacité de l’Union à préserver sa différence dans un monde où son modèle de civilisation et son génie créatif sont remis en cause par l’émergence de nouveaux partenaires. Cette menace exige une prise de conscience collective mais surtout une mobilisation résolue, dans plusieurs directions. L’Europe ne doit pas perdre la bataille de la croissance ; pour ne pas être distancée par ses concurrents, elle doit continuer d’être à la pointe de l’innovation technologique. Il lui faut également définir un modèle économique et social rénové, plus équilibré que l’approche libérale des trente dernières années, capable de renouveler les principes et les modalités de l’État-providence telles qu’ils ont été définis par les nations européennes depuis 1945. L’objectif ici est de garantir aux citoyens européens une meilleure protection face à des concurrents qui ont sérieusement entamé le pouvoir d’achat des classes moyennes en Europe au cours des dernières années. C’est donc d’un nouveau logiciel de pensée que les institutions de Bruxelles doivent se doter, à la recherche d’un meilleur équilibre entre l’indispensable ouverture et la nécessaire protection. C’est à l’aune de ces considérations que l’Union doit revisiter les champs de son action, du commerce extérieur à l’immigration en passant par les règles de la concurrence, la fiscalité, la recherche, l’environnement ou la politique sociale.
Enfin, l’Europe doit se montrer prête à affronter les défis que lui posent sur la scène internationale les grands acteurs globaux que sont la Chine, la Russie et de plus en plus, les États-Unis du Président Trump. Plus encore que de la mise en place des moyens nécessaires dans le domaine militaire, diplomatique ou économique pour résister à la pression de ces partenaires/adversaires, il s’agit pour les Européens de savoir quel type de puissance ils entendent devenir et quel rôle ils souhaitent se donner dans cet environnement planétaire en pleine mutation. Trop longtemps, l’Union s’est vue comme un acteur à vocation universelle, partenaire privilégié des Nations Unies, « puissance douce » qui s’en remettait à la force de ses valeurs et de ses normes pour faire triompher ses vues. Cette conception de l’action internationale de l’Europe ne suffit plus. Pour faire respecter ses intérêts, l’Union européenne ne doit pas seulement se doter des moyens économiques, diplomatiques et militaires qui lui ont manqué dans le passé. Elle doit surtout se concevoir comme une puissance à part entière, consciente des défis géopolitiques auxquels elle doit faire face et capable de définir une stratégie à la hauteur de ces enjeux. Il est loin d’être acquis que tous les pays membres soient prêts à se ranger derrière cette vision d’une « Europe puissance » que la France appelle de ses vœux depuis longtemps et que ses partenaires ont eu tendance à voir, non sans inquiétude, comme une volonté d’indépendance à l’égard des États-Unis. La nouvelle poussée d’unilatéralisme américain sous l’influence de Donald Trump crée l’occasion pour les nations européennes de reprendre cette discussion, sans garantie de succès mais avec un sentiment d’urgence nouveau. Il est clair en tout cas que de l’issue de ce débat dépend très largement la capacité de l’Europe à réussir sa transformation.
Une nouvelle impulsion ?
L’urgence de cette transformation constitue aujourd’hui un sentiment assez largement partagé parmi les responsables européens. Ceux-ci peuvent être en désaccord sur l’objectif final de cette évolution, selon qu’ils souhaitent plus (Emmanuel Macron) ou moins (Victor Orban) d’intégration. Aucun ne conteste le besoin d’une vraie réforme de fond. Or c’est bien à ce niveau de responsabilité que les décisions doivent être prises pour rendre son élan au processus d’intégration. Nombreux doutent de l’aptitude de ce corps collectif de dirigeants à retrouver une volonté commune ou, plus simplement, à imaginer le chemin forcément incertain et compliqué pour aborder efficacement cette nouvelle étape de la construction européenne. Aussi est-il temps peut-être de penser à de nouveaux schémas d’intégration.
Dans le long cheminement de l’intégration européenne depuis le traité de Rome, une réflexion s’est déjà progressivement imposée, renouvelant les débats anciens et introduisant de nouvelles problématiques. Au début de la construction européenne, l’affrontement s’est fait pour l’essentiel entre les partisans d’une approche fédérale classique, sur le modèle américain, et ceux qui souhaitaient préserver les prérogatives des États membres. Les oppositions se sont alors cristallisées autour des pouvoirs de la Commission et du Parlement, tels que prévus dans le traité, avec l’objectif de donner à ce couple institutionnel les attributions classiques d’un pouvoir exécutif et législatif en régime parlementaire, les États étant peu à peu relégués dans un rôle de deuxième chambre. Aujourd’hui encore, cet objectif fédéral a ses instruments : le monopole d’initiative de la Commission, le vote à la majorité qualifiée, les pouvoirs de contrôle du Parlement ; il peut également se prévaloir de réalisations concrètes avec des institutions comme la Cour de Justice de Luxembourg ou la Banque Centrale ou des politiques comme celle de la concurrence, qui n’hésitent pas, lorsque c’est nécessaire, à aller à l’encontre des souhaits des États. Pour autant, le débat sur l’avenir fédéral de l’Europe n’a cessé de perdre de sa force et de son actualité, notamment parce que le processus d’intégration se complexifie.
On observe d’abord la montée en puissance du Conseil européen regroupant les chefs d’État et de gouvernement, dont le rôle va grandissant, de stratège définissant les grandes lignes de l’agenda politique de l’Union jusqu’à celui de gestionnaire de crises comme on l’a vu dans les épreuves actuelles. Le traité lui-même, ensuite, permet d’introduire plus de souplesse dans le fonctionnement du système et envisage des formules de « géométrie variable » dans les divers domaines d’action de l’Union (marché unique, diplomatie, défense). Enfin, en dépit des dispositions du traité qui prévoient l’extension du recours à la majorité qualifiée à travers un dispositif sophistiqué de « clauses passerelles », les États membres rechignent à utiliser cette arme et préfèrent, instruits par l’expérience, rechercher le consensus chaque fois que la question débattue se révèle trop controversée. L’exemple du vote à la majorité qualifiée, en 2015, sur la relocalisation entre les membres de l’Union d’une partie des réfugiés installés en Grèce et en Italie témoigne des difficultés du passage en force. Notons à cet égard que la rhétorique de certains dirigeants européens continue de s’en prendre aux pouvoirs jugés exorbitants des institutions de Bruxelles, alors que la pratique témoigne au contraire d’un déclin de ces pouvoirs face aux États.
En réalité, la discussion sur les moyens de relancer le processus d’intégration ne s’oriente guère aujourd’hui vers la redynamisation de la méthode communautaire ou du modèle fédéral. Les appels lancés ces derniers temps en faveur de davantage de majorité qualifiée pour accélérer les décisions en matière de fiscalité ou de politique étrangère sont accueillis avec scepticisme. Plus significative encore, la tendance à une fragmentation accrue du système européen gagne du terrain avec l’apparition de regroupements entre membres, selon des affinités régionales (les quatre pays de Visegrad) ou idéologiques (le groupe dit des pays hanséatiques). À l’occasion de la crise vénézuélienne, se constitue un groupe de contact international où voisinent la Haute représentante de l’Union et huit pays membres qui sont présents à titre individuel ; dans le diffcile suivi de l’accord nucléaire avec l’Iran, ce sont les trois membres impliqués dans la négociation de cet accord qui continuent de mener le jeu, pendant que les autres partenaires européens cherchent avant tout à se prémunir d’éventuelles représailles américaines.
Ce développement de forces centrifuges illustre à sa manière l’évolution du processus d’intégration. Sous-estimées lors des adhésions des pays d’Europe orientale et centrale, les divisions entre l’Est et l’Ouest de l’Union se sont approfondies ces dernières années au point de sembler menacer la cohésion de l’ensemble. De manière insidieuse, ce sentiment de délitement a produit un effet de contagion chez d’autres membres de l’Union, notamment sous la pression de la récente crise financière puis économique, encourageant une politique du « chacun pour soi » dont l’illustration la plus récente se trouve dans les choix faits en ordre dispersé par les pays membres à propos des investissements chinois en Europe. Cette dispersion, sans grand contrôle ni limite, conduit à une interrogation sur la nécessité d’introduire, sous couvert d’une plus grande flexibilité dans le fonctionnement du système, une nouvelle forme d’organisation de l’Union.
De fait, ce besoin de souplesse est en train de trouver sa propre dynamique, à en juger par les nombreux exemples déjà mentionnés. Ce mouvement s’impose presque naturellement parce qu’il correspond à la volonté de ceux des États membres qui entendent relancer l’intégration et ne veulent plus en être empêchés par la pusillanimité ou les résistances des autres partenaires. Le risque d’une telle approche pourtant, sans claire vision de l’objectif final, est bien de placer les institutions de Bruxelles en position difficile en les rendant incapables de remplir leurs responsabilités. Comment parler ou agir au nom de l’Union si celle-ci n’a plus de position commune ? Il est également de susciter chez les membres qui seraient laissés à l’écart le sentiment d’être relégués dans une Union de deuxième division. Faudrait-il dès lors conceptualiser cette démarche de différenciation pour en faire l’objet d’un consensus entre les membres de l’Union, plutôt que de s’engager dans une politique de fait accompli ? Reviennent en mémoire les idées avancées par le passé en faveur d’une nouvelle organisation de l’Union, en cercles concentriques à partir d’un noyau dur de membres prêts à s’engager dans une intégration renforcée. Mais cet effort de théorisation et les garanties qui pourraient l’accompagner pour ceux qui souhaiteraient, le moment venu, rattraper le premier train ne semblent pas en mesure d’apaiser les appréhensions des membres de l’Union qui voient dans ce mouvement l’amorce d’une fragmentation irréversible du système institutionnel.
Cette impression de tourner en rond en l’absence d’un minimum de confiance entre les pays membres tient pour une large part au goût d’inachevé qu’a laissé le dernier élargissement de l’Union. La faute est certainement partagée entre les deux parties et les causes en sont multiples, à commencer par l’existence d’une sorte de fossé mémoriel entre ces deux Europes qui n’a pas été suffisamment pris en compte au moment de l’adhésion. Les malentendus qui s’en sont suivis ont été trop souvent mal gérés des deux côtés, faute de lucidité et de compréhension mutuelle. Il demeure que l’addition du mécontentement à l’Est à l’encontre de partenaires jugés arrogants et des critiques à l’Ouest contre des pays qui ne respecteraient plus leur obligation de solidarité ni les valeurs de base de l’Union rend pour le moins problématique toute perspective de relance de l’intégration européenne si les dirigeants européens ne parviennent pas à sortir de l’impasse dans laquelle le débat sur la différenciation est aujourd’hui enfermé.
L’une des solutions pourrait être précisément de faire de ce débat le point d’entrée pour une discussion lucide entre les responsables de l’Union en vue de définir les règles du jeu de la future flexibilité et d’écarter ainsi les risques de confusion et de désordre. La question ne porterait plus sur l’opportunité d’une telle option, mais sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre, c’est à dire la séquence, les garanties d’information et de supervision données à tous les membres de l’Union ou encore le rôle des institutions européennes dans ces nouveaux mécanismes. La mise en place récente de la coopération structurée permanente dans le domaine de la défense peut fournir à cet égard d’utiles enseignements. Mais l’aspect primordial d’une telle discussion doit bien demeurer la détermination d’aller de l’avant, si possible à l’intérieur du cadre institutionnel de l’Union mais, si nécessaire, en dehors de celui-ci, comme cela s’est produit dans le passé pour engager le processus de Schengen ou, plus récemment, pour lancer l’initiative d’une force militaire opérationnelle entre plusieurs pays membres.
Une relance de l’intégration par la flexibilité présenterait un double avantage vis-à-vis de ceux des membres de l’Union qui restent méfiants à l’égard de cette formule. En proposant une discussion concrète sur les modalités d’une telle différenciation, présentée comme irréversible, elle peut aider à dissiper les malentendus, donner à cette démarche une nature collective (là où les plus récentes initiatives ont donné l’impression d’une addition de gestes individuels) et remettre sur les rails une action européenne mal en point. Cette option peut aussi permettre de sortir de l’ornière la question de l’élargissement dont on connaît la sensibilité pour les pays d’Europe orientale et centrale. En filigrane de la discussion sur une Europe flexible s’esquissent en effet les contours d’une Union plus diversifiée dans laquelle l’Europe du marché unique et de l’Union douanière, ouverte à tous, pourrait cohabiter avec des formes d’intégration plus réduites dans des domaines plus sensibles, comme la diplomatie ou la sécurité. Pourraient ainsi s’ouvrir à terme des opportunités nouvelles pour des adhésions plus réalistes et limitées à certains aspects seulement d’une Union renouvelée.
***
L’intégration européenne a devant elle aujourd’hui un chemin étroit. La voie d’un fédéralisme intégral semble avoir épuisé ses ressources ; ses réalisations sont loin d’être négligeables mais le retour des nations européennes au centre du processus de décision marque les limites de la méthode communautaire telle qu’elle avait été imaginée aux origines de la Communauté européenne. L’approche fonctionnaliste a progressivement pris le dessus et montré par son pragmatisme une efficacité réelle. Mais elle aussi semble avoir perdu de son élan. Les nouveaux défis qui assaillent l’Europe et les évolutions qui sourdent en profondeur appellent une transformation à inventer à partir de l’expérience acquise : moins de règle et de nouveaux traités mais plus d’audace dans la recherche d’une flexibilité capable de générer du mouvement ; des débats politiques assumés comme tels et inscrits dans le cadre des institutions pour faire vivre un espace démocratique indispensable à la relance européenne ; une capacité des institutions à revisiter une une idéologie trop longtemps dominée par le libre-échange et la dérégulation pour mieux répondre aux attentes concrètes des citoyens européens. Mais au-delà de ces indispensables améliorations, l’essentiel reste la nécessaire prise de conscience de la part de tous les responsables européens qu’une Europe capable de se maintenir dans le concert des grandes puissances et de faire vivre son modèle de société n’a de chance de succès qu’à la condition d’affronter lucidement les défis existentiels qui se posent à elle. Plus encore, ce projet ne peut réussir que si tous partagent la même vision de ce que doit être cette Union, qu’il s’agisse de ses valeurs, de son rôle dans le monde ou de l’esprit de solidarité qui doit l’animer. C’est à ce prix que les risques de désintégration de l’Europe pourront être évités et que le processus de relance aura des chances de réussir.