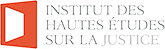Vukovar :
crime fondateur du tribunal pénal pour
l’ex-Yougoslavie…crime impuni
Joël Hubrecht

Le mémorial aux victimes du massacre d’Ovcara, Ovcara – Croatie, source
Télécharger le PDF
Niché en Slavonie Orientale (nord-est de la Croatie), Vukovar était une des régions les plus enviables de l’ex-Yougoslavie. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom de cette municipalité : littéralement « la cité des loups » ! Une appellation, que – comme d’usage dans toute la fédération – elle partage avec et emprunte à sa principale ville, Vukovar. Un nom doublement trompeur. Le monde des loups évoque davantage un territoire boisé, sauvage et inhospitalier, que les vastes étendues de champs fertiles qui assuraient la prospérité de la région. La symbolique du carnassier, surtout après les évènements tragiques de 1991, semble avoir prédestiné le lieu à la fatalité des haines tribales : Homo homini lupus. Pourtant la longue coexistence pacifique de ses habitants lui avait permis d’échapper en partie aux rivalités ethniques de la seconde guerre mondiale et la région était demeurée, malgré tout, un symbole de mixité. Au recensement de 1991, sur ses 84 000 habitants, près de 37 000 étaient croates et près de 32 000, serbes. D’aucun pense d’ailleurs que si la cité et sa région furent convoitées par les forces nationalistes serbes, ce n’est pas en dépit de ce passé plus apaisé qu’ailleurs mais justement à cause de ce passé, et du symbole qu’il incarnait et qu’il fallait mettre à bas ! Sa situation frontalière entre les républiques de Croatie et de Serbie, l’accès au Danube qu’elle rend possible, et son intérêt économique achevaient de faire de la « libération de Vukovar », pour reprendre le lexique du leader serbe Vojislav Seselj, un objectif d’une « importance exceptionnelle ».
L’insurrection armée des nationalistes serbes de Croatie fut soutenue par l’armée populaire de Yougoslavie, la JNA, et organisée depuis Belgrade. Devant le refus de la présidence de la république socialiste fédérale yougoslave (RSFY) d’instaurer un état d’urgence en Croatie et après la déclaration d’indépendance croate du 25 juin 1991, la JNA s’était, sous la houlette du général Kadijevic, placée sous les ordres du président serbe Slobodan Milosevic et du représentant serbe à la présidence de la RSFY, Borisav Jovic. Son objectif n’était plus dès lors, comme le lui assignait la constitution de RSFY, de protéger l’ensemble des peuples de la fédération mais de « protéger le peuple serbe ». La JNA, qui avait déployé des moyens aériens, navals et terrestres, comptait dans la région 30 000 hommes. La ville de Vukovar fut encerclée en juillet 1991. Le 30 septembre, le Conseil national serbe proclamait « l’autonomie de la population serbe dans les territoires ethniques et historiques sur lesquels elle vivait en Croatie ». Le même jour, la brigade motorisée de la garde, basée à Belgrade arrivait à Vukovar. Après un pilonnage incessant, tirant jusqu’à 2000 obus par jour, la ville, réduite à l’état de ruine, tomba le 18 novembre. Vukovar est « une ville qui n’existe plus » titre la revue nationaliste serbe Velika Srbija. Le massacre d’Ovcara est perpétré deux jours plus tard : 250 prisonniers extirpés de l’hôpital du centre de la ville de Vukovar sont exécutés dans la nuit du 20 novembre 1991.
Dokmanovic : premier procès, faux départ
Le principal accusé du TPIY, dans cette affaire, a d’abord été Slavko Dokmanovic, le président serbe de la municipalité de Vukovar. Ce social-démocrate de 41 ans, spécialiste des questions agricoles, est longtemps apparu comme un modéré. Élu en 1990 au nom du Parti du changement démocratique (SDP), il a été destitué par le nouveau gouvernement croate en juillet 91. Quelques mois plus tard, après la prise de la ville par les forces serbes, il a pu revenir dans les fourgons de la JNA et retrouver ses anciennes fonctions. Il les a conservé jusqu’en avril 1996 puis il s’est réfugié auprès de sa famille en Serbie.
Son arrestation, le 27 juin 1997, a constitué le premier succès de la méthode d’action adoptée par la canadienne Louise Arbour, à son arrivée au poste de Procureur du TPIY : le lancement d’actes d’accusation gardés secret jusqu’au moment de l’appréhension effective du suspect. Une mesure controversée mais efficace. En procédant de la sorte, les opérations menées par les forces internationales détachées dans la région se sont avérées moins dangereuses et plus fructueuses. Ignorant qu’il était recherché, l’ancien maire, âgé de 47 ans, est ainsi tombé dans le piège en répondant à une invitation que lui avait adressée un représentant des Nations unies. Le tribunal, qui empilait en vain, jusque-là, des dizaines d’actes d’accusation, cessa enfin de tourner à vide. Comparé à Dusko Tadic, le premier suspect transféré au tribunal, qui n’était qu’un exécutant zélé, Dokmanovic représentait la plus haute autorité civile au moment des faits. Son procès, qui débuta le 19 janvier 1998, a donc une importance particulière. Il donna une nouvelle dimension au tribunal et ouvrit une nouvelle page de son histoire.

Slavko Dokmanovic au TPIY : Source www.haguejusticeportal.net
Les témoins qui se sont succédé dans le prétoire ont raconté la ville assiégée, privée d’électricité et de nourriture, soumise aux bombardements incessants. Le témoin protégé E, comme des milliers d’autres civils, a été obligé de se terrer au milieu des ruines. Son fils ne survivra pas à la guerre. Après la chute de la ville, le 18 novembre, avec une soixantaine d’autres habitants, E se rendit à l’hôpital, qui était à côté de sa cache, pour être évacué, conformément à l’accord de réédition signé à Zagreb entre la JNA et les autorités croates. L’opération aurait dû se dérouler sous le contrôle de la Croix rouge internationale et des observateurs européens. En dépit des rumeurs terrifiantes circulant sur les unités paramilitaires, la plupart des réfugiés faisait confiance à l’armée régulière de la JNA. Pourtant, E a été livré aux paramilitaires et interrogé dans un entrepôt de la compagnie Velepromet. En tout, 1200 détenus y ont été conduits. Coups, menaces de mort et enfermement dans une pièce plongée dans l’obscurité : « Nous avions atteint un degré de terreur extrême », dit le témoin. « Il y avait un chaos, une confusion totale, des cris, des tirs, des pleurs… Les paramilitaires passaient d’une personne à une autre avec une lampe torche. Ils faisaient sortir ceux qu’ils choisissaient… Les gens étaient amenés, passés à tabac, maltraités de toutes les manières imaginables… ». Emmené finalement dans la prison de Sremska Mitrovica, en Serbie, le témoin est relâché à l’occasion d’un échange de prisonniers.
D’autres détenus de l’hôpital n’ont pas eu cette chance. Certains ont été exécutés à Velepromet, d’autres emmenés à Ovcara. C’est dans cette ferme de la banlieue de Vukovar que fut acheminé un autre convoi de prisonniers venus de l’hôpital. Il comprenait deux cents hommes et deux femmes, que les soldats de la JNA avaient séparés des autres réfugiés et malades. Martin Dozen a fait partie de ce second groupe. Ce pêcheur participait à la défense de la ville. Tombé d’un balcon, il fut transporté à l’hôpital, sur une vieille porte faisant office de civière. La seule chance de le sauver de la paralysie aurait été de l’opérer d’urgence. Mais, l’intervention médicale ne se fera pas. Le 20 novembre, le nom de Martin Dozen figurait dans une liste de « suspects de crimes de guerre ». Une liste égrainée par deux soldats de la JNA. Il fut embarqué, par la sortie arrière de l’hôpital, dans un camion militaire. A ses côtés, une cousine de Martin Dozen, enceinte de cinq mois, secouée et insultée par les soldats : « Putain d’Oustachi, où sont les photos de ton mari en train de couper les doigts des enfants pour s’en faire un collier ». Le soldat qui la détroussa, eu la charité de glisser 2 000 dinars dans la main de Ljubica, la femme de Martin. Il lui enjoigna de les garder : « Madame, vous pourriez bien en avoir besoin mais elle, en tous cas, ce ne sera plus nécessaire ». Tanja, la fille de Martin, présente à ses côtés, raconta qu’aux supplications de sa mère et à ses questions sur le sort de son mari, un soldat lui répondit : « Ne me demandez pas ce qui va se passer. Ce bus va être 4
avalé par les ténèbres en plein jour ». Ljubica ne revit jamais son mari ni aucun de ceux qui avaient été embarqués avec lui. Le bus les emmena tout d’abord à la caserne de la JNA. Station temporaire. Une réunion du « gouvernement serbe local », à laquelle participèrent notamment Slavko Dokmanovic, deux officiers supérieurs de la JNA et le capitaine de la Défense territoriale de Vukovar, fut organisée à l’entrepôt de Velepromet pour déterminer si les « prisonniers de guerre » seraient transférés vers une prison en Serbie ou s’ils resteraient incarcérés dans un centre de détention de la région. C’est la seconde option qui prévalue. Pour le Bureau du procureur, leur sort était scellé et Dokmanovic avait pris part à cette réunion décisive et à cette décision fatale.
Des 260 prisonniers rassemblés dans le grand hangar de la ferme d’Ovcara, ne demeurent que 7 rescapés. Plusieurs sont venus à La Haye. Le témoin B avait réussi à sauter du camion le conduisant vers le site d’exécution. Emir Cakalic a, lui, dû son salut à un soldat serbe qui s’était souvenu d’un service rendu avant la guerre. Il a été mis à l’écart et évacué vers un autre centre de détention puis, finalement, échangé. A Ovcara, les bastonnades à coup de battes de base-ball étaient d’une férocité sans borne. Un détenu mourut sous ses yeux : « il était allongé sur le ventre. Ils lui ont sauté dessus. Puis, ils lui ont saisi la tête et l’ont cogné contre le sol en béton ». Cakalic attesta de la présence sur place de Dokmanovic. L’accusé se tenait auprès d’un capitaine : « j’étais gêné de le voir là-bas. Aujourd’hui encore, je serais heureux de ne pas l’avoir vu […] Je me suis dit : « comment un intellectuel, un homme connu, un homme avec qui je me suis trouvé à plusieurs reprises dans le même bureau […] a-t-il pu agir de la sorte ? […] S’il avait sauvé un seul homme là-bas, je demanderais aux juges de l’acquitter ». Mais Dokmanovic ne sauva personne et, selon Cakalic, il alla même jusqu’à frapper à son tour ceux dont il s’approchait : « Il était furieux et ne choisissait pas qui frapper, ni comment». Selon l’accusation l’accusé était présent pour assouvir son désir de vengeance sur ceux qui l’avaient, trois mois plus tôt, démis de ses fonctions et pour durcir sa réputation de « modéré » auprès des extrémistes serbes. Cakalic plaida une erreur de personne. « Les lunettes de Cakalic étaient cassées, il avait du sang dans ses yeux et avait peur pour sa vie » souligna la défense.
La nuit tombée, les prisonniers ont été sortis du hangar et emmenés en camion par groupe de 10 sur le site voisin de Grabovo où ils ont été abattus au bord d’un ravin boisé. Leurs corps ont été ensevelis avec un bulldozer dans un charnier (50 n’ont pas été retrouvés). En octobre 1992, des reporters, dont la journaliste française Florence Hartmann (1), se sont rendus sur place pour vérifier l’existence du charnier. Bien que les autorités serbes de la RSK, saisies par la commission internationale, aient théoriquement accepté de procéder à l’exhumation du charnier en novembre 1993, les premières fouilles n’ont été rendues possibles que trois ans plus tard, à partir de septembre 1996.
Dokmanovic se présenta comme un homme sans pouvoir, pris dans « un jeu dont il n’avait pas compris le scénario » avec des personnes dont il « ignorait les vraies intentions ». Pour ses avocats, leur client avait été rétabli dans ses fonctions de maire en 1991 mais c’était une « fiction juridique » car le pouvoir effectif était dans les mains des militaires.
(1) Voir son témoignage au TPIY
Les juges auraient-ils accordé le bénéfice du doute à Dokmanovic ou auraient-ils avalisé le témoignage de Cakalic ? Nous ne le saurons jamais. Le 29 juin 1998, l’accusé se pendit dans sa cellule. Suivi par un psychiatre, il s’était plaint de troubles dépressifs. Sans illusion apparemment sur le jugement qui se profilait, il choisit de ne pas attendre le verdict qui devait être prononcé dans les jours suivants. Les victimes et les associations de défense des droits de l’homme espéraient que le procès de Dokmanovic marquerait le décloisonnement de la justice internationale. Il ne sera finalement que le premier d’une longue liste de procès interrompus ou impossibles (10 suspects mourront avant leur transfert au TPIY et 7 autres après).
Seule consolation, l’accusation avait pu terminer la présentation publique des éléments à charge et le scénario macabre du crime avait pu être retracé. Les témoignages entendus ont été sauvegardés sur le site du tribunal et une partie rendue accessible dans une rubrique dédiée aux « paroles de témoins » (2). Un grand nombre de ces témoins sont revenus à la Haye à l’occasion du second procès Ovcara, celui de trois officiers que les médias surnommèrent « les trois de Vukovar ».
Mrksic, Sljivancanin, Radic : le procès controversé du « laisser faire, laisser mourir »
Alors que Dokmanovic avait été arrêté en 1997, ces trois suspects ne seront, eux, appréhendés qu’en mai 2002 : au sommet on trouve le général Mile Mrksic, colonel et commandant de la première brigade motorisée de la garde et du groupe opérationnel sud de la JNA au moment de l’assaut de Vukovar ; en-dessous, son subordonné Veselin Sljivancanin, l’officier chargé de la sécurité pour la première brigade motorisée sud, responsable à ce titre de la sécurité des prisonniers de guerres ; enfin, au bas de l’échelle, le capitaine Miroslav Radic. La brigade motorisée de la garde, chargée à l’origine de la protection des dirigeants politiques et militaires de l’ex-Yougoslavie, était une unité d’élite, parfaitement équipée et entraînée. Les associations de victimes de Vukovar ont dû patienter de longues années. Cette fois, l’arrestation ne résulta pas d’un changement de méthode, comme pour Dokmanovic, mais d’un changement de contexte : quelques mois après la chute du président Milosevic, le nouveau gouvernement serbe a extradé les trois accusés afin de donner les gages d’une réorientation du pays. Trois ans plus tard, leur procès s’ouvre enfin, le 11 octobre 2005, dix ans après l’émission des charges à leur encontre, en 1995.
L’atmosphère du tribunal était des plus fébriles car un tout nouveau système informatique avait été installé. Il s’agissait à terme d’améliorer la diffusion entre toutes les parties – accusation, défense, chambre – des pièces versées au dossier mais pour l’heure, le passage à la cyber-justice ne se faisait pas sans quelque confusion. Si ce premier « e-trial » devait tenir ses promesses, ce n’était pas seulement d’un point de vue technologique. Il s’agissait avant tout, pour le bureau du procureur, désormais conduit par la suissesse Carla del Ponte, de rattraper l’occasion manquée par le procès de Dukmanovic, sept ans plus tôt. Cette fois, c’était la responsabilité des militaires qui en était l’armature.
2 la rubrique était mieux mise en valeur dans la configuration antérieure à celle de 2016, qui en conserve toutefois un accès à la page)

Mile Mrksic, source Sense Agency
Un des premiers témoins de l’accusation, Vesna Bosanac, directrice de l’hôpital à l’automne 1991, commenta les images filmées à l’intérieur de son établissement le jour fatidique du 20 novembre. Les blessés et les malades entassés dans les escaliers et les corridors, visages fermés, anxieux… Elle revint aussi en détail sur ses échanges avec le colonel Mile Mrksic. Le Dr Bosanac assura que l’hôpital n’était pas utilisé par les défenseurs croates à des fins militaires. Un point contesté par la défense des accusés qui alléguèrent de la partialité du témoin et évoquèrent une enquête serbe l’accusant d’avoir refusé de soigner des soldats de la JNA. Selon eux, bien que le bâtiment fût ostensiblement marqué d’une croix rouge, l’hôpital était une cible militaire légitime car des rafales auraient été tirées, depuis le toit, sur les avions de la JNA. De plus des membres de la Garde nationale croate se seraient déguisés en malades et en docteurs. Le 19 novembre, le colonel Mrksic confia l’évacuation de l’hôpital et le partage entre civils et « suspects de crimes de guerre » au sergent Sljivancanin.
Le Dr Bosanac décrivit l’arrogance de Sljivancanin et l’impuissance du représentant de la Croix rouge, Nicolas Borsinger. Plusieurs autres témoins, l’ambassadeur Petr Kypr ainsi que deux autres membres de la mission internationale, Hugh Cunningham et Jan Alan Schou, confirmèrent l’obstruction volontaire faite par Sljivancanin pour les empêcher de superviser l’évacuation. Sljivancanin a ainsi pu, à l’abri de tout contrôle extérieur, procéder à la séparation des hommes avec les femmes et les enfants et à la constitution de deux groupes de prisonniers, l’un conduit à l’entrepôt de Velepromet et l’autre vers la caserne de la JNA. Les images tournées à l’époque le montre usant sans vergogne du mensonge. Il prétendit que si les observateurs internationaux ne pouvaient accéder à l’hôpital, c’était uniquement pour des raisons de sécurité et lors d’une conférence de presse, il se vanta même que « pour la première fois dans l’histoire de l’Europe, une armée s’est préoccupée des blessés du camp adverse ».
Le capitaine Radic, commandant d’une des sections d’assaut, que Sljivancanin considéré comme son bras droit, ne fit pas preuve de plus d’humanité. Un médecin de l’hôpital, le Dr Juraj Njavro, raconta les humiliations et les menaces avec lesquelles Radic conduisit l’examen des patients pour « identifier ceux qui seraient emmenés le 20 novembre et finiront à Ovcara ». Pour les juges, il est donc établit que « l’accord relatif à l’évacuation des blessés signé la veille, restait donc lettre morte ». Ils donnent toutefois raison aux accusés sur un point fondamental à savoir que « les personnes sorties de l’hôpital de Vukovar par la JNA le 20 novembre 1991, puis tuées à Ovcara par les forces serbes, ont été retenues et sélectionnées précisément en raison de leur appartenance, réelle ou présumée, aux force croates de Vukovar. » Ainsi, les 194 blessés de l’hôpital de Vukovar qui ont été identifiées dans la fosse commune près d’Ovcara ont beau être en majorité ou au moins en partie des civils, comme ils n’étaient pas considérés comme tels aux yeux de la JNA et des forces serbes, les accusés n’ont finalement pas eu à répondre d’un crime contre l’humanité, comme l’alléguait le procureur, mais d’un crime de guerre commis à l’encontre de « prisonniers de guerre ». Un changement de qualification qui n’a rien d’anodin.
La réalité des brutalités et des meurtres commis a belle et bien été établie mais la thèse de l’accusation a été battue en brèche sur un autre point important. Les accusés n’auraient pas participé à une « entreprise criminelle commune », c’est-à-dire qu’ils n’auraient pas agi de concert en vue de maltraiter et tuer les prisonniers de guerre de l’hôpital. Selon les juges, Mrksic ou Sljivancanin n’ont pas ordonné les tortures et les meurtres. Ce qui leur est reproché, dans le verdict, c’est de « n’avoir pas donné les ordres qu’il fallait ni pris les mesures nécessaires » pour empêcher que les forces paramilitaires serbes et les membres de la défense territoriales violentent et tuent les prisonniers. C’est donc une responsabilité à minima, une responsabilité par défaut, par le détour de leur fonction hiérarchique, qui est retenue : celle de l’inaction. Selon la chambre de première instance, « au départ, Mile Mrkstic voulait que les prisonniers de guerre soient emmenés à Sremska Mitrovica, pour être échangés par la suite. [..] le 20 novembre, Mile Mrksic a changé d’avis et a donné de nouveaux ordres » pour que les prisonniers soient acheminés à Ovcara. Pourquoi ? « Lui seul peut expliquer ce revirement » se contentent de constater les juges en faisant allusion aux « desiterata du gouvernement serbe local qui n’avait pas légalement le pouvoir de donner des ordres à Mile Mrksic ». Le second ordre fatidique est donné par Mrksic aux soldats de la JNA présents à Ovcara : quitter les lieux en laissant ainsi les prisonniers aux mains de la Défense territoriale et des paramilitaires. Là encore, estiment les juges, une décision prise « en raison, semble-t-il, des pressions qu’exerçait le gouvernement serbe local ». Seule certitude, Mrksic était informé des violences commises à Ovcara et des meurtres commis la veille à Velepromet. Il était donc conscient de la menace qui pesait sur les prisonniers. C’est pourquoi, conclurent les juges, « Mile Mrksic doit être sanctionné pour complicité de meurtre ». Ce n’est pas le cas de Sljivancanin et Radic qui n’auraient fait, quant à eux, qu’exécuter les ordres sans prendre part à la décision. Les juges considèrent que Sljivancanin ne s’était certes « pas acquitté de son obligation de protéger les prisonniers de guerre confiés à la garde de la JNA » mais qu’il n’avait pas été démontré qu’il était entré dans le hangar et qu’il avait été en mesure d’y observer les conditions inhumaines de détention. De plus, après l’ordre de retrait de Mrksic, il aurait « cessé d’être responsable de la sécurité des prisonniers de guerre ». Aussi la chambre de première instance ne l’a pas tenu responsable, même indirectement, des meurtres commis à Ovcara mais, du fait de son inaction, uniquement de « complicité de torture ». Quant à Radic, les juges l’ont lavé de toutes charges car « rien n’établit qu’il était à Ovcara le 20 novembre ». L’accusation avait demandé la prison à vie pour les trois accusés. Le jugement, énoncé le 27 septembre 2007 était donc très loin du réquisitoire du procureur. Mrksic fut condamné à 20 ans de prison, Sljivancanin à 5 ans et Radic purement et simplement acquitté.
Le verdict provoqua de vives réactions en Croatie. L’association de prisonniers croates alla manifester aux portes du tribunal. Le premier ministre croate Ivo Sanader déclara que « la sentence représente une défaite du TPIY » et le président Stjepan Mesic qualifia les jugements d’ « inacceptables tant par les peines prononcées que par leur explication ». Le procureur Carla del Ponte estima, de son côté, « incompréhensible qu’une personne reconnue coupable pour des tortures sur 200 prisonniers puisse n’écoper que de 5 ans de prison ». Deux ans plus tard, le 5 mai 2009, la chambre d’appel lui donna partiellement raison en estimant que l’ordre de retrait de Mrksic ne dédouanait pas Sljivancanin de sa responsabilité de protéger les prisonniers et qu’il était donc coupable d’avoir « aidé et encouragé à commettre ces meurtres ». La peine de Sljivancanin fut en conséquence relevée à 17 ans d’emprisonnement.
Situation exceptionnelle, les avocats de l’accusé demandèrent de reconsidérer la décision rendue en appel. Ils apportaient à cet effet un élément nouveau : le chef du personnel de la première brigade motorisée, Miodrag Panic, avait pris contact avec la défense de Sljivancanin pour lui faire savoir que le jour fatidique du 20 novembre, il était en poste avec Mrksic et Sljivancanin. Or Panic assurait qu’il n’avait pas entendu le commandant Mrksic informer Sljivancanin de sa décision de retirer ses soldats de la ferme d’Ovcara. Le témoin providentiel fut entendu par la chambre d’appel le 3 juin 2010. Les objections du procureur, qui voyait là non seulement une volonté de voler au secours d’un camarade d’arme mais aussi celle de prendre ses précautions, en tant que prochain maillon de la chaine, pour se protéger dans l’avenir d’éventuelles poursuites, n’y firent rien. Panic fut considéré par les juges comme « crédible ». Le 8 décembre 2010, le jugement fut donc révisé une troisième fois et une nouvelle peine prononcée avec une réduction de 7 années. Le « yoyo » judiciaire – passant de 5 à 17 puis à 10 ans de prison – pris fin sur cette sentence déjà purgée au deux tiers derrière les barreaux de Scheveningen et, quelques mois plus tard, le 7 juillet 201, sur une remise en liberté anticipée. Des « trois de Vukovar », seul Mrksic aura donc été transféré vers une autre prison, au Portugal. Il y décèdera en août 2015.

AFP : les trois accusés du procès Vokovar
Le sort de Mrksic ne suffit pas à satisfaire l’opinion publique croate. Le dépit était d’autant plus grand qu’en limitant ses poursuites au massacre d’Ovcara, le TPIY a laissé de côté la mise en cause de la JNA pour le bombardement aveugle et massif de la ville. Pour ce crime contre l’humanité, les officiers de la JNA n’auraient pas pu se dédouaner sur les groupes paramilitaires. D’autres affaires auraient ainsi montré ce que Milan Babic, l’ancien président de la république serbe de Croatie (et autre accusé du TPIY) reconnaissait, à savoir que « la JNA a mené une guerre destinée à débarrasser les territoires conquis de la totalité ou presque de leurs habitants croates ». Or, la hiérarchie de la JNA s’en est plutôt tirée à bon compte à La Haye.
La frustration est d’autant plus forte que, en dehors du TPIY, d’autres procès, tenus à Belgrade, alimentent cette impression d’une responsabilité réduite à minima pour les militaires. En effet, en 2005, la cour spéciale pour crimes de guerre, mise en place en Serbie deux ans plus tôt, lança à son tour des poursuites à l’encontre de 16 suspects, anciens membres de la défense territoriale (TO) ou volontaires (3) . 13 inculpés ont été condamnés et 3 acquittés. Bien qu’un des accusés ait fini par reconnaître les faits, le procès se garda bien de lever le voile sur le véritable rôle des gradés de la JNA. Au final, seul une poignée d’exécutants aura été sanctionnée, des petites frappes locales ou des groupes paramilitaires venus de Serbie au secours de leur « frères » (4).
Ces groupes, formellement intégrés au sein de l’armée yougoslave, symbolisent encore aujourd’hui les violences les plus extrêmes commises contre les populations civiles. Ce sont eux qui, une fois le passage ouvert par les pilonnages de la JNA, ont semé la terreur dans les rues et les habitations des villes et des villages « libérés ». Omniprésents dans la plupart des affaires, les plus tristement célèbres de leurs chefs (5).
ont presque tous été visés par le Bureau du procureur. L’unité des « Bérets rouges », cruciale car émanent directement des services secrets de Serbie, est au coeur du procès de Jovica Stanisic et Franko Simatovic. Elle a participé à la prise de Vokovar. Les Tigres d’Arkan (la Garde volontaire serbe – SDG), basés à Erdut, pas très loin de Vukovar, ont eux aussi semé la terreur en Slavonie et dans les territoires arrachés à la Croatie (voir ci-après le procès Hadzic). Arkan, qui se vanta devant des caméras de ne pas faire de « prisonniers », fut inculpé en septembre 1997 mais assassiné à Belgrade en janvier 2000 avant d’avoir à répondre de ses crimes. Autre seigneur de guerre, Vojislav Seselj, leader du Parti radical serbe, choisit de se rendre de son plein gré à La Haye, en janvier 2007, dix jours seulement après que le TPIY ait annoncé publiquement sa mise en accusation. Plutôt que de s’indigner en proclamant son innocence ou de montrer des regrets en promettant des aveux, il s’y rendit en fanfaronnant, jurant d’ « anéantir le tribunal à tel point que même la reine de Hollande n’en sortira pas indemne ».
3 Sur ce procès, et sur la frustration des familles des victimes, voir le document de l’artiste Florence Lazar Prvi-Deo (2006) que l’on pourra visionner dans le cadre de la mise en ligne de ce dossier sur Vukovar
4 Sur les jugements rendus par les juridictions nationales en Croatie et en Serbie voir la base de données mise en ligne en septembre 2016 sur le site BIRN: http://www.balkaninsight.com/en/page/war-crimes-verdict-map. Cette base de données recense 348 jugements rendus par des juridictions nationales de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Montenegro, Kosovo et Serbie. Elle inclut également les verdicts rendus par le TPIY.)
5 Il manque quelques figures notoires comme Vasiljkovic, dit « capitaine Dragan », chef des « Ninjas de Knin », qui s’offrit le luxe de témoigner à La Haye en se retournant en faveur de Slobodan Milosevic. Ce n’est qu’en 2015 qu’il sera extradé d’Australie vers la Croatie après dix ans de procédures judiciaires, pour répondre de crimes à l’encontre de civils et de prisonniers de guerre entre 1991 et 1993)
Seselj : le procès spectacle d’un saltimbanque de la haine
Chef politique, Vojislav Seselj était aussi à la tête d’une formation paramilitaire, les Seselji, déployée en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Ces combattants, venus de Serbie, étaient présents à Vukovar et à Ovcara, aux côtés des membres locaux de la défense territoriale. Le bureau du procureur du TPIY ne comptait pas réduire le cas de Seselj et des Seselji à un procès d’exécutants. Au contraire, c’était avec lui, l’occasion de monter un premier procès réprimant principalement la propagande de guerre et ses ravages. Car Seselj était avant tout un harangueur de foule. Star sulfureuse des médias nationalistes, fondateur du « Parti du renouveau national serbe » puis du « Parti radical serbe », il sera tantôt allié tantôt en rivalité avec le président serbe Slobodan Milosevic. Seselj devait répondre de crimes contre l’humanité (persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, actes inhumains) et crimes de guerre (meurtre, torture, destruction sans motif militaire).
Le TPIY et la prison de Scheveningen ne constituait pas sa première expérience judiciaire et carcérale. En 1984, la justice yougoslave l’avait déjà condamné à huit années d’emprisonnement pour ses « activités contre-révolutionnaires ». Activités qu’il avait reprises de plus belle deux ans plus tard, après qu’une remise de peine lui ait été accordée. Il se rendit en 1989 aux Etats-Unis pour être promu « Vojvoda » tchetnik (titre honorifique signifiant « duc » ou « chef ») par le président du « Mouvement des Tchetniks du monde libre ». La cérémonie eut lieu le 28 juin, jour de commémoration de la bataille du Kosovo de 1389, date éminemment symbolique puisque la mythification de cette bataille perdue, grâce à laquelle les Ottomans s’établirent dans la région des Balkans, fonde le mythe faisant du Kosovo le berceau de la nation serbe. Le mouvement tchetnik (du serbo-croate četnici, de četa « troupes, bandes », désignation traditionnelle des guérilleros luttant contre les Ottomans) y puisa sa soif de revanche pour défendre son idéal d’une « Grande Serbie » ethniquement pure. Durant la seconde guerre mondiale, en 1941, le mouvement, royaliste et anticommuniste, était dirigé par le général Dragoslav, dit Draza Mihailovic. Il se dota, sous la plume de Ravna Gora, d’un programme prônant ouvertement les « déplacements et les échanges de population ». En février 1943, dans la zone de Foca, Cajnice et Pljevje, les Tchetniks tuèrent plus d’un millier de « combattants musulmans » et 8000 civils, femmes, enfants et vieillards. Selon le chercheur français Yves Tomic, qui déposa en tant que témoin expert, Seselj adopta l’idéologie de Ravna Gora et se considère comme un héritier direct des grandes figures historiques du mouvement tchetnik.

Vojislav Seselj dans le box des accusés au TPIY
Autre témoin expert entendu au procès de La Haye, le sociologue américain Anthony Obrshall. De l’analyse de plus de 400 publications et interventions publiques de Seselj entre 1990 et 1994, il ressort que la tournure de ses discours nationalistes xénophobes reposait sur plusieurs invariants. Tout d’abord, la glorification de la nation serbe, appelée à se retrouver par la réunification de « tous les territoires serbes » dans un Etat homogène englobant la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et des pans entiers de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, le dénigrement des communautés non-serbes, dépeintes comme des hordes d’assassins sans pitié. Le spectre d’un nouveau génocide contre les Serbes était brandi par l’assimilation systématique de tous les Croates à des partisans oustachis. Les termes de « Moudjahidin » et « Jihad pan-islamiste » revenaient systématiquement pour parler des Bosniaques musulmans. Le ressort de la peur apparait déterminant. C’est lui qui assurait le mieux l’efficacité des propagandes en rendant les auditeurs réceptifs aux messages de haine. Pour l’alimenter, Seselj n’hésitait pas à propager des mensonges. Une pratique qu’il n’allait pas abandonner à La Haye et qu’il revendiquait, par provocation et pour mieux brouiller les cartes. A un témoin du tribunal qui l’accusait de travestir la vérité, Seselj rétorqua : « La vérité, mais qu’est-ce que j’en ai à foutre ! ». Autre constante mise en valeur par Anthony Obrshall, le rejet de tous compromis avec les populations non-serbes et les « nouvelles » minorités, sommées de se « soumettre totalement » ou de « partir ». Enfin, le registre volontiers ordurier des discours et les gestes agressifs du tribun. Seselj aimait, par exemple, se pavaner en tirant en l’air avec son revolver. Il le fit à plusieurs reprises, devant les caméras, notamment au pied du parlement fédéral à Belgrade et à Vukovar en visant une maison vide. Un geste loin d’être anodin car la mise en scène de la violence symbolique du chef justifie et légitime le passage à la violence réelle des volontaires et « défenseur de la patrie ».
Seselj était poursuivi pour des crimes commis par ses hommes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, à Zvornik en particulier. Vukovar était un épisode parmi d’autres mais d’autant plus significatif que Seselj s’y était rendu en personne à deux reprises, en octobre et en novembre 1991, juste quelques jours avant le massacre d’Ovcara. « Aucun Oustachi ne doit quitter vivant Vukovar » : c’est par cette sentence que Seselj haranguait ses partisans lors de ses déplacements très médiatisés (une équipe de télévision l’accompagnait). Ces appels publics au meurtre, les enquêteurs du procureur ont pu reconstituer à quels moments, en quels endroits et devant quel public, ils avaient été lancés. Son auditoire : les officiers de la JNA, comme Slijvancanin, les membres de la TO locale et les Seseljevci, commandés sur place par Kameni (un des treize condamnés par le procès de Belgrade). Aux harangues du tribun, répondaient les chants belliqueux des volontaires : « Croates, Croates, on va vous massacrer, vous massacrer un peu, mais surtout vous donner aux chiens ». Des paroles tout aussi explicites que celles proférées au mégaphone par celui que nombre de fanatiques, au-delà même des rangs des Seseljevci, considérait comme « une sorte de dieu ». Le traitement spécial avec lequel Seselj a été traité lors de ses visites à Vukovar démultiplia l’impact de ses vociférations. Son transport et sa sécurité étaient assurés par la JNA. Bien que Seselj n’était qu’un civil, et non un militaire, une tenue camouflée spéciale, presque identique à celle que portaient les officiers de haut rang, avait été confectionnée pour lui. En public, Slijvancanin l’appelait respectueusement « Président ». Tous ces honneurs lui conféraient un statut exceptionnel. Il jouissait ainsi d’une véritable autorité militaire et son emprise morale était telle que, pour l’accusation, « les crimes commis à Ovcara et dans tout Vukovar peuvent être directement attribués à ceux qui ont entendus ces appels ». Et de fait, souligna le procureur, parmi les meurtriers et auteurs de violence qui ont été identifiés, « il est établi que beaucoup d’entre eux étaient présents lorsque Seselj a donné la consigne qu’aucun Oustachi ne devait quitter Vokovar vivant ». Ainsi les discours tenus par Seselj n’étaient pas seulement considérés par l’Accusation comme une vague propagande politique, mais une incitation à tuer, voir comme une sorte « d’ordre de tuer ». On est loin du simple « délit » d’injure raciale et provocation à la haine. D’autant que Seselj n’était pas poursuivi au titre de sa responsabilité de commandement mais de sa « responsabilité criminelle individuelle ». En cela, plaida l’accusation, il ne pouvait pas s’abriter derrière la régulation et l’intégration, en septembre 1991, des paramilitaires dans les rangs de la JNA, soit plusieurs semaines avant le massacre d’Ovcara. De plus, Seselj n’était pas poursuivi uniquement sur la base de ses discours. Mais aussi parce qu’il avait fourni un soutien financier, matériel, logistique et politique à la prise de contrôle des régions convoitées. Il avait ainsi recueilli des fonds considérables ; parfois de manière crapuleuse, comme au travers de l’agence Lasta liée au Parti radical qui, sous couvert d’organiser des échanges entre propriétés serbes et croates en Croatie, rackettait les Croates devant fuir. Il avait également recruté et endoctriné des volontaires comme Goran Stoparic, venu témoigner en janvier 2008. Ainsi, l’impact que cherchait à mettre en valeur l’Accusation n’était pas seulement celui provoqué par Seselj sur un vague auditoire de partisans ou sur le grand public des médias serbes, c’était celui que ce « commandant imaginaire » avait sur ceux qui ont été identifiés comme ayant directement commis des crimes.
Face aux juges, Seselj admis, non sans auto-satisfaction, que ses discours avaient pu avoir un impact important. Revendiquant ouvertement, au nom de l’efficacité, l’usage du mensonge qui, pour lui, ne constituait qu’une arme politique parmi d’autres, il nia la véracité de certains propos compromettant qu’il avait pu tenir à l’époque, par exemple ceux enregistrés par des journalistes de la BBC (« The death of Yougoslavia », un documentaire dont les extraits et les rushs ont été abondamment utilisés par le procureur dans plusieurs procès). Mais sa défense résida avant tout dans le fait que, selon lui, ses propos, quelques qu’ils soient, vrais ou faux, orduriers ou haineux, puissent faire l’objet de poursuites en justice. C’était, avança-t-il, « un crime inventé », en contradiction avec la liberté de parole que garantit aux Américain la constitution des Etats-Unis : « Personne ne peut être condamné pour son comportement, seulement pour des crimes avérés ». Cet argument occulte un précédent fameux : la peine capitale prononcée par le tribunal international de Nuremberg en 1946 à l’encontre de l’éditeur nazi Julius Streicher pour ses appels à l’extermination des Juifs dans son journal Der Stürmer. Lors des contre-interrogatoires des témoins de l’accusation, Seselj avança de nouvelles thèses complotistes pour expliquer le massacre d’Ovcara. Il mit en cause la traitrise du général Vasilkovic, de la JNA, qui aurait, selon lui, ordonné le massacre pour déconsidérer les Serbes et légitimer internationalement la cause croate. Il aurait, en concordance avec la directrice de l’hôpital Vesna Bosanac, établit une liste de 200 « martyrs volontaires », prêts à ce sacrifice pour la Croatie. De plus, les meurtriers n’auraient pas compté dans leur rang de Seselji car ces derniers seraient retournés en Serbie après la chute de Vukovar et avant la nuit du 20 novembre. Seselj promettait de le prouver grâce aux témoignages des conducteurs de bus (ce qu’il ne fit pas). Seselj avança une thèse du même type pour expliquer la condamnation par la chambre spéciale pour crimes de guerre de Belgrade du commandant des Seselji, Milan Lanzucanin Kameni, pour les tueries d’Ovcara. Ce jugement faisait partie d’un complot pour pouvoir, via Kameni, l’impliquer artificiellement. L’acte d’accusation dans son ensemble aurait été le fruit d’un complot entre Carla del Ponte et l’ancien premier ministre Zoran Djindjic (assassiné en 2003 lors d’un attentat perpétré par le commandant d’une unité paramilitaire des services secrets serbes, les « bérets rouges »).
Un autre aspect de la personnalité de l’accusé resurgit durant les audiences, les contre-interrogatoires des témoins étant menés par Seselj lui-même. C’est son agressivité. Les témoins non-serbes et les victimes étaient systématiquement renvoyés aux crimes commis par le camp auquel ils étaient censés appartenir. Les témoins serbes de l’intérieur étaient des membres de « l’entreprise criminelle commune » menée par le bureau du procureur en connivence avec une célèbre militante des droits de l’homme en Serbie, Natasa Kandic (6). L’agressivité jouissive de Seselj pris une dimension plus inquiétante encore lorsque l’Accusation demanda la suspension du procès en raison d’intimidations faites à l’encontre de plusieurs témoins. Le 11 février 2009, le procès était ainsi suspendu pour presque un an. Une autre procédure, pour « obstruction de la justice » cette fois, en prenait le relais. Le procès« principal » repris en janvier 2010 mais fut, dès le mois suivant, à nouveau perturbé par l’ouverture d’une seconde affaire d’intimidation de témoins. 11 témoins protégés avaient été soumis à des menaces et se trouvaient exposés par des informations données par Seselj dans un livre rédigé depuis sa cellule et diffusé sur son site internet. Dans les deux affaires, Seselj fut reconnu coupable d’avoir délibérément enfreint les mesures de protection des témoins et condamné successivement à 15 mois puis à 18 mois de prison. Un coup d’épée dans l’eau puisque Seselj refusa de retirer l’ouvrage incriminé de son site. Une troisième procédure pour outrage fut encore ouverte en mai 2011 et lui vaudra, en juin 2012, une troisième condamnation, plus lourde cette fois, à deux ans.
Seselj ne plaida pas coupable mais, sans quitter sa superbe, réclama au juge de lui infliger la peine la plus sévère, regrettant même que la peine de mort ne soit pas pratiquée par le tribunal. Cela lui permettrait, rêva-t-il tout haut, de «mourir debout, comme mon ami Saddam Hussein » et ainsi « poser un sceau immortel sur mon idéologie ». L’accusé ne présenta pas de témoins ni de dossier à décharge, préférant déplacer la confrontation sur un autre terrain. Il commença par exiger de recevoir l’ensemble des documents transmis par l’Accusation dans une langue « authentiquement serbe ». Refusant les traductions dans les langues officielles du tribunal, le français et l’anglais (qu’il manie pourtant parfaitement) aussi bien que celles traduites par des interprètes croates ou bosniaques (rappelons qu’avant la guerre, les trois langues étaient pourtant réunies dans une seule et même langue, le serbo-croate). Pour contrecarrer le « comportement obstructionniste » de Seselj, dont l’exemple précédent n’en est qu’un parmi beaucoup d’autres, la chambre décida de lui assigner un avocat commis d’office. En novembre 2007, l’accusé entama une grève de la faim pour protester. Il aura finalement gain de cause et pourra assurer lui-même sa propre défense (7). Seselj estimait que celle-ci coûterait 6,3 millions de dollars, environ 20 fois plus que le coût habituel de la défense d’un inculpé. Cette somme astronomique, il demanda au tribunal de la couvrir. Il n’obtiendra pas gain de cause (ou que très partiellement). En janvier 2012, Seselj réclama à nouveau de l’argent, cette fois sous la forme d’un dédommagement de 500 000 Euros pour « des retards délibérés dans la procédure» menée contre lui. En vain, une fois encore. Un autre axe de « défense » fut, dans le sillage du complot imaginaire Del Ponte- Djindjic- Kandic, la révélation d’un complot contre sa vie qui aurait été mené par l’entremise des docteurs accrédités par le tribunal pour suivre ses problèmes de santé. Ces derniers auraient tenté de l’empoissonner. L’accusation faisait écho à des rumeurs semblables qui avaient déjà circulées au sujet d’un autre détenu, Slobodan Milosevic, mort d’une crise cardiaque dans sa cellule. Une analyse sanguine fut réalisée pour tester, sur un panel de 2000 substances nocives, l’éventuelle présence de poison. En dépit des résultats négatifs, Seselj n’en démordit pas : les services secrets américains et français avaient tenté de l’empoisonner. Une autre allégation de Seselj fut prise au sérieux par les juges. En juin 2010, le juge Antonetti missionna un « Amicus curiae » pour conduire une enquête indépendante sur les accusations de Seselj et de plusieurs insiders (témoins de l’intérieur, ex-Tchetnik et Seselji) qui, reniant leurs premières déclarations, évoquaient des pressions exercés sur eux et des tentatives de corruption. Cette enquête sur la conduite des services du procureur était une première dans l’histoire du tribunal. Un an plus tard, l’expert, en 240 pages, invalidait toutes les suspicions. L’accusation demanda le versement au dossier de ce rapport pour pondérer la crédibilité des témoins qui s’étaient, en audience, retournés en faveur de l’accusé.
6 Sur la contribution du Humanitarian Law Center, dont Natasa Kandic est présidente, aux procès du TPIY, voir l’article de Clara Bruhman « le Humanitarian Law Center, promoteur de la justice transitionnelle en Serbie », mis en ligne dans le cadre de ce dossier spécial consacré à Vukovar.
7 Un autre accusé, Ratko Mladic, également “incontrôlable” en audience, s’inspirera de ce précédent et menacera lui aussi de se lancer dans une grève de la faim lorsque le tribunal tentera de lui imposer un avocat.
En dehors de cette invraisemblable accumulation de procédures et de rapports annexes, une autre singularité du procès résida dans le jeu de séduction auquel se livrèrent l’accusé et le juge qui présidait la chambre, Jean-Claude Antonetti. Celui-ci fit en effet preuve d’une surprenante tolérance vis-à-vis de ses provocations dans le prétoire et se montra compréhensif envers des demandes plus d’une fois exubérante. La chambre ordonna par exemple le versement de « 50% des fonds habituellement alloués pour la défense des accusés indigents ». Décision contre laquelle le Greffe du tribunal fit immédiatement appel car Seselj avait toujours refusé de fournir les informations requises pour sa prise en charge. Le 18 mai 2011, la chambre d’appel, à trois votes contre deux, confirma cependant la décision des juges et entérina cette situation inédite : le financement d’un accusé ayant refusé d’indiquer sa véritable situation financière ! Autre attention, Antonetti alla jusqu’à créer, en octobre 2007, un protocole inédit pour pouvoir rendre visite à l’accusé dans sa cellule (alors en grève de la faim). Seselj joua de cet appui inespéré au sein d’un tribunal qu’il qualifiait par ailleurs de « illégal et anti-serbe », se disant même « agréablement surpris » par l’attitude de ce juge qu’il gratifiera d’être devenu « la coqueluche du public serbe ». Mais dès lors que les décisions d’Antonetti ne lui convenaient plus, et après la révélation sur le site Wikileaks d’un cable diplomatique américain interprétant la complaisance du juge comme une stratégie pour le rendre plus coopératif, Sesel se déclara « déçu » et « choqué » et n’hésita pas à admonester sévèrement Antonetti. Il n’alla cependant pas jusqu’à le récuser, contrairement aux autres juges contre lesquels il déposa un nombre invraisemblable de recours pour obtenir leur révocation, en particulier dans les procès annexes. Le premier était selon lui inapte à le juger car venant de la nation allemande, c’est-à-dire d’un pays qui « déteste les Serbes et les persécutent depuis des siècles ». Pour deux autres juges, leur partialité émanait de leur affiliation catholique (donc opposés aux orthodoxes et par conséquence aux Serbes). Quand ce n’était pas pour des motifs purement racistes (vis-à-vis d’une juge africaine), c’était parce que après avoir été copieusement insultés par l’accusé dans un de ses livres, ces juges n’auraient plus été en situation de juger sereinement de son cas. La dernière tentative, en octobre 2012, s’offensait qu’un des juges avait montré, pour reprendre les termes de ses avocats, « des préjugés excessifs et passionnés à l’encontre du professeur Vojislav Sesel ». Au final, Seselj aura tenté de démettre une dizaine de juges. Sa persévérance finira par payer pour le juge Harhoff dont il obtint l’exclusion pour « apparence de parti pris inacceptable en faveur d’une condamnation », ce dernier ayant fait état de pressions exercées par la présidence du tribunal dans une autre affaire (l’acquittement en appel du général croate Gotovina (8). Ce changement, intervenu alors que le réquisitoire final avait été prononcé, prolongea de plusieurs mois, sinon années, le rendu du jugement et peut être considéré comme le véritable tournant du procès. En effet, bien que l’on ne puisse pas anticiper les attendus d’un jugement sur une décision intermédiaire, force est de constater qu’en mai 2011, le juge Antonetti était mis en minorité par ses deux collègues, les juges Harhoff et Lattanzi, qui votèrent pour le maintien de toutes les charges présentées par l’Accusation. Le juge Antonetti, dans une opinion dissidente, fit valoir qu’à ses yeux, seulement trois des neufs charges avaient été suffisamment argumentées par le procureur pour que l’accusé ait à s’en défendre. Or, Harhoff évincé, le juge Niang, arrivé après les réquisitoires, en se ralliant au point de vue du président Antonetti, a très probablement fait basculer la majorité de la chambre en faveur de l’accusé.
Sur ce procès voir Marina Eudes, « L’acquittement controversé des anciens généraux croates Gotovina et Markac´ par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », revue Grief, n°1/2014, éditions EHESS/Dalloz ainsi que Joël Hubrecht, « TPIY : la justice internationale fait-elle fausse route ? », juillet 2013, publié sur le site de l’IHEJ
Le jugement fut rendu le 31 mars 2016, 10 ans après l’ouverture du procès le 27 novembre 2006. Une durée aussi « hors-norme » que l’aura été le déroulement de cette affaire. Et tout ce temps alors même qu’il n’y aura pas eu de présentation de moyens à décharge ! L’accusation aura ainsi appelé 71 témoins et déposé 1348 pièces à conviction. Du côté de l’accusé, aucun témoin et seulement 6 pièces pour sa défense. Le procès n’aura duré en temps de procédure que 175 jours mais, avec ses suspensions, causées notamment par les problèmes de santé de l’accusé, et avec ses multiples rebondissements, réquisitoire et plaidoirie finales ne se seront terminées que le 20 mars 2012. Les délais raisonnables de détention provisoire étaient incontestablement dépassés. Cela explique sans doute – sans le justifier pour autant – cet ultime privilège accordé à l’accusé que la Cour laissera, pour des raisons médicales, repartir en novembre 2014 en Serbie en dépit de son refus obstiné de donner le moindre gage sur son retour. Et de fait, il ne reviendra pas ! Le jour du verdict, pour la première fois de son histoire, un président de chambre rendit un jugement devant des fauteuils vides, l’accusé et ses collaborateurs n’ayant pas fait le déplacement ni même accepté d’être relié en vidéo-conférence. Le verdict, quatre ans plus tard, est aussi affligeant que le déroulement chaotique du procès le laissait craindre : l’accusé est acquitté de tous les chefs d’accusation.
Les tribuns peuvent hurler leurs imprécations, « silent enim leges inter arma » : «En temps de guerre les lois se taisent ». C’est par cette citation de Cicérone que la juge Lattanzi résume, dans une virulente opinion dissidente, la ligne à laquelle ses deux collègues se sont rangés dans leur jugement. En considérant que Seselj avait une autorité morale sur ses volontaires mais que ces derniers n’étaient pas sous son commandement, les juges l’exonèrent abusivement de mode alternatif de responsabilité lié à l’incitation et à l’aide ou l’encouragement. En expliquant qu’ils n’avaient pas reçu les preuves suffisantes « pour exclure la possibilité » que les bus affrétés aux déplacements forcés des habitants non-serbes aient pu l’être dans une perspective d’aide humanitaire au civils voulant fuir des zones de combat, que les paramilitaires et les volontaires de Serbie venus participer au nettoyage ethnique aient pu s’enrôler dans une perspective défensive et légaliste, que les discours haineux de Seselj aient pu être prononcé non pour appeler au meurtre mais pour galvaniser le moral des troupes, ces mêmes juges donnent l’impression d’avoir voulu à tout prix, et de quelques côté qu’on prenne les choses, blanchir l’accusé de toutes responsabilité et de surtout ne rien laisser au crédit du procureur. En faisant cela et en ne manquant pas d’ajouter que toute guerre est par nature violente mais que ces violences ne sont pas forcément criminelles, et que le projet de Grande Serbie même s’il était discriminatoire ne relève pas forcément d’un dessein criminel, les juges Antonetti et Niang laissent la porte grande ouverte au révisionnisme, encore virulent en Bosnie et en Serbie.
Bien sûr, le procureur a fait appel et on peut espérer que l’acquittement rendu en première instance sera révisé par la chambre d’appel. Mais, quoi qu’il advienne sur le plan judiciaire, Seselj ne reprendra de toute façon plus le chemin de La Haye. Il est aujourd’hui tout à son retour en politique et aux prochaines législatives en Serbie. Bien qu’affaiblie par son cancer, sa verve est intacte. Elle avait occasionné un premier incident diplomatique entre la Croatie et la Serbie dès les premiers jours de son retour au pays. En effet, alors que s’ouvrait la période de commémoration du siège et de la chute de Vukovar, il s’était publiquement félicité de la « libération » de la ville par les forces serbes.
Goran Hadzic : ultime procès, dernière occasion manquée
Goran Hadzic, surnommé le « petit caporal » du président serbe Milosevic, sera, en juillet 2011, le dernier accusé du TPIY à être arrêté. C’est au Conseil municipal de Vukovar que Hadzic commença sa carrière politique. Très rapidement il s’imposa comme le principal représentant des Serbes de Croatie, en occupant, en septembre 1991, la fonction de Président du gouvernement des Districts autonomes serbes autoproclamés (SAO) de Slavonie, de Baranja et du Srem occidental puis, en février 1992, le Président de la République serbe de Krajina (RSK) réunissant les trois districts autonomes en un « Etat » fantoche, une entité discontinue complètement dépendante du soutien de la Serbie. Goran Hadzic était d’ailleurs connu comme « l’homme de Milosevic » sur le terrain. C’est pourquoi, en février 1992, il se substitua à Milan Babic, ex-président du district autonome de Krajina et éphémère premier président de la RSK. Milan Babic était en effet entré en opposition avec Milosevic, ce qui lui valut d’être rapidement marginalisé (9).
9 Bien plus tard, après l’extradition de Milosevic en 2002, le TPIY pourra bénéficier de cette ancienne rivalité. Babic devint en effet un des témoins clés du procès du président serbe. Sa déposition fut décisive pour lever le voile sur les dessous des relations politique, militaire et financière qu’entretenaient secrètement les dirigeants serbes de Croatie de l’époque et Belgrade. Il témoigna également au procès du successeur de Goran Hadzic au poste de président de la RSK, Milan Martic, lourdement condamné. Babic fut lui même poursuivi et condamné par le TPIY à 13 ans pour crimes contre l’humanité. Nul doute qu’il aurait également été appelé à témoigner face à son ex-rival politique Goran Hadzic. Il ne le fera pas car, comme Dokmanovic avant lui, Babic se pendit dans sa cellule le 5 mars 2006
La présentation des éléments à charge commença le 16 octobre 2012. Bien que ce soit le dernier à s’ouvrir devant le TPIY, le procès remonte aux sources même de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et à ses premières violences (en octobre 1991, 50 civils sont forcés de marcher dans un champ de mines). L’histoire de Goran Hadzic, homme-lige mais acteur incontournable des évènements, est étroitement liée à celles de nombreux autres accusés du TPIY : Martic, Babic, Milosevic, Simatovic, Stanisic, etc. Hadzic apparait comme une des pièces maitresses du dispositif mis en place entre tous ces suspects. L’accusé apparait, au travers des pièces présentées et des témoignages entendus, comme parfaitement intégré dans le réseau qui relie les responsables serbes de Serbie, de Bosnie et de Croatie. L’acte d’accusation est plus large que ne l’était celui de Dokmanovic mais le nom de Hadzic reste attaché à l’expulsion des 20 000 habitants croates de Vukovar et au massacre d’Ovcara. La liste des victimes occupe plusieurs pages en annexe de l’acte d’accusation. C’est en effet Hadzic qui, selon le procureur, aurait imposé à la JNA que les 200 prisonniers de l’hôpital ne soient pas transférés dans une prison de Serbie (où ils auraient pu faire l’objet d’un échange ultérieur de prisonniers) mais restent sur place, aux mains des forces de la TO et des volontaires. Dès le début du procès, les liens étroits avec le milicien Arkan ont été longuement mis en lumière par l’accusation. Les deux hommes se montraient souvent en public ensemble et, bien qu’Arkan était au service des services de la sécurité d’Etat de Serbie, un document présenté par un témoin du procureur indique que c’est Hadzic qui nomma Arkan commandant en chef du centre d’entrainement militaire d’Erdut. Il serait arrivé en sa compagnie, escorté sous sa garde, à la réunion qui se tint en début d’après-midi, le 20 novembre, à l’entrepôt Velopromet durant laquelle le cabinet acta le transfert des prisonniers de l’hôpital aux autorités locales. Le procureur, qui attribue au président Hadzic, comme il l’avait fait auparavant pour Dokmanovic, un « rôle décisif » dans cette décision, présenta un document faisant le compte-rendu informel du déroulement de cette réunion. Lorsque se diffusèrent les premières rumeurs sur le massacre, début 1992, et que l’existence du charnier fut révélée, son gouvernement n’entreprit aucune enquête sérieuse et il fallut attendre plusieurs années, et la chute de la RSK (10), pour que les opérations d’exhumation puissent commencer. L’accusation appela 81 témoins et déposa plus de 3 000 pièces au dossier. Le 20 février 2014, la Chambre de première instance rejeta la demande d’acquittement présentée par Hadzid.

Goran Hadzic à La Haye (source : Sense Agency)
Pour sa défense, Goran Hadzic tenta de se distancier d’Arkan, en prétextant qu’il était souvent à ses côtés plus par coïncidence que par proximité personnelle. Il martela que les groupes paramilitaires étaient entièrement contrôlés par la JNA, lui n’ayant, malgré son statut officiel, aucun pouvoir réel sur la situation. Il prétendit également que si il avait été décidé que les prisonniers de l’hôpital devaient rester aux mains des autorités locales c’étaient pour être poursuivis en justice et non pour être exécutés. Cette ligne de défense, Hadzic commença à la présenter lui-même longuement en se constituant témoin et en étant interrogé par son avocat puis contre-interrogé par le procureur pendant plus de 60 heures. Il chercha à relativiser ses déclarations publiques de l’époque en expliquant qu’il fallait les interpréter dans le contexte particulier de la guerre, qu’il n’avait pas entendu parler de crimes commis par les Tigres d’Arkan (hormis un unique incident !) ni de cas d’expulsion forcée de Croates et qu’il n’avait pas voulu interférer dans le travail de la police et des juges pour respecter leur indépendance. Enfin, il allégua qu’il ne s’était pas opposer à l’exhumation du charnier de Grabovo pour laquelle il avait donné son accord dès novembre 1993.
Bien que le procès ait donc pu être relativement assez avancé, une nouvelle fois, le mauvais sort interrompit le processus judiciaire avant son terme. Tombé gravement malade, atteint d’un cancer, l’accusé fut libéré et transféré en Serbie, son procès suspendu en octobre 2014 jusqu’à l’extinction définitif des poursuites quelques jours après son décès, le 12 juillet 2016.
10 La Slavonie orientale, Baranja et Syrmie occidentale où se trouve Vukovar ne fut pas reconquise militairement par l’armée croate en aout 1995 et ne retourna sous souveraineté croate qu’en janvier 1998 au terme d’une réintégration négociée et pacifique.
Conclusion :
Le TPIY peut faire valoir à son actif la condamnation de plusieurs responsables de la campagne de persécutions, extermination et expulsion des populations croates des territoires revendiqués par les Serbes. En particulier, deux officiers de la JNA, Jokic Miodrag et Pavle Strugar, condamnés à 7 ans de prison pour le bombardement de la ville patrimoniale de Dubrovnik en 1991 et l’ancien président de la RSK, Milan Martic, condamné à 35 ans, poursuivi notamment pour le bombardement de la capitale croate Zagreb en mai 1995. Mais le bilan est beaucoup plus maigre pour ce qui s’est passé à Vukovar. Cela est dû en partie à des erreurs et des dysfonctionnements imputables au tribunal (choix des affaires et des qualifications juridiques, lenteur des procédures, qualité des enquêteurs et des juges, etc.) mais aussi à des causes extérieures, principalement les décès de plusieurs des accusés poursuivis.
A Vukovar, le désabusement est indéniable (11). La cour régional a bien lancé de nombreux actes d’accusation, presqu’autant qu’il y a eu de morts à Ovcara. Mais peu d’affaires on aboutit (12). De leur côté, les procès du TPIY semble dessiner un partage des responsabilités (les autorités serbes locales sont intervenues pour que la JNA leur livre les prisonniers ; la JNA a accepté de livrer les prisonniers en sachant ce qui allait ou risquait de leur arriver ; les forces serbes de la TO et les paramilitaires ont conduit le massacre). Les procédures n’ont par contre pas clairement établi qui avait pris la décision d’exécuter les prisonniers et dans quel but. Le sort de Vukovar était retenu dans les charges contre Slobodan Milosevic, établissant un lien avec la politique et la stratégie de la tension menées depuis Belgrade, bien loin donc du récit d’une simple vengeance conduite par des volontaires et des combattants locaux. Comme pour Dokmanovic, le décès de l’accusé, peu de temps avant la fin du procès, nous prive du verdict des juges. Deux autres acteurs proches de Milosevic, poursuivis pat le TPIY pour leur rôle dans les services de la sécurité d’Etat (les services secrets serbes), Jovica Stanisic et Franko Simatovic, devaient initialement répondre de charges relatives à Ovcara. Mais, dans le cadre de la politique d’accélération des procédures pour fermer le tribunal, l’acte d’accusation fut raccourci et ces charges retirées. Vingt-cinq ans après la chute de Vukovar et le massacre d’Ovcara, il reste donc encore bien des zones d’ombre sur ce qui s’est passé et bien peu de responsables auront été condamnés. En comparaison de ce que le TPIY a été en mesure de réaliser pour d’autres crimes emblématiques des guerres en ex-Yougoslavie (le siège de Sarajevo, le génocide de Srebrenica, etc.), Vukovar apparait donc un crime fondateur dans l’histoire de la justice pénale internationale et cependant reste encore un crime largement impuni.
— Joël Hubrecht
11 Voir Janine Natalya Clark, « The ICTY and reconciliation in Croatia. A case study of Vukovar », Journal of International Criminal Justice, vol.10, n°2, 2012, pp.397-422
12 Sur les 235 personnes poursuivis, en 2006, seulement 51 avaient pu être jugés et 7 étaient effectivement emprisonnés. Ces chiffres datent de 2012. Pour une estimation actualisée des jugements rendus, voir le site BIRN.