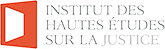[Télécharger le PDF]
Le mandat d’arrêt de la CPI, délivré en mars 2009, à l’encontre d’Omar Hassan El Béchir a-t-il encore une chance d’être appliqué un jour ou, au fil du temps et des déplacements de l’accusé (une cinquantaine à l’étranger depuis) a-t-il perdu toute sa valeur ? Lorsque, en décembre 2014, le Bureau du Procureur annonça devant le Conseil de sécurité que, au vue de l’absence de soutien effectif de ce dernier à la mise en œuvre de sa saisine de la Cour sur le Darfour, il suspendait ses enquêtes, on imaginait mal ce qui pourrait permettre de maintenir la pression sur les Etats, en particulier les Etats africains déjà très réservés pour nombre d’entre eux sur cette affaire, pour qu’ils coopèrent à l’arrestation du président soudanais. Les pontes de l’Union africaine (UA) qui avait voté en juillet 2011 une résolution exhortant ses Etats membres à ne pas coopérer avec la CPI, pouvaient exulter et El Béchir se réjouir de sa participation personnelle au prochain sommet de l’UA, en juin 2015, à Johannesburg. Ce qui effectivement eu lieu mais ne se déroula pas pour autant tout à fait comme prévu, le président soudanais, après avoir posé pour la postérité sur la photo officielle du sommet, devant ensuite plier bagage en catimini et sortir par la petite porte.
La relance n’est pas venue d’en haut, du champ international – on n’aura noté aucun sursaut en provenance de New-York – mais d’en bas, du champ national, africain de surcroît, avec les décisions rendues par la Haute Cour en juin 2015 puis ce 15 mars 2016 par la Cour suprême d’Afrique du Sud. En effet, celle-ci rappelle le gouvernement sud-africain, qui avait laissé venir et repartir El-Béchir, à ses obligations. Ce n’est certes pas la première fois que des instances judiciaires nationales confirment l’obligation de coopérer avec la CPI – le 28 novembre 2011, la Haute Cour du Kenya avait déjà prononcé une décision allant dans le même sens à l’encontre des autorités politiques de leur pays -, et, de toute les façons, le président soudanais est désormais hors de portée des juges et policiers sud-africains. Néanmoins, cette décision mérite une attention toute particulière. D’une part, parce qu’elle valide l’ordre d’arrestation émis par la Haute Cour en juin 2015, qui faisait l’objet de l’appel devant la Cour suprême, et rappelle que cet ordre a un effet continu. Cela signifie concrètement que le retour de El Béchir en Afrique du sud ne sera pas aussi aisé. Et de fait, ce dernier avait prudemment renoncé à se rendre au Forum Chine-Afrique organisé en décembre 2015 à Johannesburg. Mais surtout, par la rigueur de son raisonnement et la clarté de son propos, cette décision apporte une contribution très utile à un débat qui dépasse la seule question du rapport des Etats-partis à la CPI, ou d’un Etat vis-à-vis d’un traité international, sur lequel existe déjà une littérature abondante. Le débat est, par certains aspects, plus complexe, car il traite de « l’écartèlement induit par les engagements de la double-présence à deux institutions internationales », en l’occurrence l’appartenance à la CPI et à l’Union africaine, qui ont sur le dossier pris des positions opposées, situation qui, comme le constate le Pr. Paul Elvic Batchoum, de l’Université de Yaoundé, a elle été beaucoup plus rarement étudié[1]. A ce titre, c’est l’ensemble du jugement qui vaut la peine d’être lu.
A l’origine, l’affaire a d’abord été portée devant la Haute Cour par une ONG sud-africaine, le Southern Africa Litigation Center (SALC) lors de l’ouverture du sommet. La Cour suprême qualifie durement la réaction des autorités (« conduite honteuse », « explications risibles ») pour retarder l’audience de la Haute Cour puis pour justifier le départ sans entrave du président soudanais. L’absence de mesures prises pour arrêter celui-ci à son arrivée dans le pays était, écrivent les juges, « en contradiction avec les obligations de l’Afrique du sud par rapport au Statut de Rome et à la section 10 de la Loi de mise en œuvre du Statut de Rome, et illégale ». Pour sévère qu’il soit, le jugement, assorti d’une opinion partiellement dissidente, n’a rien d’un pamphlet anti-gouvernemental. Il examine avec précisions les arguments opposés par les représentants du ministère des affaires étrangères et du ministère de la justice : le fait, d’une part, d’avoir signé avec l’Union africaine un accord dont l’art. VIII.1 portait sur des questions d’immunité dans le cadre temporaire du sommet et, d’autre part, l’immunité ratione personae des chefs d’Etat reconnue par la coutume internationale et inscrite dans la Loi 37 de 2011 des privilèges et immunités diplomatiques (DIPA). Le gouvernement ajoute à cela une distinction entre immunité de jugement, qui serait, selon lui, la seule visée par la Loi de mise en œuvre, et immunité pour arrestation qui n’en ferait pas partie et avance aussi le fait que le Soudan n’est pas un Etat membre de la CPI.
Sur le premier point, la Cour suprême valide le raisonnement de la Haute Cour qui avait fait valoir que l’immunité prévue dans l’accord avec L’UA pour le XXVème sommet ne concernait que les représentants et personnels de l’UA et non tous les participants et les chefs d’Etats venus pour l’occasion. Sur le second point, la Cour suprême se réfère à la jurisprudence de la Cour internationale de justice de La Haye et de la Cour européenne des droits de l’Homme pour tenter d’établir l’état actuel de la coutume international, en reprenant, avec réalisme, un propos de Lord Hoffmann : « It is not for a national Court to « develop » international law by unilaterally adopting a version of that law which, however desirable, forward-looking and reflective of values it may be, is simply not accepted by others states » (§ 74). Se basant en particulier sur l’arrêt du 14 février 2002 rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), auquel la CPI s’est elle-même référée dans une de ses décisions sur le cas El-Bechir, la Cour suprême reconnait que la coutume internationale pose « l’immunité d’un chef d’Etat en exercice devant les juridictions d’autres Etats » (§ 67 et § 84) mais, comme la CIJ mentionne également quatre exceptions, dont l’une peut concerner la Cour pénale internationale, le juge qui préside la chambre considère que «personne ne prétend, pour autant que je le sache, que la question a été clairement résolue sur le plan de la coutume internationale » (§ 76). De même, les juges sud-africain reconnaissent que les tensions entre l’article 27 du Statut de Rome (par lequel les Etats-partis renoncent à opposer à la CPI toute immunité nationale ou internationale pour leurs ressortissants) et l’article 98 du même Statut (qui stipule qu’un Etat n’a pas à remettre un suspect à la Cour si cela le conduit à agir de façon incompatible avec les obligations lui incombant en droit international en matière d’immunité étatique ou diplomatique) « est bien connue » et n’a pas encore été tranchée (« authoritatively resolved », § 60). Ces ambiguïtés expliquent en partie les tensions entre les deux lois nationales, la Loi de mise en œuvre du Statut (IA) à laquelle se réfère l’ONG SALC et la Loi sur les immunités (DIPA) à laquelle se réfère le gouvernement. Cependant, cela n’empêchent pas la Cour de très clairement affirmer, dans le cas du mandat d’arrêt contre El-Béchir, l’obligation de coopérer de l’Etat sud-africain, obligation que lui avait déjà rappelée la chambre préliminaire de la CPI le 13 juin 2015. Ce qui est très intéressant cependant dans le cas du jugement de la Cour suprême, c’est qu’elle ne va pas seulement appuyer son raisonnement sur une contrainte extérieure ou sur l’autorité de la résolution 1593 du Conseil de sécurité (qui en dépit du manque de suivi par le Conseil dans sa mise en oeuvre concrète continu à avoir des effets de droit contraignants et écarte l’argument de la non ratification du Soudan au Statut de Rome) mais qu’elle va confirmer le bien-fondé de l’injonction de la CPI par rapport à la Loi nationale de mise en œuvre et par rapport à la constitution sud-africaine. « When South Africa decided to implement its obligations under the Rome Statute by passing the Implementation Act (…) I accept, in the light of the earlier discussion of head of state immunity, that in doing so South Africa was taking a step that many others nations have not yet taken” (§ 103).
La détermination de la société civile sud-africaine, ou plus précisément de certaines de certaines de ses associations (plusieurs autres ONG ont tenté d’être reconnues comme Amicus curiae dans cette affaire mais ont été déboutées), à l’origine de la saisie des juges sud-africains, offre ainsi une cruelle mais belle leçon de persévérance à méditer autant par le président sud-africain Jacob Zuma, qui en 2010 affirmait publiquement qu’il n’hésiterait pas à arrêter El Bechir s’il venait à fouler le sol de son pays, et aux membres du Conseil de sécurité qui en 2005 avait renvoyé la situation au Darfour devant la CPI.
Joël Hubrecht
[1] P.E. Batchoum, « La double présence au sein des institutions internationales. Une analyse de la position des Etats africains face aux mandats d’arrêt de la CPI », dans L’Afrique et le droit international pénal, Actes du troisième colloque annuel de la SADI, éditions A. Pedone, 2015. Une présentation et la table des matières de cet ouvrage sont accessibles dans la rubrique « ressources » de notre site.