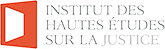Ce texte a été préparé en vue de la participation à la Table-ronde « Prévention du génocide » du colloque sur les génocides – Mémoire, transmission, vigilance, prévention – organisé à Paris le 5 mars 2017 par le B’nai B’rith France.
Voir la vidéo des tables-rondes.
Le thème de la prévention est aujourd’hui plus visible qu’il ne l’a jamais été. Comme le rappelle un rapport onusien de 2015 il est un « aspect central de la responsabilité de protéger ». La fonction préventive des procès et de la justice internationale n’est cependant pas une préoccupation récente. Elle a été défendue dès 1945, à Nuremberg, par Robert H. Jackson le procureur américain auprès du TMI (tribunal militaire international), dans son discours d’ouverture. Il y affirmait « que la civilisation ne peut se permettre d’ignorer ces crimes car elle ne survivrait pas à leur répétition ». La mise en lumière publique de l’ampleur des crimes nazis lors d’un procès de portée internationale, soit un évènement d’une résonnance sans précédent, et la force dissuasive de la condamnation des accusés – à cette époque allant jusqu’à la condamnation à mort – devaient contribuer à empêcher le retour du désastre.
En 1948, la fonction préventive a été à nouveau invoquée mais en tant que telle cette fois et plus seulement comme un effet de la répression judiciaire. C’est l’objet de l’article 1 de la convention contre les génocides, dite Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans laquelle les Etats signataires « confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles [les parties contractantes] s’engagent à prévenir et à punir ». Ainsi la prévention n’est plus seulement un objectif secondaire, elle devient une obligation des Etats. Les Etats signataires d’abord puis progressivement, au fur et à mesure que les normes de la convention deviennent des normes du droit international coutumier, une obligation de tous les Etats, même non signataires.
C’est une obligation à deux faces, à la fois distincte de l’obligation de répression et néanmoins reliée à elle. Une obligation longtemps portée par la seule bonne volonté des Etats du fait de l’absence effective de toute sanctions crédibles, et cela durant au moins toute la période de la Guerre froide. Rappelons que la convention prévoyait le développement d’un volet pénal au travers du projet d’une Cour permanente dont il faudra finalement attendre près d’un demi-siècle pour qu’il se concrétise avec la création de la Cour pénale internationale (CPI). Il faudra aussi attendre longtemps la traduction en droit et les premières précisions jurisprudentielles avec la condamnation en février 2007 de la Serbie par la Cour internationale de justice pour n’avoir pas honorer ses obligations de prévention et de répression face au génocide commis à Srebrenica, dans l’Etat voisin de Bosnie-Herzégovine, en juillet 1995. Cette condamnation sans précédent distingue donc la « complicité de génocide » que la Cour internationale de justice (CIJ) n’a pas reconnu dans le cas de cette affaire et « l’obligation de prévention » qui est, comme le précise les juges, « une obligation d’actions et non de résultat ». Il n’y a pas d’obligation de réussir à effectivement empêcher un génocide mais il y a une obligation de tenter de l’empêcher. Cette obligation reflète donc les capacités d’un Etat à peser sur un autre au travers de ses liens diplomatiques ou d’autre nature (historique, économique…). C’est parce que la Serbie était en capacité d’influer sur les généraux bosno-serbes qu’elle a des comptes à rendre. Et c’est aussi parce qu’elle avait conscience du risque de génocide puisque l’obligation de prévention est aussi corrélée aux informations sur le risque encourus. Il s’agit, devant la CIJ, de juger de responsabilités d’ordre étatique.
Une responsabilité similaire a été développée, dans les années 90, pour les individus devant les juridictions internationales, en particuliers à partir du statut et des jugements du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) : celle de la « responsabilité dite du supérieur hiérarchique ». Dans le cadre de ce mode de responsabilité, un supérieur politique ou militaire peut être condamné non pas pour avoir donné l’ordre direct de commettre un crime mais seulement du fait de ne pas avoir pris les mesures raisonnables nécessaires pour empêcher ou sanctionner ce crime alors qu’il était en mesure d’être informé de sa commission. Là encore, cette fois-ci au niveau pénal, une obligation de prévention du crime de génocide mais aussi d’autres types de crimes internationaux comme le crime contre l’humanité est reconnue et sanctionnée par des juges.
Le TPIY va innover en matière de prévention sur un autre plan : en effet, à la différence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le TPIY sera en fonction alors que le conflit qu’il couvre n’est pas encore terminé. La Bosnie-Herzégovine, avec la chute de Srebrenica, comme un an auparavant le génocide des Tutsi au Rwanda marquent bien sûr l’échec de la prévention internationale du génocide et du « plus jamais ça ». Pire, Srebrenica est commis alors même qu’un tribunal international est en place. Une justice impuissante ou/et non crédible, telle est la première leçon. Mais il y en a une seconde, moins noire. Car l’inculpation du président bosno-serbe et du général Mladic en novembre 1995, quelque jours avant la signature d’un accord de paix, invalideront rétrospectivement les craintes des diplomates et négociateurs qui voient dans la justice un obstacle à la paix plutôt qu’une de ses composantes. A partir de là, lentement, le débat sur les liens entre « paix et justice », qui impacte les enjeux de la non-répétition et de la prévention, vont changer. Le médiateur n’est plus seul. Le juriste s’invite à la table des négociations aux côté des militaires et des diplomates. Le procureur devient alors à son tour un acteur dans le conflit. En février 1999, Louise Arbour, procureur du TPIY, à la suite du massacre de Racak au Kosovo, fait le déplacement à la frontière albano-serbe où elle sera refoulée. Par cette incursion, et par ses discours retransmis sur les télévisions du monde entier, le procureur tente de faire peser une pression sur les belligérants dans un contexte de montée des tensions. Là encore, l’action du procureur s’avèrera insuffisante : la guerre éclatera quand même avec ses déportations massives et ses massacres. Et ce à quoi on assistera, c’est à des tentatives de dissimulation des responsabilités (via des chaines parallèles de commandement et de la documentation factice) et des stratégies de camouflage (via le transport dans des charniers secondaires et la destruction de cadavres) plutôt qu’à l’empêchement des crimes. La recherche de la parade semble contourner l’effet de dissuasion espéré. Mais n’est-ce pas là, de tout temps, le lot de la justice en général ? Même dans les pays qui ont pu se doter de juridictions performantes et efficaces, le crime n’a pas pour autant été abolie. On ne peut cependant nier que le niveau de la criminalité y est tout de même moindre que dans d’autres pays qui en sont dépourvus ou passent pour être des « Etats faillis ». La force dissuasive de la justice, en dépit de ses limites, est donc une réalité. Dans le cas de la justice pénale internationale, outre la rareté de ses procès et l’extrême jeunesse de ses institutions, c’est l’absence d’une véritable institutionnalisation au travers d’une Cour permanente qui a sans doute longtemps pesé à son encontre. Avec la mise en place en 2002 de la CPI, cette lacune est comblée.
Bien sûr, la CPI est le fruit d’un traité, auquel adhère librement les Etats, ce qui n’est pas le cas des principales puissances du globe (les USA, la Chine, l’Inde, la Russie). Sa compétence est donc strictement limitée, ce que sait bien aujourd’hui un Bachar El-Assad qui peut bénéficier du véto russe au Conseil de sécurité pour empêcher toute saisie de la Cour dont la Syrie n’est pas Etat-partie. Dans un tel contexte, l’action de la Cour est improbable et sa force dissuasive est très restreinte. De plus, cette force dissuasive est aussi liée à la crédibilité et aux résultats dont elle peut se prévaloir, or ceux-ci sont mitigés. D’un côté de hauts responsables et des chefs d’Etats ont été poursuivis et sanctionnés mais de l’autre la CPI butte sur la capacité des chefs d’Etats en exercice à lui résister (voir l’échec pour faire arrêter le président soudanais et pour enquêter sur le président kenyan).
Cependant, et c’est là un point essentiel, la CPI ne vise pas la prévention uniquement au travers de ses procès et de ses condamnations. Le procureur développe d’autres formes d’intervention. Elles peuvent être confidentielles, avec des échanges discrets avec des responsables d’un Etat membre dans lequel la situation évolue dangereusement ou, au contraire, public, par le biais de déclaration mettant en garde tel ou tel gouvernement Etat membre. Ce fut le cas avec les Philippines. Le procureur a dénoncé les exécutions sommaires massives contre les trafiquants de drogue. Message entendu : en janvier dernier, le président philippins qui jusqu’alors avait toujours encouragé ces exécutions extra-judiciaires, se met à critiquer la corruption de la police et marque une trêve dans sa « sanglante guerre contre la drogue » (Le monde, 31-01-2017). En République démocratique du Congo aussi, pays pour lequel des procès de ressortissants ont déjà été conduits devant la Cour, plusieurs missions ont été envoyées sur place par le procureur alors que le climat se dégradait du fait du report des élections. Bien que la situation reste fragile, le pire a été jusqu’à présent évité et un accord politique finalement trouvé.
Cet enrichissement de la palette préventive s’inscrit dans un élargissement de l’optique préventive. D’abord axée sur la dissuasion par la sanction après-coup des massacres, puis sur la préemption c’est-à-dire l’anticipation des actions meurtrières pour les arrêter juste avant qu’elles ne surviennent, les actions préventives visent de plus en plus en amont à empêcher que des sociétés toute entières ne s’engage dans des processus de division pouvant conduire à terme à d’hypothétiques massacres. Des actions on se déplace vers les idéologies, les mentalités, les discours de la haine, le paysage médiatique, etc. Le crime de génocide est un aiguillon dans cette évolution, du fait que, dès son origine, l’entente en vue de le commettre est une charge pouvant faire en soi l’objet d’une condamnation, et qu’il est structurellement construit autour de l’intention qu’il vise (celle de détruire en tout ou partie un groupe protégé). Les sanctions de ces infractions « inchoactives », où la dimension criminelle est reconnue en-dehors même du résultat auquel les génocidaires seront parvenus, sont certes encore loin d’être la priorité des juridictions internationales – et ce souci était singulièrement absent des jugements du TPIR comme le montre le dernier ouvrage de Rafaëlle Maison (Pouvoir et génocide). Mais le mouvement est déjà plus qu’amorcé et devrait se poursuivre.
Assiste-t-on à un renforcement inédit du souci et des capacités préventives ou à une sorte de fuite en avant ? Il est à ce jour difficile de répondre. D’une part parce que les contre-exemples sont dramatiques : la Syrie en premier lieu avec l’utilisation d’armes chimiques, les bombardements d’hôpitaux, la mise en scène d’exécutions barbares ou la réduction en esclavage de populations entières. Mais la Syrie, on l’a dit n’est pas un Etat membre de la CPI. Qu’en est-il au Burundi, qui a lui ratifié le Statut de Rome ? Menacé par un examen préliminaire sur sa politique de répression et dans une situation qui a été qualifiée par plusieurs spécialistes de la région de « pré-génocidaire », il a profité des tensions entre la CPI et l’Union africaine pour se retirer et stigmatiser l’anti-africanisme de la Cour (la procureure rappelons-le au passage, est gambienne !). L’adaptation, l’évitement, le retrait et la confrontation avec l’institution en lieu et place de la dissuasion. La situation au Burundi, à l’heure où son président s’est coupé de la CPI et du reste de la communauté internationale pour faire le vide, où la répression perdure en huis-clos, demeure toujours extrêmement tendue[1]. Elle n’a pas encore basculée dans un nouveau génocide mais pour combien de temps encore ? Nkurunziza reste sourd aux appels à négocier et professe des discours mystiques et apocalyptique qui font douter que la raison puisse encore suffire à le dissuader de poursuivre sa course folle vers un abîme dans lequel il entraine son propre peuple. Impossible de dire si la menace de poursuites judiciaires que fait peser la CPI sur le président burundais contribue d’une manière ou d’une autre, temporairement ou durablement, à l’empêcher d’aller au bout de cette folie. Si on peut se rendre compte sans mal quand la prévention échoue, il est plus difficile de dire dans quelle mesure elle fonctionne. Car face à la montée des périls, la justice internationale n’est pas seule à agir (ne compter que sur elle serait d’ailleurs une grave erreur ou un moyen pour les autres acteurs de se défausser). Son action doit s’inscrire dans un ensemble d’autres moyens : les sanctions internationales par exemple, les mécanismes non pénaux qui se développent dans le champ de la Responsabilité de protéger et de la justice transitionnelle (une justice post-conflit qui met de plus en plus l’accent sur la non-répétition et la prévention du retour des conflits). Le conseiller spécial du Secrétaire de l’ONU pour la prévention des génocides, chargé de mettre en œuvre, depuis 2004, un Plan d’action dédié à la prévention du génocide incarne un autre agent actif, plus politique que judiciaire, de la prévention. Dans le cas du Burundi, ce conseiller, Adama Dieng, a averti le Conseil de sécurité de l’urgence de prendre des mesures pour enrayer la progression vers des violences «massives». L’ONU évitera-t-elle de voir se reproduire dans la région des grands lacs, vingt après sa cuisante déroute au Rwanda, un nouveau bain de sang ? Elle dispose de davantage d’outils de prévention qu’à l’époque mais ce qui fera au final la véritable différence, ce n’est pas seulement le panel des instruments disponibles, mais la volonté politique de tous les utiliser.
En conclusion, la prévention est bien devenue un enjeu davantage investi par la justice internationale, et cela même si le statut de Rome n’est pas très explicite sur la manière dont cette fonction préventive devrait être portée et encadrée judiciairement. Elle nécessite de renforcer les capacités de collecte et d’analyse d’informations, le décryptage de signaux d’alerte précoces, nos capacités de réaction et de médiation, les ressources qui lui sont consacrées. Les enjeux institutionnels, comme en témoigne la crise que traverse aujourd’hui non seulement la CPI face aux menaces de retraits de plusieurs Etats membres mais aussi le Conseil de sécurité face à la poursuite des exactions en Syrie, sont terriblement complexes et lourds. Mais la prévention ne se joue pas qu’au niveau international, à La Haye ou à New-York, et elle concerne aussi les individus et la capacité de nos sociétés à valoriser les actes de résistance ou de sauvetage (l’histoire des justes) et à développer l’engagement individuel. C’est là, en particulier mais pas seulement, le rôle de l’éducation, qui n’est pas dissociable de l’enseignement de l’histoire et de la place de la mémoire des génocides du passé. Les défis – lorsque l’on constate à regret qu’en France l’enseignement ne fait toujours pas de vraie place au génocide des Tutsi et à l’étude comparative des processus génocidaire – sont immenses. Mais il y a tellement d’actions possibles et de réformes à faire pour progresser que c’est un élan de mobilisation et non le découragement qui devrait nous saisir, malgré tout.
[1] Selon la fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), la répression aurait fait, entre le 26 avril 2015 et novembre 2016, plus de 1000 morts, 8000 détenus politiques, 300 à 800 disparus, des centaines de cas de torture, des centaines de femmes victimes des violences sexuelles, des milliers d’arrestations arbitraires, 310 000 réfugiés à l’extérieur et 61 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays. On pourra aussi se reporter à la séquence vidéo de l’intervention de David Gakunzi dans la table ronde du colloque du B’nai B’rith France ( http://www.akadem.org/_articles/670/88670.php ) pour mesurer à quel point le risque de génocide reste élevé.
— Joël Hubrecht