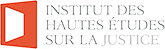Séminaire les cours suprêmes à l’heure de la mondialisation
Séance du vendredi 27 mars de 9h30 à 11h00
La plénitude de juridiction sur le fait comme sur le droit
Responsable de séance : Cécile Chainais, professeur à l’université Panthéon-Assas, directrice du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits
Première partie
Il nous a été proposé de réfléchir à la question suivante :
– Traditionnellement, la technique du pourvoi en cassation repose sur la distinction très claire entre le fait et le droit. La Cour de cassation doit se cantonner à un strict contrôle de l’application de la loi.
– Mais dès lors que les cours européennes ne sont pas liées par les qualifications données par les Etats nationaux, cette distinction n’a pas la même valeur pour elles.
– La jurisprudence des cours européennes ne risque-t-elle pas dès lors, par rétroaction, de fragiliser voire anéantir cette distinction cardinale du droit français ?
Réfléchir à la plénitude de juridiction, sur le fait comme sur le droit, à propos de la Cour de cassation française, c’est se livrer à un exercice de juridique-fiction, voire de politique-fiction. Cela requiert à la fois une part d’audace, sans laquelle la fiction risquerait de se réduire à une vision un peu accentuée de la réalité, mais aussi une forme de prudence – puisque nous sommes dans une période où de vraies réformes sont envisagées.
La distinction entre fait et droit est au cœur de la technique de cassation. Elle définit même, négativement, le domaine d’action du juge de cassation qui, en vertu des textes français, ne connaît pas du fond des affaires. Le 12 août 1790, l’Assemblée constituante dota la France d’un tribunal de cassation ; ses attributions furent déterminées par le décret du 27 novembre 1790 aux termes duquel : « Le (…) tribunal de cassation annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi (…). Sous aucun prétexte et dans aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures et les jugements, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître ». Cette interdiction se retrouve aujourd’hui dans l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire en vertu duquel « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire ».
Chacun sait néanmoins, j’y reviendrai, combien la distinction entre fait et droit peut, dans certains cas, être ténue. En outre, d’autres traditions juridiques que la nôtre, particulièrement de common Law, ont toutes les peines du monde à comprendre ce que peut bien être ce juge «(de cassation) qui, en définitive, serait un juge qui « ne juge pas », en ce sens qu’il est privé du pouvoir de connaître des faits d’une affaire donnée. L’idée a parfois été reprise en France. Un ancien Président de la Cour de cassation a ainsi pu un jour, non sans quelque esprit de provocation, faire remarquer que toute la technique de cassation serait destinée à empêcher le juge de juger vraiment – connaître des faits et dire le droit sur l’ensemble d’une affaire donnée.
On pourrait dès lors faire au juge de cassation le reproche que Péguy faisait à la philosophie de Kant. On connaît la fameuse formule (du reste discutable sur le fond, mais c’est une autre histoire) : « le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains ». La Cour de cassation, à sa manière, aurait les mains pures : par la technique de cassation – par cet instrument chirurgical qu’est le pourvoi, elle manierait uniquement la règle de droit, propre, sans entrer en contact avec le magma impur des faits. Comme la morale de Kant pour Péguy, elle y perdrait sa nature même – en l’occurrence sa nature de juridiction.
Cette limitation fondamentale de la Cour de cassation – sinon impensée, du moins longtemps consensuelle – pose depuis une vingtaine, voire une trentaine d’années, des difficultés particulières, à l’heure où d’autres cours, telles que la Cour européenne des droits de l’homme, jouissent au contraire de la plénitude de juridiction sur le fait comme sur le droit.
Là où les textes de référence indiquent que la Cour de cassation ne peut connaître du fond d’une affaire, les textes et la jurisprudence de la Cour EDH dessinent, au contraire, une très grande amplitude de pouvoir au profit de la Cour de Strasbourg. Celle-ci est en effet conçue comme un véritable organe de protection juridictionnelle des droits de l’homme. Non seulement sa compétence ratione materiae est conçue très largement puisqu’elle « s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application » de la Convention (article 32 de la Convention EDH). Mais encore, la Cour de Strasbourg a pour mission d’établir les faits de l’espèce.
Elle connaît des faits, elle connaît du fond de l’affaire. La Chambre saisie d’une affaire est ainsi, d’abord, un juge collégial d’instruction : l’article 38 de la Convention EDH lui confie la charge d’établir les faits en procédant à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties. La chambre dispose, à cette fin, de larges pouvoirs d’instruction (article 42 du Règlement) : demande de renseignements à l’adresse des parties, demande de production de preuves écrites, communication des mémoires, audition des parties, de témoins, d’experts, etc. Elle peut même procéder à une enquête sur place, effectuer une descente sur les lieux, visiter des centres de détention, auditionner sur place le requérant, des témoins ou toute personne (journalistes, syndicalistes…). L’Etat est du reste tenu de coopérer à cette phase d’établissement des faits et lorsqu’il ne le fait pas, la Cour peut conclure à un constat de violation de la Convention.
C’est dire qu’on est loin, très loin même, de l’interdiction faite, par les textes, à la Cour de cassation de redéfinir elle-même la matière litigieuse. Limitée à cet aspect, la comparaison directe des pouvoirs entre Cour de cassation et Cour de Strasbourg semble se faire aux dépens de la première. In fine, l’arrêt rendu par la Cour EDH s’analyse en effet en un acte juridictionnel sur le fond, par lequel la Cour statue en droit sur la violation alléguée de la Convention, mais à propos des faits qu’elle a elle-même établis avec l’aide des parties. La Cour EDH est un plein organe juridictionnel doté de forts pouvoirs. C’est un juge du fond, un juge souverain doté d’une plénitude de juridiction dans le domaine limité toutefois qu’est celui de la protection des droits reconnus par la Convention EDH.
Au contraire, la Cour de cassation est tenue, pour l’examen des faits, à ceux qui résultent des dossiers des juges du fond. Elle doit raisonner en droit, exclusivement à partir de tels faits. Elle est, assurément, une « juridiction, composée de magistrats qui statuent au terme d’une procédure juridictionnelle ». Mais elle ne saurait être un troisième degré de juridiction ou, plus exactement, un troisième degré de pleine juridiction. La loi lui interdit en effet de remettre en cause les appréciations de fait des juges du fond. Elle n’a pas à reconsidérer les faits tels que les juges du fond les ont appréciés : « ses justiciables ne sont pas en réalité les parties, dont l’intérêt n’est qu’accessoirement engagé devant elle, mais les arrêts envisagés uniquement dans leurs rapports avec la loi »[1] – en d’autes termes, les jugements, mais pas les procès[2]. Il en résulte que lorsqu’elle casse une décision des juges du fond, la Cour ne peut en principe évoquer les faits du litige et substituer sa propre décision à celle des premiers juges : elle casse la solution en droit mais n’instruit pas le fond de l’affaire ; elle renvoie. Cela résulte de l’article L. 131-4 du code de l’organisation judiciaire : « (…) en cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction (…) ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats ». S’agissant des faits, la Cour s’en remet à l’« appréciation souveraine des juges du fond » (Ch. réunies, 2 févr. 1808). L’idée serait donc que la Cour connaît des jugements et non de l’affaire. Glasson et Morel y voyaient une règle bienfaisante, grâce à laquelle la Cour de cassation serait toujours en dehors des luttes, des agitations, des passions, n’ayant qu’à dire le droit »[3]. La formule est intéressante car elle pose, a contrario, la question de savoir si cette règle, au demeurant relative, ne mettrait pas la Cour de cassation hors de son temps et ne la cantonnerait pas à une forme d’impuissance.
La Cour de cassation se trouverait ainsi prise « en étau » entre deux juridictions statuant sur le fond : les juridictions du fond interne, et cette juridiction du fond européenne qu’est la Cour de Strasbourg[4].
Ainsi, l’affirmation classique selon laquelle la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction change de statut. Alors qu’elle apparaissait jadis comme l’expression d’une distinction – au sens quasi sociologique, voire « bourdieusien », de ce terme : elle n’était pas une juridiction comme les autres, elle s’en distinguait – elle serait désormais atteinte d’un handicap, moins bien sûr au regard des juridictions du fond inférieures que de la juridiction du fond supérieure.
[1] E. Faye, La Cour de cassation, 1903, réimprimé en 1999, La mémoire du droit, n° VII, p. 12.
[2] G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil d’après le traité de M. Planiol, t. 1er, Introduction générale, LGDJ, 1956, n° 172, p. 81.
[3] E. Glasson et A. Tissier, op. cit., n° 108, p. 259.
[4] Burgelin Dalloz 2001 L’avenir de la cassation. : « la Cour de cassation se trouve en quelque sorte coincée entre deux juridictions qui examinent les affaires et en fait et en droit : la cour d’appel et la Cour européenne des droits de l’homme ».
Deuxième partie
Cette comparaison brute des pouvoirs trouverait sa traduction la plus criante lorsque la Cour EDH est amenée à statuer sur des affaires dont la Cour de cassation a pu précédemment connaître « en droit ». En effet, depuis en particulier le début des années 2000, la Cour EDH a montré sa volonté non seulement de contrôler la conformité de la procédure de cassation aux garanties du procès équitable, mais le bien-fondé de ses décisions[1]. C’est là un bouleversement dont on n’a sans doute pas fini, depuis 15 ans de tirer les enseignements. Un procureur général avait ainsi appelé, dès 2001, à une refondation du rôle de la Cour de cassation : « Autant un contrôle de pur droit se justifie au sommet d’une hiérarchie juridictionnelle, autant il est dépourvu de sens lorsqu’il est coiffé par une juridiction du fait comme du droit ». Ce constat est souvent traduit, en termes sociologiques ou psychologiques, à travers la notion d’humiliation. En mettant en œuvre sa plénitude de juridiction sur des affaires dont la Cour de cassation a connu, la Cour de Strasbourg ferait subir une sorte d’humiliation à la Cour de cassation. Une humiliation d’autant plus insupportable dès lors qu’elle est le fruit d’une entité souvent vécue comme « exogène », la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’érigerait en 4e degré de juridiction, alors même qu’il n’y a pas eu de troisième degré de pleine juridiction.
L’arrêt Dulaurans, rendu en 2001, dans lequel la Cour EDH condamna la France en reprochant à la Cour de cassation d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation parce qu’elle avait considéré comme nouveau un moyen qui ne l’était pas, a ainsi laissé aux juristes français de mauvais souvenirs… Il ne fut pas isolé.
…………….
Se poserait dès lors la question de savoir s’il faut doter la Cour de cassation de pouvoirs identiques à la Cour EDH.
A titre liminaire, une observation s’impose : l’édifice supposé étanche entre le fait et le droit, sur lequel reposerait toute la technique de cassation, n’a jamais comporté des parois aussi étanches qu’on veut bien le dire parfois.
Comme le souligne Valerio Monteleone, « l’unique système valable pour établir si le juge a correctement appliqué ou au contraire violé la loi est celui de contrôler le dénommé « jugement de fait » à travers la motivation de la sentence : il n’y en a pas d’autre ». Mais « nous sommes alors face à l’un de ces si nombreux postulats non démontrés, un véritable tabou, qui veut a priori que la cassation ne puisse en aucune manière s’ingérer dans le jugement de fait, ou connaître des faits, étant un juge de la pure légitimité ».
Or la distinction absolue entre le jugement de fait et de droit existe seulement en théorie mais dans le concret des décisions qui s’occupent d’affaires réelles et vécues, elle n’existe pas, du moins sur un mode clair et aussi net que le voudraient les théoriciens. Chiovenda et Satta avaient déjà nié largement cette distinction, avec des arguments très forts. Chiovenda observe ainsi que, certes, ont exclus de l’examen par la Cour de casssation les éventuels vices du jugement de fait : ainsi, ne peut pas être censuré le jugement par lequel le juge du fond affirme qu’un fait est advenu ou n’est pas advenu[i]. Mais il observait que ce principe, ainsi formulé devait éclairci et délimité. Il observait que, bien sûr, l’opération de qualification, qui fait le lien entre le droit et les faits, est pleinement du ressort de la Cour de cassation ;
Chiovenda faisait ainsi remarquer que l’expression « violation ou fausse application de la loi » ne rend pas compte exactement du sens de cette règle, tel qu’éclaircit par la tradition (Principi 1024). En effet, il y aura aussi violation de la loi lorsqu’une norme est appliquée à un fait inexistant ou lorsqu’on refuse de l’appliquer à un fait existant.
Ainsi, lorsque se profile cas d’ouverture de la violation ou de la fausse application de la loi, le juge de cassation accomplit toujours, indirectement, un contrôle sur le jugement de fait à travers l’exigence de la motivation de la sentence. A cet égard, certains auteurs italiens ont fait remarquer que la suppression du défaut de manque de base légale dans les cas d’ouverture légaux était vaine puisqu’en réalité, ce grief sorti par la porte, revenait inévitablement par la fenêtre au moment d’appliquer les cas d’ouverture les plus classiques. Du reste, la suppression de ce cas ne s’est pas accompagnée, statistiquement, d’une déflation significative des recours.
En outre, cet édifice se fissure, même en droit positif. La Cour de cassation est déjà, en France aussi, pour partie, juge du fond. L’idée que la technique de cassation ne porterait d’attention qu’au droit est largement inexacte.
D’abord, l’article 627 du CPC, alinéa premier, permet à la Cour de cassation de casser sans renvoyer l’affaire devant un juge du fond lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ». Il en est ainsi par exemple après cassation dans l’intérêt de la loi, annulation pour excès de pouvoir, pour irrecevabilité de la requête, pour incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ou des juridictions françaises, ou encore lorsque le litige n’a plus d’objet. Ensuite, l’article 627, alinéa 2, permet à la Cour de cassation de mettre elle-même fin au litige en prononçant une décision sur le fond « lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ». Certains auteurs y ont vu une révolution, ou du moins une mutation fondamentale du rôle de la Cour[2], un aggiornamento nécessaire, pour reprendre l’expression de Pierre Hébraud. La Cour de cassation en fait un usage de plus en plus fréquent.
Comme on a pu le montrer, la Cour procède alors de deux manières. Dans certains cas, elle opère par retranchement : sans désapprouver sur le fond la décision attaquée, elle en supprime seulement une partie secondaire (par exemple une condamnation aux dépens ou une amende civile). Dès lors que la décision des premiers juges n’est pas remise en cause sur le fond, le renvoi de l’affaire peut en effet paraître superflu. Dans d’autres cas, en revanche, la Cour opère par substitution : elle substitue sa propre solution sur le fond de l’affaire à celle de la juridiction dont l’arrêt est cassé, au terme d’une nouvelle appréciation des faits de l’espèce. Il en est ainsi lorsque la Cour décide qu’un salarié n’a commis aucune faute grave, qu’un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le demandeur a droit à une indemnité ou encore qu’un testament olographe n’est pas nul, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges. Le juge de cassation est ici conduit à appliquer le droit à des faits complexes préalablement constatés par un autre juge, parfois pour l’application de la même règle de droit mais interprétée différemment, parfois pour l’application d’une autre règle de droit.
On a pu écrire que la Cour de cassation devenait ainsi, ponctuellement, juge du fond ; mais l’appellation est partiellement usurpée dans ce cas puisque la Cour de cassation, même lorsqu’elle statue sans renvoi, n’aura pas joui d’une plénitude de juridiction, de la souveraineté naturelle qui est celle d’un juge du fond, qui certes tranche le fond de l’affaire, mais après avoir établi et apprécié lui-même des faits.
La Cour ne pourra prononcer une cassation sans renvoi que lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. Lorsque ces constatations de fait sont insuffisantes, ou lorsque la cassation qu’elle prononce rend nécessaire un nouveau débat de fait, alors elle doit renvoyer le litige à une nouvelle cour d’appel[3]. Encore observera-t-on que c’est la Cour de cassation qui, souverainement, décide qu’est remplie ou ne l’est pas, la condition selon laquelle « les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ». Dès la fin des années 1960, Yvette Lobin, reprise ensuite par Pierre Hébraud avait noté que cette formulation laissait une place à la souplesse. Elle avait aussi suggéré que l’on conférât au juge de cassation un pouvoir identique à celui qu’il peut mettre en œuvre à propos du cas d’ouverture de la dénaturation : le juge de cassation aurait ainsi pu censurer la décision déférée et conclure à une dénaturation des faits par le juge du fond, faits qu’il aurait rétablis au moment de statuer. La formulation retenue par le législateur en 1979 n’est pas a priori compatible avec cette lecture.
Faut-il dès lors dépasser le droit positif et permettre à la Cour de cassation de se transformer, fût-ce occasionnellement, en juge du fond au sens plein du terme, doté de la plénitude juridiction en fait et en droit ?
Faudrait-il par exemple introduire dans le Code une disposition autoriserait les parties à demander à la Cour de statuer sur le fond du droit sans avoir à revenir devant le juge d’appel ? Ou même faudrait-il conférer à la Cour de cassation, le pouvoir d’évoquer devant elle l’affaire après avoir censuré le jugement ou l’arrêt d’appel soumis, pour statuer en fait comme en droit ? Autrement dit, devrait-on introduire dans le Code de procédure civile une disposition analogue à celle de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, qui permet au juge de cassation de retenir le litige devant lui et de statuer sur le fond de l’affaire « lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ? Le juge de cassation judiciaire conquerrait ainsi – pour reprendre les mots de René Chapus à propos de la disposition précitée du code administratif, la cour de cassation conquerrait, à l’instar du Conseil d’Etat en 1987, « le pouvoir de gouverner au lieu de seulement régner, c’est-à-dire (le) pouvoir de se comporter seulement en juge du fond »[4].
De fait, le Conseil d’Etat a utilisé très abondamment cette possibilité à des fins de désengorgement des juridictions d’appel. Dans son ouvrage de 2013, René Chapus mentionnait un taux de 90 pour cent de décisions de cassation n’ayant pas donné lieu à renvoi, même s’il semble que ce chiffre soit aujourd’hui nettement en déclin. Le Conseil d’Etat utilise notamment cette possibilité lorsqu’apparaît l’opportunité de régler définitivement un litige, alors même qu’il faut entrer dans les faits. Et cela parce que, d’une façon ou d’une autre, il importe de ne pas différer ce règlement. C’est le cas pour des procédures d’urgence, j’y reviendrai ; mais aussi pour mettre un terme définitif à une procédure qui s’est déjà étendue sur de nombreuses années ; ou encore par ce qu’il peut y avoir intérêt à fixer et éclairer pleinement l’état du droit, par le moyen d’un arrêt qualifiable d’exemplaire, qui prédéterminera aussi bien que possible le règlement d’affaires semblables par les juges du fond[5]. Paradoxalement, le fait pour la Cour de cassation, d’entrer ici dans les faits, lui permet de mieux asseoir, plus efficacement et avec plus d’autorité, sa fonction normative. Évidemment, on peut y voir, a contrario un facteur de rigidité dans la constitution de la jurisprudence, qui nécessite parfois plusieurs arrêts pour s’affiner[6].
L’idée de transposer cette solution administrativiste à la cassation judiciaire est, je le disais, iconoclaste, car elle va contre deux-cents ans d’histoire de la Cour de cassation. Dans le même temps, on pourrait y voir le prolongement naturel de ces réformes qui, depuis 40 ans, ont donné à la Cour de cassation le pouvoir de clore les affaires dans un certain nombre de cas. Une telle mesure supposerait simplement l’adoption d’une loi puisque l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire précise bien que « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire ». De fait, il est possible de démontrer, dans la lignée de Jacques Héron, qu’il existe bien un effet dévolutif du litige devant la Cour de cassation y compris en matière civile (en matière pénale, c’était bien sûr acquis), mais que ce sont, comme l’a montré Louis Boré, les pouvoirs du juge de cassation sur le litige ainsi dévolu qui sont limités traditionnellement au droit. Une redéfinition des pouvoirs de la Cour serait donc possible, si elle le fruit de la volonté du législateur.
La proposition de permettre aux parties de demander à la Cour de cassation de statuer sur l’affaire en droit, mais également en fait, avait naguère été formulée par l’avocat général Burgelin, qui voyait là notamment une économie de temps, d’énergie et d’argent et, surtout, je cite, « une manière, pour la Cour de cassation, de retrouver une forme de souveraineté que, par ricochet, l’article 55 de la Constitution a quelque peu malmenée ». Cette proposition fut ensuite critiquée au motif que, si le juge de cassation pouvait, à son gré, se transformer en juge du fond, « le débat de cassation risquerait de s’en trouver pollué, le demandeur au pourvoi devant plaider en fait, après avoir plaidé en droit, dans l’hypothèse où il obtiendrait la cassation demandée »[7]. Je ne sais si l’argument est rédhibitoire. Du reste, devant le Conseil d’Etat, les parties, mais est-ce une bonne chose ? , ne présentent pas de nouvelles conclusions au fond devant la Cour de cassation.
Il est vrai, en tout cas, qu’un tel changement nécessiterait, d’abord, que l’on codifiât clairement la procédure au fond devant la Cour de cassation, une procédure pleinement respectueuse du contradictoire et droits de la défense.
De surcroît, cela supposerait un changement de culture de la part de l’ensemble des acteurs de la cassation judiciaire, magistrats comme avocats aux conseils. La Cour de cassation présente une culture différente du Conseil d’Etat. Ce dernier a, en tant qu’institution, une culture de juge du fond. Il « a été pendant longtemps essentiellement juge du fond, et il le demeure lorsqu’il statue en qualité de juge de premier et dernier ressort ou de juge d’appel »[8], ce qui n’est pas le cas de la Cour de cassation. A l’inverse, on a pu écrire, à juste titre, que devenir juge de cassation judiciaire supposait une longue ascèse après des années de juridiction au fond, pour parvenir à ne statuer qu’en droit[9] et acquérir l’aptitude à ne voir dans un cas que les questions de droit.
Mais l’argument de la culture institutionnelle n’est pas rédhibitoire si l’on songe que l’institution est composée d’individus qui, eux-mêmes, ont longtemps été juges du fond. Il leur reviendrait simplement d’endosser de nouveau, à l’issue d’une affaire, leurs habits de juge du fond et de retrouver ainsi un ethos ancien.
D’un point de vue purement sociologique, il me semble – sans méconnaître l’effort que cela représenterait – que ce serait plutôt une bonne chose que de maintenir actif, chez le juge de cassation, ce cerveau de juge du fond patiemment, subtilement forgé par des années de pratique, plutôt que de le mettre artificiellement en veille, aussitôt franchi la porte du Quai de l’horloge.
J’ai conscience de lancer ici une idée iconoclaste, me pliant au jeu des propositions auquel Antoine Garapon m’a librement invitée. Il faudrait en débattre.
J’observe que l’idée était déjà plus ou moins présente sous la plume de Tunc en 1978, lorsqu’il imaginait sa Cour suprême idéale : après avoir souligné le caractère quelque peu artificiel de l’opposition supposée très rigide, entre les cours suprêmes conçues comme de véritables juridictions de troisième degré et les cours de cassation à la française, juges du seul droit, dont il notait qu’elle était fragile, il écrivait : « à vrai dire, ce n’est pas vraiment ainsi, en termes théoriques, que se pose la question. L’étiquette que l’on donne à une cour suprême importe peu. Quel que soit à son point de départ la conception que l’on se fait d’une cour suprême, on admettra certainement que sa place au somme de la hiérarchie rend peu souhaitable qu’elle soit saisie d’un problème de fait. (…) D’un autre côté, pourtant, on peut trouver que le législateur français a poussé cette idée à l’extrême, en imposant au Tribunal, puis à la Cour de cassation, s’ils “cassaient” une décision, de renvoyer l’affaire à un autre juge. N’est-il pas permis de prendre en compte l’intérêt des plaideurs et de permettre au juge de cassation, de plaider au fond (…) ? » (en leur évitant les méandres d’une nouvelle instance ultérieure). Tunc cite à cet égard le législateur néerlandais qui, dès 1838, avait ouvert cette possibilité.
Mais il me semble qu’a minima, cette solution d’une décision sur le fond prise par la Cour de cassation devrait être mise en œuvre lorsque la Cour est amenée à statuer au terme de procédures rapides, en référé notamment. Il faudrait dans ce cas, d’une part, créer un parcours rapide, privilégié, lisible, afin que de tels pourvois soient traités selon un circuit prioritaire, garantissant l’effectivité du pourvoi et de la décision issue de ce pourvoi, souvent vidée de son sens lorsqu’elle arrive trop tard. Mais il faudrait aussi permettre, dans ce cas, à la Cour de cassation, de clore elle-même le litige en statuant rapidement sur le fond, sur le fond du provisoire, si je puis dire. L’institution fourmille d’anciens présidents de juridiction qui rendirent jadis de remarquables décisions de référé et qui, j’en suis convaincue, seraient à même de statuer rapidement et efficacement sur les affaires qui leur sont soumises. Cette proposition n’est pas anecdotique puisque les affaires concernées sont bien souvent très médiatisées et engagent le crédit de la justice aux yeux de la population, qui comprend souvent mal que des décisions de la Cour de cassation en matière de référé, dans des affaires à des atteintes à la liberté d’expression notamment, soient rendues plusieurs mois après les ordonnances concernées.
Le contrôle qu’exerce la Cour de cassation en matière de référé, que ce soit sur la notion d’obligation non sérieusement contestable ou encore de trouble manifestement illicite sert aujourd’hui de boussole, une boussole essentielle, aux juges des référés des premiers et second degré. Boussole qui est d’autant plus précieuse depuis que la Cour EDH a décidé, par le revirement issu de l’arrêt Micaleff en 2011, que les procédures provisoires étaient soumises aux normes du procès équitable. Mais encore faut-il que ce contrôle nécessaire, salutaire, soit effectué dans des temps qui assurent l’effectivité des mesures provisoires ordonnées. C’est ce que pourrait permettre la solution dont je viens d’esquisser les grandes lignes.
Il faut ajouter que ces affaires urgentes engagent souvent une mise en balance des droits fondamentaux, un contrôle de proportionnalité dont la Cour de Strasbourg peut connaître ensuite (mise en balance entre vie privée et liberté d’expression par exemple). Il me semble donc qu’une décision de la Cour de cassation, soigneusement motivée sur ces questions, pourrait avoir beaucoup de sens et permettrait effectivement à la France d’éviter certaines condamnations et les « blessures narcissiques »[10] qu’elles représentent parfois, à tort ou à raison.
J’ai conscience qu’en faisant cette proposition, je fais peut-être entrer le loup dans la bergerie ! Mais on m’a demandé de susciter la réflexion en lançant des idées afin qu’elles donnent lieu, le cas échéant à la discussion et à la critique.
…………………………
On observera toutefois qu’une voie fréquemment suggérée pour limiter l’accès à la Cour de cassation consiste précisément – et sans doute paradoxalement par rapport à ce sentiment de « dégradation » de la Cour de cassation par rapport à la Cour EDH – au contraire, à recentrer la Cour de cassation sur les cas d’ouverture qui impliquent le moins une attention, fût-elle indirecte, aux faits du litige – ceux qui recentreraient la Cour sur sa mission de pur juge du droit au sens le plus strict de ce terme.
L’activité de la Cour devrait, si l’on suit ce raisonnement alors se recentrer sur la règle de droit la plus pure… La Cour devrait refuser d’aborder tout ce qui, de près ou de loin, impliquerait une immixtion dans le fait. Où l’on voit que la volonté de désengorger la Cour n’est pas toujours en harmonie avec le constat supposé d’une Cour qui serait trop éloignée des faits…
C’est ainsi que le contrôle de la dénaturation des faits a pu être contesté comme constituant une dérogation au principe selon lequel la Cour de cassation serait juge du droit et non du fait[11]. De même, le cas d’ouverture du manque de base légale semble au cœur d’un paradoxe. D’un côté, tous ceux qui veulent recentrer la Cour sur sa mission dite « normative » sont prompts à en souhaiter la disparition. Cette piste de réforme est exposée en France depuis longtemps : cf déjà le président Bel, repris ensuite par l’avocat général Burgelin en 2001). L’idée est qu’en entrant dans le contrôle détaillé de l’application de la loi, il conduirait le juge à un processus d’investigation du fait qui ne serait pas nécessaire. Dans le même temps, on observera que ce cas d’ouverture est précisément l’un de ceux qui, paradoxalement, marquent le plus la modernité du juge de cassation qui pousse l’examen de la règle de droit jusqu’à ses conditions d’application et suppose une véritable attention aux faits de l’espèce et à leur caractère déterminant pour la juste application de la règle de droit. De fait, c’est aussi sur des arrêts rendus sur des cassations pour manque de base légale que des décisions importantes ont pu être rendues par le passées et « faire jurisprudence ».
Penser que le manque de base légale serait entièrement étranger à la mission normative de la Cour serait donc tout à fait inexact. Peut-on même, dans notre exercice de juridique-fiction, aller jusqu’à imaginer que, précisément, la Cour de cassation puisse, dans certaines affaires du moins, aller jusqu’à acquérir les pouvoirs d’instruction qui lui permettraient d’élucider aussitôt les faits pertinents et de statuer par elle-même, après avoir constaté ce manque de base légale ? Cela ne pourrait se faire qu’au prix d’une sélection, par la Cour elle-même, des affaires dignes d’un tel traitement. Cela supposerait le basculement d’une conception démocratique de la Cour de cassation à une conception aristocratique, qui semble peu compatible avec la tradition républicaine française.
Une autre difficulté ne doit pas être négligée : en conférant à la Cour de cassation, fût-ce de manière délimitée, le pouvoir de statuer sur le fait comme sur le droit, ne risque-t-on pas de la soumettre à un risque de condamnations beaucoup plus fréquentes que celles auxquelles elle est aujourd’hui exposée ? On part souvent du principe qu’une telle réforme éviterait à la Cour de cassation l’infamie des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg mais on ne peut pas être assuré de ce que, par un effet inattendu, il pourrait y avoir, au contraire, un essor de telles condamnations, en raison des divergences de vues entre les deux cours. Plus généralement, modifier les pouvoirs de la Cour de cassation ne ferait pas changer la position institutionnelle de la Cour de Strasbourg et le principe selon laquelle elle est saisie après épuisement des voies de recours internes, dont le recours en cassation fait partie. La Cour de cassation sera alors plus exposée aux recours susceptibles d’être formés devant la CEDH. Et cette dernière aura toujours le dernier mot. En revanche, il est vrai qu’un bienfait qualitatif pourrait en ressortir, j’y reviendrai, si les motivations de telles décisions étaient plus complètes et plus explicites : si elles étaient mieux motivées, en fait et en droit, peut-être les décisions de la Cour de cassation française seraient-elles mieux reçues par les autres cours suprêmes, moins remises en question est même, pourquoi pas, imitées.
– Une autre question souvent posée est celle des contours qu’il convient de donner, de lege ferenda, au contrôle de la qualification par la Cour de cassation. La qualification, comme chacun sait, est l’opération intellectuelle qui permet le passage du droit au fait. Là encore, plusieurs solutions sont possibles : l’une des manières triviales de désengorger la Cour est de proposer qu’elle abandonne, dans bien des cas, un tel contrôle – ce qu’elle fait du reste déjà pour partie. Certains ont ainsi proposé qu’elle renonce à contrôler toutes les notions qui seraient chargées d’une certaine subjectivité, telles que la faute. Mais d’autres ont fait remarquer que la jurisprudence a souvent contribué, au contraire, à entourer l’emploi de cette notion cardinale d’une certaine sécurité juridique.
Une autre remarque : il me semble que la difficulté ne porte pas seulement sur la plénitude de juridiction entendue comme le pouvoir de statuer sur le fait comme sur le droit. La Cour de cassation pêche encore parfois par une forme de timidité au regard de l’application de la règle de droit elle-même, singulièrement lorsqu’elle est issue des normes de protection des droits de l’homme. Elle s’autolimite ainsi dangereusement par rapport aux pouvoirs que se donne volontiers la Cour EDH.
Cette dernière a en effet une aptitude pleine et entière à examiner les faits qui lui sont soumis à l’aune de toutes les règles de droit contenues dans la convention, qu’elles aient ou non été invoquées par les parties. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg le précise – je cite : « … une fois régulièrement saisie (elle) peut connaître de chacun des problèmes de droit qui surviennent en cours d’instance à propos des faits soumis à son contrôle par un Etat contractant ou par la Commission ; maîtresse de la qualification juridique à donner aux faits, elle a compétence pour les examiner, si elle le juge nécessaire et au besoin d’office, à la lumière de l’ensemble de la Convention ». La Cour de Strasbourg fait du reste une application large du principe jura novit curia et de son droit d’examiner la demande du requérant sous l’angle de la disposition de la convention qu’elle juge la plus pertinente (elle a ainsi pu retenir une violation de l’article 8 alors que les requérants invoquaient celle de l’article 10).
La Cour de cassation française, de ce point de vue, est quelque peu en retrait puisque, jusqu’à une période récente encore, certaines chambres de la Cour hésitaient à relever d’office les moyens de droit tirés du non-respect des droits de l’homme, alors qu’à l’évidence il s’agissait de moyens de pur droit. On ne peut que souhaiter que la Cour s’emploie activement à relever d’office, le cas échéant, de tels moyens, ce qui serait déjà la meilleure façon d’éviter d’inutiles condamnations ultérieures de la part de la Cour de Strasbourg (cf article Ferrand Guinchard Moussa au Recueil Dalloz 2015).
Les pages de Chiovenda sur ce point sont lumineuses : « la violazione di legge puo dinunciarsi anche se non era stata rilevata nè in primo grado nè in secondo grado : per il prinicipio juria novit curia infatti il giudice deve d’ufficio applicare la norma di legge che fa al caso, ela domanda del privato non lo vincola in questo campo » (Principi, p. 1025) : on peut reprocher une violation de la loi même si elle n’a pas été invoquée en première ou deuxième instance : en vertu du principe jura novit curia, en effet, le juge doit relever d’office la règle de droit applicable à l’espèce, et la demande du d’une partie ne le lie pas dans ce domaine ».
En France, ce débat a pris un tour aigu avec un arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 décembre 2013 par la 1ère chambre civile (pourvoi n° 12-26066). Dans cette affaire, la Cour relève d’office le moyen tiré d’une violation, par le juge du fond, de l’article 8 de la Convention EDH. Il retient qu’en l’espèce, le prononcé de la nullité d’un mariage entre une femme et le père de son ex-mari revêtait le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect à la vie privée et familiale « dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans ».
Chacun a interprété cet arrêt comme il le voulait, du point de vue des fonctions, réelles ou prospectives, de la Cour : les uns y ont vu un refus d’application de la loi française (art. 161 du code civil qui prohibe une union incestueuse de cette nature) à un cas d’espèce, une violation de la loi par la Cour de cassation elle-même – ce qui me paraît excessif et être une manière d’oublier que la règle de droit applicable pouvait être aussi, dans cette affaire, l’article 8. Cette vision me paraît excessive. D’autres ont pensé que la technique de cassation « à la française » trouvait ici ses limites et que la Cour de cassation aurait été ainsi amenée à des contorsions pour permettre à son raisonnement réel d’entrer dans le moule du syllogisme juridique traditionnel. L’arrêt marquerait ainsi la nécessité d’une refondation – ou peut-être d’une disparition – de la technique du pourvoi en cassation, dernière scorie de la tradition continentale (Jestaz, Marguénaud etc.).
D’autres enfin, y ont vu au contraire l’illustration parfaite de ce que la technique du pourvoi serait pleinement moderne et adaptée au droit contemporain. Elle permettrait en effet à la Cour de cassation, par le biais d’un contrôle de la qualification sur la notion d « ingérence injustifiée dans l’exercice du respect de la vie privée » au sens de l’article 8, d’écarter en l’espèce l’application de l’article 161 du code civil au cas d’espèce. Ce dernier argument me paraît exact : au fond, la Cour de cassation s’est bien prononcée en droit, à propos des faits tels qu’ils lui avaient été soumis par les juges du fond. Elle n’a donc pas commis d’ingérence dans le territoire des faits. Elle s’en est tenue à l’édifice des faits établi devant les juges du fond ; simplement elle a exercé son contrôle sur la qualification, ce qui supposait de sa part l’exercice d’un contrôle de proportionnalité, auquel elle s’est livrée à l’aune de la jurisprudence de la Cour EDH sur ces questions.
Je poserai toutefois une réserve importante à cette affirmation d’adaptation de la technique de cassation à un tel pourvoi. Il me semble en effet que tant que la motivation des arrêts de la Cour de cassation ne sera pas plus étoffée, ses décisions donneront lieu à un sentiment d’arbitraire, particulièrement lorsqu’elles sont liées à une qualification supposant l’exercice d’un contrôle de proportionnalité. A terme, elle encourt, du reste, le risque d’une censure par la Cour EDH, qu’il vaudrait mieux convaincre, en amont, par une argumentation irréfutable, de la qualité du raisonnement poursuivi. En l’espèce, la motivation factuelle de la décision de la Cour tenait en 2 arguments, eux-mêmes énoncés en onze mots : « dès lors que cette union, célébrée sans opposition (argument numéro 1), avait duré plus de vingt ans (argument numéro 2). C’est un peu court, jeune homme, aurait dit Cyrano de Bergerac…
Mais l’on touche alors à la question de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, qui sera précisément au centre de l’un de nos prochains séminaires.
[1] En ce ce sens, Burgelin ibid.
[2] P. Hébraud, Aggiornamento de la Cour de cassation, D. 1979, Chron. p. 205 ; M. Jeantin, Réformer la Cour de cassation ?, in Mélanges offerts à P. Hébraud, Toulouse, 1981, p. 465 s., citation p. 468, n° 6.
[3] Voir Boré Recueil Dalloz 2005, « Quelques idées sur le pourvoi en cassation ».
[4] R. Chapus, Contentieux administratif, 2013, p°1319.
[5] R. Chapus, Contentieux administratif, 2013, p°1324.
[6] Voir les inquiétudes d’Hébraud en 1979.
[7] Boré Recueil Dalloz 2005.
[8] Boré Recueil Dalloz 2005.
[9] Boré Recueil Dalloz 2005.
[10] R. Koering-Joulin, in N. Molfessis (dir.), 2004. La Cour de cassation.
[11] Aubert 2005
[i] Principi p. 1024