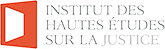Quelques repères biographiques permettent de situer Sigmund Freud en Europe et dans son siècle. Freud naît en 1856 à Freiberg en Moravie ; sa famille s’installe à Vienne en 1860. Freud fait toutes ses études à Vienne, mais ses deux demi-frères vivent à Manchester, où il séjourne en 1875 et envisage un temps de s’établir ; il restera toujours très attaché à l’Angleterre mais revient à Vienne ; il séjourne à Paris en 1885-1886 dans le service de Charcot à la Salpêtrière. Par la suite, Freud effectue de nombreux voyages en Allemagne, en Italie. Très jeune, il est témoin de l’humiliation antisémite infligé à son père à Freiberg et aura à cœur de le « venger ». Quand sa famille s’installe à Vienne, c’était l’époque, écrit-il, « où tout petit juif laborieux portait dans son sac d’écolier un portefeuille de ministre ». Mais il va connaître aussi la force de l’antisémitisme viennois, notamment lorsque Karl Lueger – dont Hitler se réclamera – sera maire de Vienne (1897-1910).
Freud est européen comme le sont les juifs viennois. Il a une grande culture classique, connaît Goethe par cœur, et quand ce ne sont pas ses vers qu’il place en épigraphe de ses livres, c’est Virgile qui lui vient en tête, comme pour L’Interprétation du rêve. Freud est un homme des Lumières, un rationaliste, critique des illusions (religieuses notamment) et du fanatisme. Mais le point de vue du psychanalyste, naturellement, est aussi de se demander quelle fonction ont les illusions, quelle détresse ou fragilité elles voudraient compenser, quelle est la force de la raison face aux affects, quelles sont les origines psychologiques du fanatisme. L’attachement de Freud à l’Europe est inséparable de son appréciation de la culture et du rôle qu’il accorde au processus de culture face à la nature pulsionnelle de l’homme d’un côté, face aux désillusions très profondes causées par la Première Guerre mondiale et sa conception de la masse de l’autre. Freud gardera toujours cette position délicate, entre l’attachement au processus de culture et le pessimisme quant au destin de cette même culture.
Le travail de culture (Kulturarbeit)
Qu’est-ce qui peut rendre supportables à l’individu les sacrifices imposés par la société ? Car les névroses proviennent du degré de renoncement imposé par la culture aussi bien à la sexualité qu’aux tendances à l’agression et à la destruction. Mais la culture est tout autant responsable de nos malheurs qu’elle est la seule possibilité de les amoindrir. La tension causée par « l’insociable sociabilité » des hommes est permanente et l’antagonisme entre recherche du bonheur et unité de la communauté est au centre du Malaise dans la culture (1930). Une des réponses se trouve dans la sublimation, du travail ou de l’art par exemple, qui a pour avantage de dériver les pulsions sur des objets socialement valorisés, partageables, socialement utiles sans exiger la répression, l’inhibition ou la frustration. Mais tout le monde n’est pas Léonard de Vinci, pour prendre l’exemple princeps de la sublimation pour Freud, et les exigences pulsionnelles, qu’elles soient sexuelles ou destructrices, menacent en permanence le fragile équilibre de l’individu comme de la société.
Pour autant, jusqu’à la fin de sa vie, Freud estimera nécessaire un travail de culture qu’il compare à l’assèchement du Zuyderzee et qui trouve un analogue personnel dans le travail analytique. Là, il s’agit de « faire advenir du moi là où était du ça » (Wo Es war, soll Ich werden, 31e conférence, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 1933). Mais quel est l’équivalent collectif de ce programme individuel ? Sur quelles instances collectives ou institutions peut s’appuyer un processus ou un travail de culture ? Dans Le Malaise dans la culture, Freud fait l’hypothèse d’un surmoi culturel (Kultur-Über-Ich) formé comme celui de l’individu par intégration des valeurs et des exigences des hautes figures de la culture et à l’origine de l’éthique. Mais l’extension à la collectivité de notions que Freud met en évidence à l’échelle de l’individu ne va pas de soi et, à peine a-t-il posé l’existence de cette instance, qu’il doute de son pouvoir : elle est à la fois trop sévère et impraticable. Ainsi le précepte « Aime ton prochain comme toi-même » est-il le meilleur exemple de la méconnaissance idéaliste de la nature humaine qui émane de ce surmoi. Méconnaissance analogue dans le communisme, dont Freud estime que le support psychologique est la persécution des bourgeois : « On se demande avec inquiétude ce que les Soviets entreprendront une fois qu’ils auront exterminé leurs bourgeois (1). »
Et pourtant, le Freud rationaliste se fait encore entendre quand il envisage dans la lettre à Einstein de septembre 1932, « Pourquoi la Guerre ? » (Warum Krieg ?), une « dictature de la raison » (Diktatur der Vernunft) pour contrer la tendance à la guerre attribuée à la pulsion de destruction : « L’état idéal serait naturellement une communauté d’hommes ayant soumis leur vie pulsionnelle à la dictature de la raison ». Outre la résonance étrange sous la plume de Freud du terme de dictature, fût-elle celle de la raison (opposée à la puissance de la religion), il s’agit là « d’une espérance utopique », comme il l’écrit trois lignes plus loin. Cette espérance est celle des Lumières, celle-là même formulée par Kant près de 150 ans plus tôt dans le texte « Qu’est-ce que les Lumières ? » (1784) : qu’un « public éclairé », pensant par lui-même, propage l’accès à la raison pour le grand nombre. Pourtant, la question de Freud (ou celle d’Einstein) n’est pas exactement celle de l’accès à une pensée autonome. Elle est plutôt de savoir par quels moyens la culture peut tenter d’éduquer les hommes de telle sorte qu’ils puissent résister aux impulsions de haine ou les transformer, les diriger dans un sens plus compatible avec des buts civilisés. En un sens, la notion freudienne de « travail de culture » étendue à la société n’est sans doute pas si éloignée de ce que Norbert Elias entend presqu’à la même époque par « Processus de civilisation » (1ere édition, 1936), avec ce que ce processus contient d’intériorisation des contraintes et de refoulement (2).
La Première Guerre mondiale
Dans un texte qu’il a rédigé en 1961-62, à l’occasion du procès d’Eichmann à Jérusalem, Norbert Elias revient sur ce qu’il nomme « L’effondrement de la civilisation ». Cet effondrement est lié à la régression à la barbarie nazie dans ce « processus de civilisation » que les élites européennes pouvaient penser bien installé. Si bien installé que la notion de civilisation paraissait un « héritage naturel du groupe des nations européennes », alors même que les guerres n’avaient selon Elias représenté que des régressions relativement limitées (3). On ne sait pas ce que Freud aurait pu dire de la destruction systématique des juifs d’Europe. Mais quand il meurt à Londres en 1939, il a compris pas mal de choses : sa fille Anna a été arrêtée par la Gestapo et assez miraculeusement relâchée, ses archives ont été pillées, il a laissé à Vienne ses quatre sœurs plus âgées (elles seront toutes exterminées). Mais bien avant les années 30, avant les réflexions de 1921 sur la psychologie de masse, dans sa vie comme dans son œuvre, la Première Guerre mondiale marque un tournant.
En 1914, Freud a 58 ans ; son œuvre est importante même si elle est loin d’être achevée ; la première Société de psychanalyse a été fondée à Vienne en 1908 ; en septembre 1909, Freud a fait un voyage aux États-Unis avec Jung et Ferenczi et donné des conférences sur la psychanalyse à l’université Clark de Worcester (Massachussetts). Le mouvement est donc européen, avec une extension aux États-Unis : après Vienne, des sociétés de psychanalyse se forment à Berlin, Budapest, Zurich, Londres, Paris et suscitent un intérêt en Russie.
Quand la guerre éclate, contrairement à Romain Rolland qui l’avait anticipée depuis longtemps et l’a dénoncée d’emblée, ou contrairement à Stefan Zweig, Freud est pris au dépourvu. En décembre 1912, il écrivait au pasteur Pfister : « l’attente de la guerre nous coupe presque le souffle », mais en juillet 1914 il y pense si peu qu’il laisse sa fille Anna partir à Londres. Il est alors en plein dans la préparation de son congrès de psychanalyse et dans sa guerre personnelle avec Jung. Il vient de publier « Pour introduire le narcissisme ». Il espère que la guerre restera localisée aux Balkans, et partage même brièvement l’exaltation collective belliciste. A Karl Abraham (qui vit à Berlin), il écrit le 26 juillet 1914 que c’est peut-être la première fois depuis trente ans qu’il a le sentiment d’être autrichien et qu’il veut bien encore donner une chance à ce Reich dont il n’y a pourtant pas beaucoup à espérer. Il attend le soutien de l’Allemagne, tout en se demandant si l’Angleterre (où vit une partie de sa famille) « ne se mettra pas du mauvais côté » (4). Il parle de « nos batailles » et « nos victoires ».
Mais dès le début août, il sait que le conflit est devenu européen ; et très rapidement se sent peu patriote, peu enclin à défendre l’Allemagne ou l’empire austro-hongrois. Il écrit en mars 1915 à Abraham que « son cœur n’est pas à Vienne mais aux Dardanelles où se décide peut-être le destin de l’Europe ». Plus la guerre dure, plus c’est à la paix qu’il aspire alors que ses fils sont tous trois au front (5).
Après la guerre, Freud sera profondément marqué par la mort de sa fille Sophie, en 1920, d’une pneumonie consécutive à la grippe espagnole, puis par celle de son petit-fils Heinele, en 1923. La guerre est en arrière-fond : « La brutalité sans voile de l’époque pèse sur nous », écrit Freud au pasteur Pfister le 27 janvier 1920.
Les écrits sur la guerre
Deux textes écrits en 1915 témoignent du désenchantement et des désillusions de Freud. Ce désenchantement n’est pas seulement lié aux violences de la guerre mais à l’impuissance de la culture. Dès novembre 1914, il écrit à Lou Andreas-Salomé : « je ne doute pas que le monde se remettra de cette guerre-ci, mais je sais avec certitude que moi et mes contemporains ne verrons plus le monde sous un jour heureux. Il est trop laid… ».
En novembre 1915, la Société Goethe demande à Freud un texte pour un volume consacré à « La terre de Goethe ». Le titre du texte, « Ephémère destinée » (Vergänglichkeit, « Passagèreté » dans une autre traduction), est une allusion à des vers de Faust : « Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis » (« Tout ce qui passe n’est que symbole »). C’est aussi le titre d’un poème de Rilke. Freud met en scène deux amis (sans doute Rilke et Lou Salomé) se promenant avec lui pendant l’été 1913 et déplorant que la beauté du monde soit passagère. Freud conteste ces propos sans convaincre ses interlocuteurs. Mais il conclut : « Un an plus tard, la guerre éclatait et dépouillait le monde de ses beautés (…) Elle nous dépouillait de tant de choses que nous avions aimées et nous montrait la caducité de maintes choses que nous avions tenues pour persistantes (6) . » Pourtant, il défend l’idée qu’une fois le deuil achevé, notre estime des biens culturels et de la beauté reviendra et que « nous reconstruirons ce que la guerre a détruit, peut-être sur une base plus solide et plus durablement qu’auparavant ». Freud veut-il s’en persuader lui-même ?
Toujours en 1915, les « Considérations actuelles sur la guerre et la mort » ont un autre ton. Freud rédige cet essai en mars/avril 1915. Il a perdu l’illusion d’une guerre brève et pris la mesure de son horreur. Il est par ailleurs plongé dans un travail d’écriture et d’élaboration théorique considérable qui marque une apogée de la constitution de la métapsychologie, comme si le travail et la réflexion étaient la seule arme contre l’offense de la guerre à l’encontre des idéaux.
Les « Considérations actuelles sur la guerre » débutent par une description de la situation d’un européen en forme d’autoportrait : « Pris dans le tourbillon de ce temps de guerre, informés unilatéralement, sans recul par rapport aux grandes modifications qui se sont déjà accomplies (…) nous ne savons même plus quelle signification donner aux impressions qui nous assaillent et quelle valeur accorder aux jugements que nous formons. Il nous semblera que jamais encore un événement n’avait détruit tant de biens précieux communs à l’humanité, frappé de confusion tant d’intelligences parmi les plus claires, si radicalement rabaissé ce qui était élevé (7). »
Bien loin du romantisme, de l’appel à l’héroïsme, de la moindre fascination pour la machine de guerre, la guerre est au contraire la responsable de la misère psychique de « ceux de l’arrière » : misère qui excède largement les difficultés matérielles puisque c’est de la désillusion causée par la guerre que Freud traite.
Il faut donner à désillusion (Enttäuschung) un sens fort : déception, tromperie. Les illusions auxquelles cette guerre contraint à renoncer en 1915 sont en premier lieu celles de la paix entre nations ou peuples « civilisés » : on avait espéré que les grandes nations puissent régler leurs conflits autrement. C’est de la morale civilisée et de son inaptitude à régler les conflits, de son impuissance, que provient la déception. Et la désillusion est à la mesure de la confiance puis de l’espérance déçue en la morale, la culture et les valeurs européennes.
Espoir toujours déçu : étranger et hostile sont des équivalents, comme ils l’étaient pour les Grecs de l’antiquité, comme ils le sont pour l’enfant. Dans ce texte de 1915, Freud défend encore la culture allemande et sa propre langue (il recevra le prix Goethe en 1930), il défend l’Allemagne accusée de « barbarie » en des termes qui prennent, après le nazisme, une résonance inouïe (8) : « [La guerre] fait apparaître ce phénomène à peine concevable : les peuples de la culture se connaissent et se comprennent si peu que l’un peut se retourner contre l’autre, plein de haine et de répulsion. Bien plus, une des plus grandes nations de la culture est si généralement mal aimée qu’on peut prendre le risque d’essayer de l’exclure, en tant que “barbare“, de la communauté de la culture, bien qu’elle ait prouvé depuis longtemps par les contributions les plus grandioses son aptitude à en faire partie. Nous vivons dans l’espoir qu’une histoire écrite impartialement apportera la preuve que cette nation justement, celle dans la langue de laquelle nous écrivons, pour la victoire de laquelle combattent ceux qui nous sont chers, est celle qui a le moins manqué aux lois de la civilisation (Gesittung) humaine ; mais qui a le droit en pareil temps de se poser en juge de sa propre cause? » (9) Qui a le droit en effet, mais surtout de quelle cause s’agit-il ? Car très vite, le ton change ; Freud constate avec effroi comment, en temps de guerre, tout État s’arroge le monopole de l’injustice, s’affranchit des traités et des droits par lesquels il était lié aux autres Etats, il enregistre l’abaissement éthique et l’incroyable « manque de discernement », l’inaccessibilité aux arguments convaincants dans les deux camps (10).
En 1915, le constat du tort causé à la culture est donc le suivant : l’Europe n’est pas un musée où les différentes nations peuvent coexister, où l’on pourrait avoir une identité d’européen. « Le citoyen du monde de la culture peut se trouver désemparé dans un monde qui lui est devenu étranger – sa grande patrie en ruine, les biens communs dévastés, les concitoyens divisés et rabaissés ! » (11) La grande patrie en ruine est le monde européen, le vaste musée qu’elle formait et dans les salles duquel le citoyen pouvait déambuler (12).
Car telle est l’Europe que, selon Freud, la guerre a ruinée : un paradis de la nature et de la culture qui unirait « mer bleue et mer grise », Italie et Allemagne. L’Europe n’est plus « l’École d’Athènes » rêvée par les peintres et les humanistes de la Renaissance ou par les philosophes et écrivains des Lumières ; la communauté de cultures et de langues n’existe pas, ou en tout cas elle ne résiste pas à la destruction des liens causée par la guerre. Freud relie étroitement ces deux types de pertes : celle des vies humaines et celle de la croyance au progrès et à la civilisation, à une « morale supérieure », au règne du droit. Cette guerre est la plus effroyable en raison des valeurs et des différences qu’elle piétine : blessés / non blessés, belligérants / civils. À cet égard, elle ouvre une ère nouvelle, condamnant le futur avec le présent. Freud porte sur l’avenir ce jugement d’une lucidité redoutable : « [La guerre] rompt tous les liens faisant des peuples en lutte une communauté, et menace de laisser derrière elle une rancœur qui pendant longtemps ne permettra pas de les renouer (13). » La désillusion révèle le caractère narcissique de notre investissement de la culture, investissement qui se révèle surestimation, résultat d’une idéalisation, comme Freud y reviendra en 1927 dans l’Avenir d’une illusion. Mais en 1915, cruelle ironie et affront à la culture, c’est la guerre elle-même qui opère la dénonciation des illusions, d’ordinaire l’apanage de la psychanalyse, de la philosophie ou de toute pensée critique.
Les raisons de la désillusion tiennent à la fois aux individus et aux collectivités. Sur la question de la brutalité des individus, la position de Freud ne variera pas. L’homme est un être pulsionnel, ses pulsions demandent satisfaction sans considération pour des motifs moraux. Les formulations de Malaise dans la culture sont célèbres : l’homme n’est pas un être doux, en besoin d’amour, qui serait tout au plus en besoin de se défendre quand il est attaqué ; il compte parmi ses pulsions un très fort penchant à l’agressivité et le prochain est pour lui à la fois une aide, un objet sexuel possible mais aussi un objet de tentation pour satisfaire son besoin d’agression. Freud reprend la formule de Hobbes : l’homme est un loup pour l’homme. Qui, ajoute-t-il, aurait le courage de contester cette maxime après les expériences de la vie et de l’histoire (14) ? Mais, en 1915, avant ce qu’il est convenu d’appeler « l’introduction de la pulsion de mort » (en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir), les pulsions de l’individu, ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, ni de vie ni de mort, sont de toute façon égoïstes et antisociales. L’altruisme, le dévouement sont des formations réactionnelles à la culpabilité ou à la peur de perdre l’estime ou l’amour de ceux dont on dépend. En aucun cas ces vertus ne sont « naturelles ». L’éducation et la culture apprennent à l’homme à renoncer à la satisfaction de ses pulsions.
C’est pourquoi les secondes raisons de la désillusion, celles qui proviennent de la brutalité des États soi-disant civilisés, sont les pires. Avec l’effondrement de la culture, non seulement c’est la seule borne opposée aux instincts qui disparaît, mais de plus la barbarie des nations vient redoubler celle des individus.
Ainsi, même si l’effondrement de la culture n’était que provisoire, du fait de la guerre, les désastres et les ravages de la cette dernière ne demeureraient pas moins vifs. L’hypothèse d’une « hypocrisie de la culture » ne serait pas balayée (15). Mais que « l’aveuglement dont la guerre a frappé, comme un charme, les meilleurs esprits (16) », soit un phénomène secondaire, consécutif à l’excitation affective, n’est en rien une consolation. C’est seulement la preuve que, lorsque le discernement devrait prévaloir, c’est précisément le moment où il est balayé par les passions. La conclusion est donc implacable : « Dans ce cas, tout se passe comme si toutes les acquisitions morales des individus s’effaçaient dès lors qu’on réunit une pluralité, voire même des millions d’hommes, et qu’il ne restât plus que les attitudes psychiques les plus primitives, les plus anciennes et les plus grossières (17). » Le nombre balaie la culture, et là où Totem et tabou (1912) fondait la culture sur le meurtre d’un seul (le père de la horde), « le meurtre de masse que cette guerre impose détruit notre monde de culture et impose l’idée d’une mort de masse pour une “psyché de masse” », idée poursuivie dans Psychologie des masses et analyse du moi (1921).
Psychologie des masses
L’intérêt de Freud pour les phénomènes collectifs n’est pas nouveau. D’une certaine manière, à partir du moment où il fait du parricide le crime originel et voit dans les tragédies la trace de ce meurtre dans la culture, il ancre la vie d’âme individuelle dans un phénomène collectif. Mais en explorant la dimension animiste de la pensée et de sa toute-puissance, c’est le primitif en nous qui occupe le devant de la scène, et c’est la régression que Freud va installer au cœur de sa réflexion sur la masse. Freud fait, dans Totem et tabou, l’hypothèse d’une « psyché de masse » (Massenpsyche), c’est-à-dire d’une psyché collective, mais « dans laquelle les processus psychiques s’accomplissent comme dans la vie psychique d’un individu (18)». Par l’intermédiaire de cette psyché de masse, le sentiment de culpabilité, par exemple, se perpétue. Psychologie des masses et analyse du moi peut être considéré comme le développement de cette réflexion. Il s’agit bien méthodologiquement d’une psychologie des masses, non d’une psychanalyse. Mais, en même temps, ce n’est pas un ouvrage de psychologie sociale à proprement parler, encore moins un ouvrage de sociologie : l’objet de Freud n’est pas le socius en général, et le groupe ne se voit pas doté de la spécificité que le sociologue lui accorde en tant qu’entité globale. Il s’agit à la fois de montrer dans la psychologie individuelle une strate collective (une âme ou une psyché de masse) et de montrer dans la psychologie collective la vie individuelle, d’en faire une étude de psychanalyse appliquée, c’est-à-dire de proposer l’application de la psychanalyse du moi à la psychologie des masses. C’est dire que seules certaines caractéristiques « des masses » seront analysées, et ceci sans perspective historique. Il n’en est que plus troublant, du même coup, de constater que l’analyse de Freud semble s’appliquer de manière privilégiée aux phénomènes de masse du XXe siècle, en particulier aux masses avec meneur des totalitarismes fasciste, nazi et stalinien.
Le passage par l’étude des deux masses « artificielles », c’est-à-dire conventionnelles et hautement organisées, que sont l’Église et l’armée permet à Freud de faire de l’amour (libido) le facteur de la cohésion de la masse et de préciser la différence de ce lien avec les liens affectifs habituels. Bien loin d’être un amas contingent, la masse devient dès lors un groupe structuré, et très précisément structuré, par les liaisons libidinales avec le meneur et par celles de stricte égalité qui sont induites entre les membres. L’individu connaît une modification de son fonctionnement psychique : son affectivité s’accroît, son rendement intellectuel se restreint (19). Les liens entre les individus sont dénués de l’ambivalence des sentiments ordinaires : l’hostilité, l’intolérance en sont exclues ; le narcissisme y est limité par le lien au meneur. Du même coup, écrit Freud : « si une autre liaison de masse vient à la place de la liaison religieuse comme la liaison socialiste semble actuellement y réussir, il en résultera envers ceux qui sont en dehors la même intolérance qu’à l’âge des luttes de religion (20)». Le destin de la haine est qu’elle soit projetée à l’extérieur ; la masse rejette l’étranger à l’extérieur et se soude par identification au meneur (Führer). C’est autour de l’identification que Freud élabore la communauté affective dans la masse. Dans la masse, comme dans la relation hypnotique, le meneur est mis à la place de l’idéal du moi (entendons par « idéal du moi » un modèle auquel la personne cherche à se conformer de façon consciente ou non) et tous les individus peuvent s’identifier les uns aux autres (ayant le même modèle). La stabilité, même relative, d’une telle masse ne passe que par une aliénation complète et générale : l’aliénation de tous au profit du meneur est ce qui garantit l’égalité de chacun (l’identification de tous les membres de la masse). Bien entendu, il existe d’autres types de masse, plus temporaires, qu’étudie par exemple Elias Canetti dans Masse et puissance (1969).
La force de Psychologie des masses, la puissance heuristique et explicative que les années qui suivent ce texte lui ont immédiatement donnée pour ce qui concerne les masses avec meneur, ne doivent pas nous empêcher de marquer les écarts absents de ce texte : l’écart entre individu et groupe, entre surmoi individuel et collectif, l’écart entre masse et héros culturels, l’écart entre idéaux et processus de culture et l’ambivalence de ce dernier (21) . Les écarts sont porteurs de conflictualités, donc dynamiques. Même si le surmoi culturel, ou collectif, est difficile à penser, il est porteur de valeurs ; même si le travail de culture et le processus sublimatoires sont fragiles, ils maintiennent l’écart entre démocratie et régimes totalitaires. Du côté de l’individu, le bonheur est un but essentiel ; du côté culturel, un élément dont on se passerait volontiers. L’écart disparaît soit lorsque le bonheur devient idéal collectif, soit lorsque l’idéal social uniformise les liens individuels, le lien identificatoire (obligatoire) soudant les individus en masse.
Concluons sur les derniers mots du Malaise dans la culture: « Les hommes sont parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu’avec l’aide de ces dernières il leur est facile de s’exterminer les uns les autres jusqu’au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fonds d’angoisse. Et maintenant, il faut s’attendre à ce que l’autre des deux puissances célestes [allusion à Goethe], l’Eros éternel, fasse un effort pour s’affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel [la destruction]. Mais qui peut présumer du succès et de l’issue? (22)».
—
1) Sigmund Freud, Le Malaise dans la culture, Œuvres complètes, Puf, 1994, t. XVIII, p. 301.
2) Je laisse de côté l’antithèse civilisation/culture que Norbert Elias dégage dans la pensée et l’histoire allemandes, la culture étant du côté des arts et des sciences, la civilisation du côté du convenances et des politesses « à la française ».
3) Norbert Elias, Les Allemands, Seuil, 2017, p. 408-409.
4) Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, t. II, Puf, p. 182.
5) Martin en Galicie et Russie, Ernst en Italie, Olivier dans le génie ; aucun ne meurt mais Martin est blessé deux fois. En janvier 1919, Martin est encore prisonnier en Italie, Freud sans nouvelles de lui. Les années de guerre – et celles qui suivent – sont très difficiles pour Freud (peu ou pas de patient, restrictions alimentaires et de tabac).
6) Sigmund Freud, Œuvres complètes, Puf, 1988, t. XIII, p. 327.
7) Ibid., t. XIII, 129.
8) Dans ce même séminaire, Thomas Gaehtgens a montré que le bombardement de la cathédrale de Reims en septembre 1914 était devenu pour les Français le signe de la barbarie allemande. Freud ne pouvait pas ne pas avoir lu dans la presse autrichienne les innombrables articles à ce sujet. Voir T. Gaehtgens, La cathédrale incendiée, Reims, septembre 1914, Gallimard, 2018.
9) « Considérations actuelles sur la guerre », op. cit., p. 133-134.
10) Ibid., p.142.
11) Ibid., p. 135.
12) Ibid., p. 131.
13) Ibid., p. 133.
14) Malaise dans la culture, op. cit., t. XVIII, p. 298.
15) Par « hypocrisie de la culture », Freud entend une obéissance au renoncement pulsionnel qui ne s’accompagne d’aucune véritable modification en profondeur ; mais il fait aussi l’hypothèse qu’une telle hypocrisie est peut-être nécessaire au maintien de la culture (« Considérations actuelles sur la guerre », op. cit., p. 139-140).
16) Ibid., p. 143.
17) Actuelles, p. 144.
18) Sigmund Freud, Totem et tabou (1913), Gallimard, 1993, p. 313.
19) « Psychologie des masses et analyse du moi », Œuvres complètes, Puf, 1991, t. XVI, p. 26.
20) Ibid., p. 37-38
21) J.-L Donnet, « Travail de culture et Surmoi », Le travail psychanalytique, sous la direction d’A. Green, PUF, 2003, p. 222.
22) Ces derniers mots sont ajoutés dans une édition de 1931.