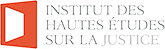Note sur la session du 21 Novembre 2016 : “Le terrorisme comme conduite symbolique?”
Séminaire de l’ENM, Penser l’expérience terroriste,
Pierre Judet de La Combe
Ehess, Cnrs, Centre Georg Simmel
La démocratie (grecque) sans histoire et le retour actuel de l’archaïque
Je vous propose ici quelques réflexions à partir d’un point de vue très limité, sur la relation entre temporalité et traitement du terrorisme. Comme le terrorisme est une négation du temps, dans un acte qui se veut absolu, immédiat, la question du temps, pour les assassins ou apprentis assassins et aussi pour les institutions qui les jugent et décident de leur avenir, semble primordiale : les djihadistes, tout comme les institutions de la société à laquelle ils s’attaquent, appartiennent à une durée, individuelle et collective, qui dépasse les actes de violence. Quel sens politique et individuel peut avoir cette durée ?
Ces réflexions ne s’appuient sur aucune expérience directe du phénomène, à part l’émotion et la préoccupation partagées par tous. Elles ne s’appuient sur aucune expérience des manières dont il est abordé d’un point de vue juridique. Mais elles sont peut-être utiles par la comparaison qu’elles apportent avec le traitement, dans une autre culture, du lien entre violence, politique et traitement symbolique de la violence, dans la Grèce ancienne. La tragédie, dans cette démocratie qui se caractérise par une reconnaissance de la menace permanente de la violence, apparaît comme une école de la mise en temps de cette violence.
Il n’y a pas là un modèle à trouver, car notre démocratie n’est pas, pour notre bonheur, celle des anciens Grecs. Mais ce décalage nous permet peut-être de mieux comprendre et d’affiner nos réponses.
Le point de vue adopté ici : ne pas transformer le mal réel, nouveau et insupportable qu’est le terrorisme islamiste actuel en mal absolu, c’est-à-dire ne pas lui répondre en lui opposant une société figée qui serait comme son miroir. C’est lui accorder trop, et l’imiter. Plutôt, poser la question du temps : que faire des djihadistes appréhendés, et non éliminés par eux-mêmes ou par les forces de l’ordre ou par l’armée ? Les terroristes, des êtres juvéniles et en fait peu nombreux, se sont enfermés dans un cercle magique. Comment en sortir ? Après tout, beaucoup sont sortis d’autres cercles magiques, européens, ceux du nazisme, de la terreur stalinienne, du terrorisme de gauche, ou basque ou irlandais, ou fasciste, quelles que soient les grandes différences entre ces violences et celle que nous subissons aujourd’hui. Comment la réinscrire dans une durée, celle des violents et celle de la société, durée qui pourrait éventuellement contribuer à leur restituer une citoyenneté ? Si la société ne le fait pas, elle renonce à considérer qu’elle est plus forte que les déviances de certains de ses membres, encore une fois extrêmement nuisibles mais peu nombreux, elle déclare qu’elle les traite comme des cas pathologiques demandant une exclusion permanente, une « peine de sûreté ». On nie par là la liberté que le criminel réalise dans son acte. Or la démocratie se fonde sur la reconnaissance et le traitement des libertés.
Et on sait que le rapport justice-condamné est aussi un rapport de reconnaissance, et non d’exclusion pure, puisqu’un élément tiers est posé entre la société lésée et le criminel, à savoir la norme incarnée par le tribunal, qui n’opère pas de manière mécanique en appliquant seulement la loi, mais qui, par ses délibérations, détermine le sens pour la collectivité et pour le prévenu de l’acte déviant, et qui détermine aussi le poids des raisons de cet acte, c’est-à-dire qui mesure l’authenticité et la légitimité possibles de la protestation que le crime élève comme expression d’une non-reconnaissance subie (les éventuelles circonstances atténuantes). Pour cela, la justice, comme on sait, prend son temps. Le droit est censé intégrer, ou réintégrer le déviant par une condamnation motivée, qui lui restitue une place dans la collectivité. La justice n’est pas une vengeance. Ce n’est pas parce que les terroristes nient l’existence ou la pertinence de ce tiers en se faisant juges absolus que nous sommes fondés à le leur refuser.
Je sais que par rapport aux djihadistes, les magistrats sont mis dans une situation nouvelle qui paraît contrevenir aux règles élémentaires du droit pénal, puisque, dans le cadre des politiques de sécurité, les juges sont amenés à examiner des prévenus qui n’ont pas accompli d’actes criminels (même s’ils s’apprêtent à le faire), mais qui sont considérés comme dangereux (ce qu’ils sont de fait), ne serait-ce que parce qu’ils sont allés en Syrie. Mireille Delmas-Marty, Antoine Garapon et Michel Rosenfeld ont souligné cette déviance du droit.
Je n’ai pas la compétence pour entrer dans cette discussion, et voudrais juste souligner quelques traits, par rapport au temps, qui font que cette expérience historique nouvelle ne nous échappe pas totalement, qu’elle ne nous est pas étrangère.
1. La permanence de l’eschatologie.
L’acte terroriste a lieu sur fond d’une idéologie que partagent les trois religions monothéistes du salut, l’eschatologie comme tension de l’histoire vers un moment final de purification et de révélation qui abolira la distance entre les humains et leur dieu. En ce sens, le terrorisme ne nous est pas étranger. Les religions et leurs multiples traditions ont traité différemment cette tension, selon que les politiques religieuses cherchaient à accélérer ou à retarder la venue du moment final. Elles ont pu être révolutionnaires ou conservatrices. < Voir Le Grand Inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, où, contre l’anarchiste qu’est le Christ, un prélat défend la conservation et la soumission de son troupeau. > Le christianisme ne s’est pas privé de détruire des cultures et de massacrer des populations entières pour restituer à Dieu un monde plus pur et accélérer ainsi le processus historique.
La croyance dans le Jugement dernier n’est pas, dans notre société, une curiosité ou un archaïsme qui serait dépassé par le mouvement général de la sécularisation moderne. L’idéologie du salut a été transposée et a engendré plusieurs philosophies de l’histoire et, au-delà de ces philosophies, les cadres dans lesquels nous pensons spontanément le devenir.
À partir d’une prémisse commune qui pose que le bien, ou le meilleur, appartient au futur (puisque la chute nous a définitivement coupés du bonheur paradisiaque passé), deux attitudes sont possibles :
valoriser ce qui dans le cours du temps est rupture, crise, violence, car ces événements catastrophiques rapprochent de la vérité finale et la préfigurent ;
ou au contraire, valoriser ce qui dans « les œuvres humaines », les bonnes actions, rapproche l’humanité dans son ensemble (ou une société) d’un état rationnel de liberté, d’harmonie et de prospérité : perspective du progrès, qui s’appuie, entre autres, sur un renforcement du droit contre les autorités arbitraires.
D’un côté, une conception discontinuiste de l’histoire, qui peut engendrer des politiques volontaristes, révolutionnaires et autoritaires (politiques d’États ou de groupes minoritaires, en général appelés « terroristes », alors que le terme devrait aussi s’appliquer aux États), de l’autre, une conception continuiste, plus libérale (Hegel) : le réel, dans son cours objectif, réalisera des formes de plus en plus libres de l’esprit et de ses réalisations concrètes, notamment institutionnelles.
< Les deux philosophies de l’histoire se retrouvent dans les interprétations contradictoires du djihadisme : continuiste, par la géopolitique, chez Gilles Kepel, discontinuiste, le terrorisme actuel comme nihilisme, chez Olivier Roy. Niveaux, points de vue différents, mais interprétations conflictuelles : ainsi, la première voit une continuité entre les émeutes des banlieues de 2005 et les massacres de 2015, l’autre réfute (à raison) la pertinence d’un tel lien. >
Le terrorisme actuel paraît bien être une manipulation du temps eschatologique. L’acte tueur et suicidaire condense la fin des temps dans un moment qui se voudrait absolu. Il anticipe, accélère le terme de l’histoire universelle et, en même temps, il le réalise immédiatement pour les acteurs. Il détruit toute forme de médiation. En ce sens, il s’oppose au Salafisme, qui est une idéologie d’État conservatrice, même s’il trouve là son terreau : il s’y oppose comme la gauche marxiste-léniniste révolutionnaire des années 1960-1970 s’opposait aux Partis communistes, devenus conservateurs comme l’était en son temps l’Église du Grand Inquisiteur : ils ne cessaient de dire « ce n’est pas le moment ! », « la situation n’est pas mûre » (pour le Jugement dernier).
Le temps eschatologique est le temps du retour à l’origine perdue. Mais son interprétation change selon que le « mieux » attendu est strictement la répétition d’un passé lointain et oublié ou méconnu (et en fait inventé de toutes pièces), ou, au contraire, s’il est construit à partir de l’expérience historique comme cumulative, comme progrès successifs, c’est-à-dire selon que l’histoire est abolie ou non.
Dans le cas de l’islamisme, le retour se fait à un passé qui est considéré comme déjà là et immuable, même si la majorité des Musulmans l’ont trahi : la révélation première, qui serait à prendre à la lettre. Cela non plus ne nous est pas étranger, et a eu une importance ravageuse en Europe dans l’histoire très récente : l’islamisme, comme le nazisme, se veut retour à un passé mythique non par un saut en arrière, mais par l’exploitation la plus innovante des moyens de la modernité, que par ailleurs ces idéologies condamnent. Pour le nazisme : les techniques industrielles de la guerre et du massacre et l’avant-garde esthétique dans la propagande. Theodor Adorno disait du nazisme qu’il est « une fusée à l’imparfait ». Les techniques étaient mobilisées pour réaliser la primauté d’une race mythique, les Germains. Pour l’islamisme : les techniques de la communication, appuyées sur la structure d’États modernes, ceux du Golfe, servent de moyens pour la réalisation nouvelle et fidèle du supposé sens premier du Coran.
Le futur, le mieux, est au passé. Il est retour au mythe grâce aux instruments de la modernité. On peut alors employer l’expression de chercheurs berlinois qui, pour l’islamisme, parlent de « théo-fascisme » (« fascisme », pour eux, selon un usage du mot courant en Allemagne, étant l’équivalent de nazisme). Le terrorisme suicidaire réalise immédiatement le mythe, dans un acte individuel.
2. La démocratie moderne, espace historique non eschatologique.
Le temps démocratique, dans les démocraties représentatives modernes, n’est normalement pas eschatologique. Il ne débouche sur rien d’autre que lui-même, sur aucun paradis restitué. Il est sans fin. Son instauration, chaotique depuis les Révolutions européennes et américaines, a bien été comprise comme moment décisif d’un progrès général, et donc comme condition d’une forme de salut sécularisé. Mais la démocratie n’est pas la préparation d’une autre époque qui serait radicalement différente. Elle n’est pas censée changer de nature si elle se perfectionne et si elle s’étend, dans l’idée d’une démocratie continentale, européenne, ou même mondiale. Elle n’est pas un état provisoire avant un état de bonheur, comme le socialisme était censé l’être avant la béatitude du communisme. Procédurale, elle se présente comme le moyen nécessaire à la réalisation de progrès substantiels particuliers (éducatifs, culturels, économiques, sociaux, sociétaux, etc.), mais sans avoir de contenu par elle-même.
La démocratie représentative n’est pas la réalisation d’un projet divin (d’un sujet général qui animerait l’histoire), mais elle est par définition intersubjective, et donc sans centre, sans substance : elle se construit autour d’un vide, puisque personne, aucune instance pleine, n’est censée l’incarner (Claude Lefort).
D’où sa faiblesse constitutive, un manque de substance, qui est aussi sa force, puisqu’elle est censée ne se réduire à aucune idéologie particulière. Cette substance, que la démocratie ne peut produire et qui, dès lors peut être considérée comme manquante aura tendance à être cherchée ailleurs que dans la politique : le marché, censé faire le bonheur de l’humanité entière, ou, par réaction contre l’emprise mondialisante du marché, des instances symboliques locales, particulières, qui sont mythiques car considérées comme pleines et contraignantes face au vide de la démocratie : la race, l’identité, les racines, le peuple. La laïcité devient communautaire, la République devient une entité donnée à préserver, et non plus un projet. Pour les retours à la race et aux racines, il est légitime de parler d’un « néo-fascisme », en parallèle moderne au théo-fascisme.
< Pour comprendre le recours à ces catégories mythiques, de plus en plus puissant dans les sociétés et dans leurs votes, il est utile de se référer à la typologie des « grammaires du commun » qu’a élaborée le sociologue Laurent Thévenot, à partir d’enquêtes aux USA, en Allemagne puis en Russie. Il distingue trois grammaires, selon que ce qui est reconnu comme un commun légitime, pouvant fonder un vivre ensemble et s’articuler dans des discours, est trouvé :
dans des modes de vie et de penser posés comme des « options », recevables dès lors qu’elles peuvent présentées comme des choix (concernant la vie privée, les mœurs, et les opinions en général) articulés dans l’espace public. Grammaire libérale.
dans un « bien commun » transcendant les particularités et permettant leur coexistence pacifique et leur transformation en éléments concourant à la cohésion d’une société qui tient par des normes « universelles » admises. Grammaire républicaine de tradition européenne ;
dans des « lieux communs » au sens de moments particuliers, d’expériences historiques, de traditions situées, d’entités substantielles particulières (race, religion, classe, générations) censées fonder un accord entre des individus attirés par ces lieux. Grammaire de type populiste.>
On peut alors se demander si les réponses apportées actuellement au terrorisme et qui tendent à crisper la société autour d’une identité fixe, ancienne (et inventée) ne sont pas d’abord à comprendre non pas comme des réactions momentanées à une agression nouvelle, mais comme la recherche, à tout prix, d’un centre, d’une incarnation de la démocratie, qui, par définition, n’est que procédurale. Nostalgie d’une substance. Le terrorisme paraît dès lors être aussi un prétexte, qui désigne un problème structurel interne à la démocratie, le néofascisme étant en fait nettement plus dangereux que lui pour la démocratie, car il prétend changer radicalement les normes communes.
Le « plein », dont on déplore le manque, est, en effet, inventé de manière plus ou moins radicale :
selon la troisième grammaire, celle des « lieux communs », l’identité est trouvée dans la race, ou la « culture », prise comme bloc figé, avec ce tour de force du Front national qui transforme la laïcité, censée permettre indéfiniment la coexistence pacifique des religions, en tradition fermée, en un fait sacré et autoritaire, excluant ;
ou, selon une transformation de la deuxième grammaire, le « bien commun » cesse d’être une visée, et devient une réalité existante, un patrimoine républicain et national à sauver à tout prix et même de manière autoritaire, même au prix d’un renoncement aux valeurs de la république.
Les réponses actuelles de la gauche et de la droite de gouvernement tendent de fait à transformer le « bien commun », garanti par la République : il n’est plus un projet sur lequel il y a accord et débat, mais une entité originelle menacée. La nation, censée surmonter les communautarismes, les dissidences particularisantes, est elle-même pensée en termes communautaristes, avec l’invocation de ses racines, de ses normes non négociables, etc., au lieu que ces normes, établies à un moment précis de son histoire, ne soit réévaluées, reformulées en fonction de la situation nouvelle que crée l’importance récente de l’Islam, religion qui n’existait pas en France en 1905. On évite ce travail collectif qui rendrait leur force normative adaptée, et convaincante (voir le débat sur les cantines scolaires : il s’agit non pas de régler des différences, mais de les interdire).
3. Un modèle ancien (modèle purement théorique, et non exemplaire) : le traitement symbolique de la violence dans la démocratie athénienne.
La démocratie grecque : construction politique située en dehors de toute eschatologie. L’idée même de progrès (eschatologie douce, transposée) est étrangère aux Anciens.
La Grèce ancienne ignorait un tel schéma, puisque pour elle l’histoire n’était pas orientée vers une fin nécessaire, mais se pensait au présent, année après année, saison après saison. Elle était affaire de pratique et de prudence. L’avenir n’y était porteur d’aucune promesse. Il n’y a pas en Grèce de Jugement dernier. Le Jugement divin a eu lieu dans le passé, une fois pour toutes, à l’époque révolue des héros (l’Iliade) quand, par leurs actes violents, les mortels pouvaient accéder à une forme d’apothéose. Pour un Grec ancien, cette époque était close. Il n’y avait pas chez eux de violence sectaire censée accélérer le cours du temps. Le temps était indéfiniment ouvert, sans retour futur à un passé perdu.
Idée fondamentale : auto-institution du politique (Castoriadis) :
– Héraclite, fragment 44 :
« Il faut que le peuple se batte pour défendre sa loi, pour celle qui se fait, aussi bien que pour le rempart » (traduction de Jean Bollack et Heinz Wismann). La loi, dans son devenir, dans les discussions incessantes qu’elle suscite, dans ses changements, a la même solidité que le rempart de pierres qui protège la cité contre les agressions extérieures. La solidité de la cohésion interne de la cité repose sur une activité humaine. Aucune norme naturelle, aucun dieu ne vient garantir l’unité du corps social. Il s’élabore lui-même dans une interaction qui produit sa cohérence.
– « La cité, c’est les hommes » (Thémistocle chef démocrate du Ve siècle, Eschyle, Les Perses). Athènes se disait « autochtone », née du sol de l’Attique. Mais la permanence de cette autochtonie, fortement mise à l’épreuve par l’invasion perse de 480 avant J.-C., reposait sur l’activité des citoyens : ils ont abandonné leurs temples, leurs tombeaux à l’envahisseur perse (Xerxès) et ont combattu sur ce qu’il y a de plus instable : des bateaux (bataille de Salamine, racontée dans la pièce d’Eschyle). L’enracinement terrestre de la cité, sa permanence, a été produit par les aléas d’une activité marine.
Ce modèle est pour nous « périmé », du fait de la représentation politique (il s’agissait d’une démocratie directe), du fait que les démocraties modernes s’appuient sur un appareil d’État (absent à Athènes), et parce que la démocratie ancienne est essentiellement communautaire (centrée sur un espace visible, l’assemblée, qui et clos et fortement excluant). Comme il n’y avait pas d’État au sens moderne, on a pu le présenter comme une dictature de l’opinion et de ses revirements (cf. Max Weber).
Le point de clivage entre la démocratie ancienne et la démocratie moderne, qui fait qu’un retour aux Anciens est exclu, a été bien défini par Benjamin Constant dans son essai Sur la liberté de Anciens et des Modernes. Cette démocratie ne repose pas sur l’idée moderne de liberté individuelle comme source d’autonomie, mais sur l’idée d’une liberté comprise comme condition objective : ne pas être ou devenir esclave, ne pas être ou devenir sujet d’un tyran.
Mais un point essentiel dans cette démocratie directe est qu’elle ne pratique pas le déni de la violence, qui est constitutive de la vie sociale, et dont elle fait son problème permanent, dans la pratique et dans la théorie.
Ce problème vient de ce que de l’individualité est considérée comme étant par nature déviante par rapport au tout de la cité (en raison des appétits, de la recherche du profit, qui crée la dissension entre groupes antagonistes) et qu’elle n’adhère donc pas naturellement au tout de la cité, alors que ce tout est la condition de sa sécurité et de sa liberté.
La cité est dès lors en état permanent de rupture, de stasis possibles, selon les conditions sociales et selon les luttes pour l’hégémonie à l’intérieur les groupes dirigeants et rivaux.
Cela pose, de manière crue et lancinante, le problème de la médiation entre individu et tout, problème que l’on ne trouve pas chez nous de la même manière, puisque l’individu moderne, considéré comme libre, passe pour dépositaire de la norme fondant le tout – ce qui, on le voit, ne marche pas : d’où l’intérêt, maintenant, d’un regard sur les Anciens, qui ne connaissaient pas cette idée de liberté subjective.
La tragédie (art public) invente une médiation entre le tout (la cité) et l’individu dans l’acte de terreur qu’accomplit ou subit un individu (de rang royal, pour que son histoire concerne le tout de la cité). Par cet acte criminel est créé un absolu, qui met en danger le tout, mais qui permet de poser, dans la fiction, un lien entre ce tout qu’est la cité et la revendication totale d’un individu. Cette revendication n’est, en effet, pas seulement une prétention, un droit (dans le cadre de la vengeance) : elle met en jeu l’existence physique de celui ou celle qui la porte. Le droit (dans la vengeance) devient dans la tragédie expressif d’une existence individuelle. Il n’est pas seulement normatif, même si l’individu ne dispose que du langage de la norme pour exprimer sa séparation, sa singularité (il doit se venger). Le drame, comme forme complexe, faisant alterner les points de vue des personnages, opposant en permanence les actions et les discours individuels des personnages à la présence de la société qu’est le chœur, élabore un moyen concret, matériel, de relativiser la violence individuelle, de l’inscrire dans une durée collective.
La violence n’est pas exaltée par la tragédie, ni minimisée ou moralisée. Elle est déployée, dite, commentée, pleurée, et par là, elle débouche sur un dehors. Le cercle magique est posé puis brisé : dans ce monde sans substance, une substance est affirmée, le personnage tragique (un destin destructeur), qui pose par son acte de terreur, auquel il s’identifie, un absolu non politique. Dans la tragédie, la Cité se met en crise et examine les effets de cette crise, pour elle, pour les individus.
Exemple : Électre de Sophocle. Drame surprenant, car, contrairement aux autres drames que nous avons conservés, il est absolument sans contenu, sans thèse. Il reprend le thème mythique du parricide (Oreste tuant sa mère et son amant, Égisthe, pour venger son père Agamemnon que le coupe adultère a tué à son retour de Troie, entre autres raisons parce qu’Agamemnon, pour partir à Troie, avait sacrifié sa fille Iphigénie). Mais il le fait sans aucune réflexion sur le droit, sur la justice, sur le bien fondé de cet acte terrifiant, comme c’est le cas chez Eschyle (Orestie) ou Euripide (Électre). Oreste, sauvé enfant par sa sœur Électre au moment du meurtre de leur père Agamemnon par leur mère Clytemnestre et par son amant Égisthe, revient longtemps après et, en accord avec un ordre donné par Apollon, tue sa mère, sans état d’âme, puis s’apprête à tuer Égisthe (fin du drame). Il n’est pas poursuivi par les Érinyes de sa mère, comme il l’est chez Eschyle et Euripide (et dans le mythe traditionnel). Il n’est pas considéré comme un criminel qu’il faudrait juger. Le chœur dit, à la toute fin, qu’il est arrivé après ses épreuves à un état de perfection. C’est une provocation.
Son crime n’intéresse pas Sophocle pour ses conséquences juridiques. La pièce se concentre sur l’acte d’Oreste (qui représente une sorte de principe de réalité : la vengeance, dans le matricide, devait s’accomplir comme cela, de la manière techniquement la plus efficace, en accord avec le destin), mais surtout sur les états d’âmes de celle qui ne peut agir et n’attend que la vengeance, Électre.
Tragédie pure, qui n’a pas de contenu, mais qui représente différentes manières d’expérimenter le temps et qui, pour cela, se concentre sur la terreur propre à l’événement. Plusieurs formes de temporalité, de rapports au temps sont mises en conflit par l’action :
Électre reste fidèle à l’horreur du meurtre de son père, s’identifie à cette mort, au point de dépérir charnellement pendant dix années en ne pensant qu’à la vengeance sur le mode révolté de l’injure et d’une plainte continue ;
Clytemnestre, la criminelle, que son mari a atteint dans sa maternité en tuant leur fille Iphigénie, revendique le droit au temps, à la fécondité, au devenir ;
Chrysothémis, la sœur d’Électre, revendique le droit à la survie, à la reconnaissance sociale, à la dignité ;
Oreste exécute la mission divine, sans plus, et récupère ainsi le patrimoine matériel et politique de son père.
Pour Électre, la vie est entièrement dominée par la prégnance de la terreur (v. 221 ss., , trad.. Jean et Mayotte Bollack) :
« C’est la terreur (deinois) que j’ai subie, la contrainte de la terreur,
Je le sais bien, je connais la passion que j’ai.
Mais dans la terreur, je ne mettrai pas fin
À ces malheurs (atas),
Tant que la vie me tient. »
La vie est pour elle une mort prolongée, fidèle, immortelle. À la différence des terroristes, Électre est alors impuissante, même si à un moment de la pièce, Oreste ayant par ruse fait croire à sa mort, elle pense agir. Son frère, qui finit par se faire reconnaître de sa sœur, agira, d’une manière purement stratégique.
Dans cette identification à la mort de son père, comme événement indépassable, Électre défie toute loi. Ce n’est pas au nom de la loi qu’elle souhaite la mort des meurtriers de son père. Discours au chœur (v. 307 ss.) :
« Dans ces circonstances, mes amies, il n’y a pas moyen d’observer la mesure
Ni de respecter la loi divine, Lorsque le mal sévit,
La nécessité force souvent à faire soi-même le mal. »
En ce sens, Électre n’est pas Antigone, qui, comme les terroristes actuels, invoque des lois divines contre la loi humaine. Sophocle, dans ce drame, simplifie, pour se concentrer sur l’expérience du temps.
Le drame a sa propre temporalité, qui n’est pas celles des personnages. Il les transcende, les met en situation, les relativise (alors que chacun, différemment, posait un absolu, dans l’oubli ou dans la fidélité). Il ne s’intéresse qu’à une question : comment l’arrêt sur le temps passé d’Électre, son « cercle magique », s’ouvre à partir du moment où il est présenté sur scène, mis en temps par l’action théâtrale.
Catharsis, « purification », « dépassement de l’horreur » au sens d’Aristote : non pas parce que l’action matricide et vengeresse d’Oreste réussit, mais parce que la douleur arrêtée d’Électre devient temps, succession d’états successifs. Même si Électre ne change pas, ne se « purifie » pas, le spectateur est amené à une catharsis au sens ou d’abord fasciné et horrifié par la dureté d’Électre, d’abord plongé par les mots et la musique dans son expérience du temps, de la terreur qu’elle subit et active, il est transformé par le cours du drame, par le fait que cette horreur n’est plus qu’un moment, qu’une étape dans une histoire. (La catharsis, chez Aristote, ne produit aucune leçon, aucun contenu moral ou autre, elle est le passage de l’instantané, horrible, à la maîtrise d’une durée.)
On assiste au déploiement d’un traitement du symbolique : comment se représenter soi-même, comme autre de ce que l’on pensait être ? Le théâtre, par les décentrements qu’il impose, permet de sortir de l’enfermement.
J’ai choisi cette tragédie parce que c’est la moins dogmatique de tout le théâtre ancien. Elle n’affirme rien, aucune thèse (au mieux : Oreste est justifié comme tyrannicide, mais il s’agit, quand même, de sa mère), mais se limite à l’expérience d’une « mise en temps », au-delà de l’acte ponctuel à venger et au-delà de l’acte ponctuel de la vengeance. Analyse dramaturgique de la durée, qui dissout l’absolu.
La pièce n’apporte strictement rien sur le plan cognitif (quelles sont les raisons d’Oreste, d’Apollon qui l’envoie tuer sa mère ? Qu’est-ce que la nature humaine ?…), et rien sur le plan normatif, avec des questions du genre : est-il juste ou non de tuer sa mère, quand elle a été criminelle ? est-il juste de tuer un tyran « avachi » comme Égisthe ? quel est le rapport entre justice en vengeance ? Ces questions, qui obsèdent Eschyle et Euripide, sont tout simplement laissées de côté par Sophocle.
Tout se joue sur le plan symbolique : quelle interprétation d’elle-même peut avoir Électre, figée comme une terroriste moderne sur l’offense à venger ? En quoi cette représentation de soi change avec la « mise en intrigue » théâtrale ?
4. L’apprentissage, par l’École, du symbolique.
Il ne s’agit pas simplement de dire que les radicalisés devraient faire du théâtre, encore que : l’important est sans doute de leur permettre une expérience symbolisée, distanciée, de leur histoire et de celle de leurs victimes. Cela aiderait sans doute à les sortir de la magie. Il s’agit surtout de rappeler que le traitement d’un violent par la société requiert une forme de réintégration qui passe par l’expérience distanciée qu’il peut avoir de lui-même et de ses victimes.
La socialisation passe par un retour sur soi. Non par une confrontation directe avec les normes. Haïes d’abord, elles restent inefficaces si elles sont simplement rappelées autoritairement. La socialisation passe par une mise en histoire individuelle, au-delà de l’histoire mythique et close qui a légitimé la violence.
La question est alors : comment des individus qui, pour des raisons multiples, vivent une dissidence radicale, un défi total vis-à-vis des discours symboliques ayant cours dans la société, et qui s’identifient à des formes de discours fanatiques, peuvent-ils trouver dans des formes symboliques collectives apaisées un ancrage, un moyen d’y retrouver la force de leurs expériences individuelles, de manière à pouvoir traiter par eux-mêmes, dans un langage collectif, ce qui les anime et donc de manière à l’objectiver et à le relativiser, comme cela arrive aux personnages de la tragédie ?
On pose régulièrement la question de l’universalisation, face aux communautarismes et à l’enfermement des individus dans des idéologies qui séparent et peuvent prendre une forme intolérante, violente (« Je ne suis pas Charlie » ; mais on peut ajouter, je crois, que la phrase qui est niée par cette contre-phrase, « Je suis Charlie », elle aussi, est violente : elle exclut ceux qui n’approuvent pas les valeurs de Charlie : qui dit « Je » ?). Le problème est de savoir comment, concrètement, une telle ouverture est possible pour les individus, pour les « je ».
Cette sortie hors des mondes fermés ne se résume évidemment pas à la seule ouverture à la mondialisation, qui n’est qu’une extension des échanges et n’est pas politique, c’est-à-dire ne concerne pas la question, démocratique, de la liberté. Les terroristes sont très à l’aise dans cette mondialisation. Ils la pratiquent et, à leur manière, la renforcent. Ils sont en ce sens modernes. Elle ne s’opère pas non plus par l’acceptation du droit démocratique, qui reste abstrait. Si on oppose simplement le droit à la violence, le droit passe alors lui-même pour une violence.
Un niveau déjà plus pertinent d’universalisation pour la question qui nous concerne est celui de la mise en coexistence des valeurs, religieuses, éthiques, culturelles, qui sont toujours particulières et tendent à former des systèmes clos. Ce sont bien, en effet, des valeurs qui sont revendiquées par les actes des individus. Mais cette coexistence souhaitée doit aller au-delà de la simple juxtaposition des systèmes culturels de valeurs. Pour qu’il y ait ouverture, et vie pacifique, est requise la capacité et la possibilité d’une discussion des valeurs.
Or là est le paradoxe et tout le problème. Cette capacité à aller vers un universel non pas formel mais concret et par là convainquant, passe par l’appropriation par les individus (tous, pas seulement les délinquants) de la capacité à s’imaginer eux-mêmes, à imaginer les autres, à construire sur soi et sur les autres un langage symbolique communicable. L’universalisation passe d’abord par un retour sur soi, sur l’expérience intime, chaotique, sur son histoire, et celle des générations antérieures, qui ont aussi vécu ou agi des violences, notamment pour les Français musulmans (qui sont liés à trois temps de guerres, les conflits actuels, la guerre du GIA, la Guerre d’Algérie), de manière que cette expérience non seulement soit racontée, mais puisse être considérée par les individus eux-mêmes du dehors, à partir d’un dehors (le langage, qui est par nature commun) qu’ils se sont approprié, de manière à ne plus être confondus avec leur acte.
Cela suppose, de la part de l’État, une politique du symbolique (et non pas simplement une politique normative de rappel du caractère contraignant des règles) : l’État, s’il veut avoir affaire à des citoyens qui se reconnaissent en lui et qui l’améliorent en formant société, doit aussi penser à rendre les individus, un par un, capables d’une telle symbolisation de soi, puisque l’acte de symbolisation est déjà en lui-même une visée de l’universel. Le lieu de la formation de cette compétence est le langage, et est donc affaire de l’École. Il semble donc urgent que celle-ci élargisse sa visée éducative concernant le langage qui est le milieu essentiel pour une figuration de soi-même : apprendre non seulement le langage comme communication de connaissances ou comme expression directe, immédiate, de ses opinions, mais avant tout comme milieu ou se construisent des individualités. Le langage comme histoire à la fois individuelle et partagée. Or les programmes actuels de l’École oublient tout simplement cette dimension constitutive du langage, qui, pour elle, n’est que compétence de communication directe.
Cette éducation par le langage vaut à plusieurs niveaux :
Pour les individus, qui pourraient apprendre à reconstruire leur histoire, celle de leur famille, de leur milieu, du « cercle » où ils se sont enfermés, de manière à articuler, transmettre cette histoire.
La discussion lors du séminaire a permis l’expression d’un vrai problème dans le rapport, en prison, avec des radicalisés : il arrive qu’ils fassent part du désir de religion qu’ils ont ressenti, d’une religion qu’ils ignoraient en fait et qu’ils sont allés chercher en Syrie ou en Irak. La question était de savoir si ce besoin de religion pouvait être pris en compte dans un espace laïc. Il est apparu qu’il convenait de dissocier l’appétit de spiritualité, qui est l’expression d’un manque, et donc d’une liberté non satisfaite, des contenus, erronés, qui étaient trouvés pour satisfaire ce manque. Ce qui est universel, ce ne sont pas les contenus, mais cet appétit, qui a sa place légitime dans un cadre démocratique, où devrait prévaloir la liberté, comme aspiration, même si cette liberté ne trouve pas sa forme adéquate. Il s’agit de la réorienter. Cela passe par la culture.
L’apprentissage du langage, comme milieu ouvert et historique, vaut donc aussi à un autre niveau, collectif et non pas seulement individuel. Les actes de révolte invoquent des systèmes normatifs (religieux) et s’opposent à un autre système normatif (républicain). Pour répondre, l’apprentissage devrait passer aussi, à l’École, par la lecture des textes fondateurs de ces normes. Cela requiert un enseignement tourné non plus vers le langage des individus, mais vers le langage historique des normes dont les candidats à la violence se réclament : apprendre non pas les « véritables » contenus du Coran, mais connaître les lectures historiques de ce texte de référence, dans leurs différences, dans leur histoire, apprendre que ces normes ont fait l’objet de discussions, que la tradition est multiple. De même, savoir lire, dans leur histoire, les textes porteurs des valeurs et des normes de la démocratie.
L’exercice élémentaire qui initie à cette appropriation de langages autres, non évidents, mais qui parlent, est la lecture des textes de culture, et notamment de la littérature, où des expériences historiques individuelles se sont concrétisées dans des phrases. Les lire démultiplie les capacités des élèves à se représenter leurs propres expériences, enrichit le langage des élèves, dont on constate, à raison, l’extrême pauvreté.
Or l’École, dans ses orientations actuelles, est très loin de vouloir se donner cette tâche démocratique de formation, puisque la culture (c’est-à-dire son histoire) n’est plus considérée comme un objet central de son enseignement. Elle tend à produire des êtres quasi muets, démunis vis-à-vis des traditions, du passé individuel et collectif, et proies toutes préparées pour des idéologies rigides d’apparence pleine et en fait impersonnelle.
Date / Heure
Date(s) - 21/11/2016
18:00 - 20:00
Emplacement
Ecole nationale de la magistrature
Catégories