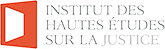Sorties de crise et consolidation de la Paix :
Repenser et clarifier les enjeux de la Justice Transitionnelle
au XXIème siècle
Lundi 10 octobre 2016, Genève, Palais des Nations
Télécharger le PDF

Mariella Villasante Cervello, Farah Hached, Antoine Garapon, Mô Bleeker, Bassma Kodmani
Le Ministère des Affaires étrangères français (MAEDI) et l’IHEJ ont co-organisé, avec le soutien des représentations permanentes française, suisse et argentine à l’ONU, une table ronde au Palais des Nations le 10 octobre sur le thème « Repenser et clarifier les enjeux de la Justice transitionnelle au XXIème siècle. ». L’objectif était, en partant de la publication de la stratégie dont le MAEDI s’est doté fin 2014, de confronter les expériences de terrain afin de permettre un débat concret sur les évolutions et améliorations possibles à apporter dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes de transition. A cette fin, étaient réunies autour d’Antoine Garapon, Secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ), plusieurs intervenantes : Farah Hached, présidente de l’association tunisienne Le Labo’démocratique ; Bassma Kodmani, directrice de l’Initiative Arab Reform et membre de la délégation des Syriens libres lors des trois rounds des négociations de Genève ; Mariella Villasante Cervello, anthropologue de la violence (EHESS) ; Mô Bleeker, Envoyée Spéciale du Département fédéral suisse des Affaires étrangères pour le traitement du passé et la prévention des atrocités. Leurs réflexions ont été exposées puis discutées avec les délégations des représentations permanentes à l’ONU présentes (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, Congo, Espagne, Estonie, Guinée, Libye, Luxembourg, Norvège, Organisation internationale de la Francophonie, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Union européenne).
Une stratégie française qui s’inscrit dans le sillage du volontarisme onusien et tente de dépasser les blocages actuels
En ouverture, Vincent Larrouzé, chef de la Mission de la gouvernance démocratique du Ministère français des affaires étrangères et du développement international, a rappelé que l’ONU avait depuis longtemps soutenu et accompagné le développement de la justice transitionnelle : en initiant la recherche des principes fondateurs de cette justice dès 1997 avec le rapport de Louis Joinet (voir la version actualisée en 2005 par D. Orentlicher) qui a permis d’en dégager 4 grands principes (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation, exigence de non répétition). Puis l’ONU est restée à l’avant-garde de l’action internationale en ce domaine en nommant un « Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition » en la personne de Pablo de Greiff. Elle a ainsi montré l’importance qu’elle attachait à ce sujet. C’est la raison pour laquelle le MAEDI a souhaité organiser cette table-ronde au Palais des Nations. Puis M. Larrouzé a fait remarquer que bien que la justice transitionnelle soit traditionnellement conçue comme une justice de sortie de conflit, force était de constater que, tout particulièrement sur le volet des poursuites pénales, ses promoteurs et ses acteurs n’attendaient plus la fin de tous les combats pour être sollicités et pour s’organiser. D’où le 22 juin 2014, le projet de résolution présentée par la France devant le Conseil de sécurité pour saisir la Cour pénale internationale (CPI) des crimes perpétrés en Syrie. Cette résolution s’était vue opposée le véto de la Russie. C’est pour tenter d’échapper à de tels blocages, dans des contextes aussi dramatiques, que la France a proposé lors de la 70ème session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, en septembre 2013 et ici même à Genève, par la voix de son Ministre des affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, devant la 31ème session du Conseil des droits de l’Homme en février 2016 (http://www.ambafrance-ru.org/31eme-session-du-Conseil-des-droits-de-l-Homme ), de limiter le recours au droit de véto par les membres permanents du Conseil de sécurité lorsque nous nous trouvons en face de situations de crimes de masse. Si une telle mesure était adoptée, cela renforcerait les possibilités d’action de la communauté internationale (pas seulement dans le domaine du recours à la justice bien sûr) et cela changerait très sensiblement le cadre dans lequel la justice transitionnelle peut se déployer.
L’amorce et le soutien à la justice transitionnelle alors que le conflit est encore en cours
Mme Bassma Kodmani, directrice de l’Initiative Arab Reform et membre de la délégation des Syriens libres lors des trois rounds des négociations de Genève, a regretté que la composante « justice » soit absente de la plupart des négociations de paix, alors même que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en Syrie sont parmi les plus documentés. Ce message d’impunité valide la résignation devant le recul des barrières dressées par le droit international et encourage la poursuite et l’exacerbation des crimes et de la violence. Si la justice n’est pas en mesure elle-même d’arrêter les massacres – et n’a pas à se voir doter de telles prérogatives, sauf à être instrumentalisée ou surinvestie -, Bassma Kodmani a plaidé l’importance de l’existence de ce message de justice même avant la fin du conflit.
Pour soutenir qu’il faut en Syrie donner toute ses chances au processus de négociation politique, les opposants à l’intégration de la justice dans les négociations avant souvent la référence à la Lybie (pays toujours instable alors qu’à la suite de l’attaque du régime de Kadhafi contre une partie de sa population civile, le Conseil de sécurité avait saisi la CPI et soutenu une intervention qui sera conduite par une coalition de pays de l’OTAN et de pays partenaires). Cette référence est biaisée et ne tient pas compte de deux facteurs : l’impasse des négociations et le fait que soutenir la prise en compte des questions de justice, c’est soutenir les voix plus modérées. Il s’agit bien de justice transitionnelle puisque, face à l’énormité des crimes (290 000 morts estimés, 150 000 prisonniers, 200 000 disparus, 60% de la population déplacée) il ne sera pas possible de juger la majorité des responsables de crimes. Il va falloir passer par d’autres mécanismes pour rendre justice aux victimes : processus de vérité, d’indemnisation, de définition de critères sur « qui est réellement responsable et qui peut être amnistié ». Cependant, pour ouvrir la voie à tous les autres mécanismes non-judiciaires, l’incrimination des plus hauts responsables du système reste nécessaire. La possibilité de poursuivre ces crimes est l’enjeu crucial d’une future justice transitionnelle en Syrie.
Bien que les projets (français) de saisie de la CPI ou la résolution sur l’arrêt des bombardements ait étés bloqués par l’usage du véto au Conseil de sécurité, pour la première fois depuis 5 ans, les récentes (7 octobre 2016) déclarations publiques des chefs de la diplomatie américaine et française, John Kerry et Jean-Marc Ayrault, sur les “crimes de guerre” perpétrés à Alep, en Syrie, pour dire qu’il faudra juger les criminels de guerre, suggèrent que cette voie est, peut-être, enfin ouverte. La lutte contre le terrorisme, au nom de qui les responsables internationaux ont longtemps fermé les yeux sur les crimes commis par le régime – responsable de 90% des crimes – n’est certes pas oubliée. Et lors de la discussion avec la salle, Bassma Kodmani, soulignera que, dans le cas de Daesh et Jahbat al-Nusra, qui se réclament du terrorisme djihadiste, l’évidente criminalité de ces mouvements n’empêche pas que, au final, on devra juger des individus criminels sur la base d’une responsabilité individuelle. Il faut réintroduire le droit dans la lutte contre le terrorisme.
Il faudrait anticiper, dès aujourd’hui, non pas les détails de la réforme de la justice syrienne à entreprendre dans le cadre d’une sortie de conflit et d’une transition mais les conditions de base qui permettront à de tels projets de se réaliser : former et « re-moraliser » un système totalement corrompu et au service de l’appareil répressif syrien. La priorité est de développer cette capacité de justice transitionnelle nationale. L’échec de la reconstruction en Libye s’explique en grande partie parce que ces capacités n’existaient pas. Il nous faut absolument développer les outils et les moyens nécessaires d’autant plus que l’on veut qu’ils mènent à la réconciliation nationale. Et Bassma Kodmani d’appeler de ses vœux : « une paix juste oui, et plus encore un retour à l’unité nationale ».
L’appui à de nouvelles composantes essentielles de justice transitionnelle : le cas du traitement des archives
La justice transitionnelle est trop souvent, et à tort, réduite à la mise en place d’une commission vérité et, lorsque cela est possible, d’un tribunal spécial (ou de procès de la CPI).
La présentation de Farah Hached, Présidente du Labo’ Démocratique, a montré qu’il existait, en complément de ces deux mécanismes, d’autres moyens d’aborder les enjeux qui sont au cœur de la justice transitionnelle. Ainsi, le projet que son association a défendu, sur la protection et le traitement des archives de la dictature, notamment des archives sécuritaires (voir les trois tomes de l’ouvrage « Révolution tunisienne et défis sécuritaires », et l’entretien sur justiceinfo.net : apparait comme une étape nécessaire de la transition qui touche à toutes les questions clés de la justice transitionnelle : mise au jour de la vérité sur l’organisation et les responsabilités de l’oppression, rassemblement de preuves pour les enquêtes judiciaires et les procès, documentation pour les historiens et le travail de mémoire, lustration et réforme du secteur de sécurité pour empêcher la poursuite ou le retour des mauvaises pratiques (atteinte aux droits de l’homme, clientélisme, corruption), rétablissement d’une confiance de la société envers sa police et les services de sécurité, etc. S’il n’y a pas de système de protection pour ces documents, une grande partie du processus de justice transitionnelle risque d’être biaisée.
C’est le cas en Tunisie, où malheureusement l’absence de cadre juridique sur les archives de la dictature, s’avère préjudiciable : il règne un flou complet sur la situation réelle de l’état des archives avec des rumeurs de destructions et d’autres, non certifiées, de sauvegardes. Il y a eu des chantages, des archives mises en ligne sur Internet dont on ne sait si elles sont authentiques ou non. Une commission nommée de manière opaque, a publié un document (le « Livre noir ») à la demande du Président d’alors Moncef Marzouki, qui recense les « journalistes complices » qui officiaient en Tunisie sous Ben Ali et instrumentalise les archives. La loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle, adoptée en décembre 2013 aborde de façon très superficielle la question des archives. Ainsi l’instance « vérité et dignité » (IVD) (1) créée par cette loi a bien un accès aux archives, mais pas les individus et même pour l’IVD, qui a réalisé qu’il était impossible pour elle de remplir ses missions de commission vérité et en même temps d’élaborer et de conduire un traitement des archives, y a difficilement accès.
(1) L’instance « vérité et dignité », mise en place en juin 2014, a commencé à s’organiser en janvier 2015. Elle a terminé la réception des dossiers en juin 2016 et reçu environ 60 000 plaintes. Elle a trois ans, jusqu’en 2019, pour traiter 60 000 dossiers. A l’origine, l’instance disposait d’un mandat très large. Elle devait faire une sorte de relecture de l’histoire de la Tunisie, sauvegarder les archives, etc. Aujourd’hui, elle se focalise davantage sur sa principale mission (investigations) et devrait compter pour cela sur la formation (en cours) de 900 assistants, ce qui est peu, en face des défis procéduraux qui se cumulent ainsi que des difficultés internes.
Pour Farah Hached, le maître mot de la justice transitionnelle, c’est la confiance. Créer de la confiance, d’abord chez les victimes mais aussi chez ceux qui pourraient être accusés à tort. Pour mener à bien les réformes juridiques, il faut impliquer les fonctionnaires de l’Etat et les rassurer pour qu’ils ne craignent pas que le processus de justice transitionnelle puisse être instrumentalisé et leur nuire, sinon ils adopteront une attitude d’inertie, voire de sabotage. Selon Farah Hached, il fallait donc commencer par mettre en place un cadre juridique concernant les documents de la « dictature », c’est-à-dire non seulement de la répression mais plus globalement de ceux qui étaient liés au régime précédent. Une commission spécifique pour les archives de la dictature aurait délimité le champ des archives de la dictature communicables et identifié les archives qui doivent rester classifiées car leur dévoilement porterait atteinte à la sécurité nationale. Trois objectifs devaient être poursuivis : éviter que les documents soient détruits, manipulés, volés, ou servent des instrumentalisations politiques partisanes, voire pour des intérêts purement privés. Il fallait ensuite mettre en place un moyen pour les victimes d’être reconnues et d’accéder à une réparation. Etant donné que le secteur de la justice n’a pas été réformé rapidement, le processus parallèle, à travers une institution indépendante, semblait le plus adéquat, à condition qu’il soit sain et reçoive l’adhésion de tous. Le troisième point, c’est d’entamer les réformes. Montrer une volonté rapide de faire les réformes, notamment les plus importantes : celles de la justice, du code pénal et du code de procédure pénale, et celle du secteur de la sécurité.
Farah Hached a estimé que la coopération internationale a été très bénéfique sur certains points. L’appui à la société civile lui a permis d’être prise en compte dans le processus et d’aboutir à l’adoption de la loi sur la justice transitionnelle. L’appui du PNUD à l’IVD a été particulièrement important, au niveau de l’assistance technique. Les coopérations allemande, suisse, polonaise ont été importantes. Par contre, a regretté Farah Hached, cette coopération a initialement commencé avec des formules importées de justice transitionnelle qui se sont avérées parfois inopérantes et inadaptées. De plus, les conseils et les aides étrangères peuvent parfois être perçus comme pesant au détriment de l’indépendance des organisations de la société civile ou comme des leçons à sens unique. Selon Farah Hached, il est important que les pays qui défendent le processus de justice transitionnelle donnent également l’exemple en ouvrant certaines archives et en entamant une démarche de vérité et de justice (ex : exactions commises à l’époque de la colonisation française, exactions commises à l’époque de l’occupation militaire américaine en Irak).
L’importance du suivi des travaux des CVR et de la mise en œuvre des recommandations
Les organisateurs de la table-ronde ont souhaité aussi éclairer des situations moins connues des « études de cas » habituellement présentées par les spécialistes de la justice transitionnelle, grâce en particulier à Mariella Villasante Cervello, anthropologue de la violence politique (EHESS), chercheuse de l’Institut de démocratie et droits humains (IDEHPUCP), Lima. Elle a conduit des recherches au Pérou (1978-1983, 2006-2016), en particulier chez les indiens Ashaninka, ainsi qu’en République Islamique de Mauritanie (2) où le gouvernement de transition en 2007 avait annoncé la réalisation d’une commission de vérité qui devait enquêter sur la politique éliminationniste du régime militaire du président Taya (1989-1991) à l’encontre des citoyens originaires de la vallée du fleuve Sénégal (non-arabophones) ; projet suspendu après le nouveau coup d’Etat d’août 2008. Outre sa connaissance de ces terrains moins familiers, l’intérêt de la présentation de Mariella Villasante résidait dans une approche de la justice transitionnelle partant d’une anthropologie politique de la violence. Un autre intérêt provenait du travail de la CVR péruvienne, qui a été relativement exemplaire, rapide et accessible, mais qui pose la question de la mise en œuvre des recommandations et de la volonté politique de les suivre.
(2) Mariella Villasante Cervello prépare un ouvrage comparatif sur la violence politique dans ces deux pays du Sud. Sur le Pérou on pourra se reporter sa traduction du rapport final de la Commission de la vérité et de la réconciliation péruvienne, Le grand récit de la guerre interne au Pérou. Version résumée du rapport final de la CVR, 2003, sous la dir. du Dr S. Lernes Febres, L’Harmattan, 2015, et à son livre Violence politique au Pérou 1980-2000. Sentier lumineux contre l’Etat et la société, L’Harmattan, 2016 ainsi qu’à son article publié sur le site de l’IHEJ
Le conflit armé au Pérou a commencé en 1980 lorsque le Parti communiste du Pérou-Sentier Lumineux (PCP-SL) a déclaré la guerre à l’Etat et à la société. Le président civil a fait appel aux forces armées, et de décembre 1982 à 2000, celles-ci ont contrôlé la majorité du territoire. Il y a eu 2 pics de violence, en 1983-1984, où on compte plus de 4000 morts, et 1989-90, avec plus de 3000 morts. En 1990, le président de la république Alberto Fujimori, dissout le Parlement et en donne plein pouvoir aux forces armées, qui, avec les milices civiles massivement opposées au PCP-SL, parviennent à venir à bout de l’insurrection.
Son gouvernement est tombé en novembre 2000, alors qu’il présente sa démission depuis le Japon. En 2007, Fujimori est extradé du Chili au Pérou, où il fut accusé des massacres de Barrios Altos et de La Cantuta, de séquestration, de corruption, d’abus de pouvoir et de détournement des biens publics. En avril et en décembre 2009, il fut condamné à 25 ans de prison(3). Le succès du populisme de droite de Fujimori qui revendique la « pacification » du pays, le maintien des réseaux clientèlaires corrompus, et la grande ignorance politique du peuple, expliquent la création d’un parti dirigé par sa fille Keiko, principale opposante du gouvernement actuel(4).
Le gouvernement de transition dirigé par Valentin Paniagua, à partir de novembre 2000, a été à l’initiative de la création de la Commission de la vérité et la réconciliation, à laquelle le gouvernement Toledo (élu en 2001) a donné un large mandat. Elle était composée de 8 membres de la société civile et de 4 religieux et bénéficia du travail de plus de 9 000 assistants dirigés par une centaine de professionnels. La Commission a tenu compte de ce qui avait été fait en Afrique du Sud, au Guatemala et au Chili. Son rapport final, rendu en août 2003, après 26 mois d’enquêtes, se base sur le recueillement de 17 000 témoignages et d’une grande quantité d’informations déposées au Centre de Documentation de la Defensoría del pueblo. La CVR a établi qu’il y avait eu 70 000 morts et 15 000 disparus (par comparaison, au Chili, il y en a eu 3 000 morts, au Salvador 75 000 morts et au Guatemala 200 000 morts). Selon la CVR, le PCP-SL est responsable de 54% des morts, les forces armées de 30%, les milices civiles et groupes paramilitaires de 15%, et le Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA) de 1% des morts.
75% des victimes étaient d’origine andine (Quechua) et amazonienne (Ashaninka). 55% était occupée dans l’agriculture, et plus de 66% étaient des hommes ayant entre 20 et 49 ans.
Les principaux facteurs de violence sont l’inégalité, la pauvreté, et la faiblesse de l’Etat (en 1980, 60% de la population vivait dans la pauvreté et 30% dans l’extrême pauvreté).
(3) Il a depuis été condamné dans d’autres procès pour d’autres affaires, et notamment en 2015 à 8 ans de prison pour détournement de fonds.
(4) Et arrivée largement en tête au premier tour des élections d’avril 2016.
A ce stade, estime Mariella Villasante Cervello, le bilan est décevant même si elle mentionne plusieurs points positifs. Tout récemment, en septembre 2016, la nouvelle ministre de la Justice a demandé pardon aux victimes de la part de l’Etat. La justice pénale a été très rapide pour les principaux responsables, qui sont en prison, mais lente pour le reste. En 2012, on a découvert une vaste campagne de stérilisations massives de plus de 300 000 femmes rurales organisée par Fujimori en 1998 ; mais il n’a pas été jugé pour ce crime contre l’humanité. Un Conseil de réparations aux victimes du terrorisme existe depuis 2006 mais ses réalisations sont insuffisantes. La restructuration de l’Etat n’a pas été faite. Surtout les médias ont peu mis en lumière la CVR et la population ignore le contenu du rapport, à cause notamment de la prégnance d’un racisme ordinaire envers les paysans andins et amazoniens. Les gouvernements successifs ont manqué d’une volonté politique forte.
Ainsi, en Amazonie centrale, la réalité des camps d’internement du Sentier Lumineux n’a pas été reconnue comme telle (réduite à des pratiques de captivité et de mise en esclavage et les sévices sexuels des milliers de femmes et de fillettes, ainsi que le recrutement d’enfants-soldats pas nommés). L’aide internationale et l’attention des institutions et membres onusiens pour appuyer le suivi d’une CVR qui a, en elle-même bien fonctionnée, s’avère donc toujours indispensable. Cela d’autant plus que les associations des victimes ne peuvent pas compter sur l’aide régulière de l’État ; elles sont largement suivies par des ONGs péruviennes et étrangères, et par des instances internationales.
Le renforcement de la capacité d’auto-critique et d’adaptation de la justice transitionnelle dans la durée
Mô BLEEKER, envoyée Spéciale du Département fédéral suisse des Affaires étrangères pour le traitement du passé et la prévention des atrocités, à partir de son expérience sur de nombreux terrains, et en particuliers aux Philippines, a souligné la nécessité de construire les processus de manière auto-critique, sur la base d’un diagnostic général pour déterminer, avec les acteurs locaux, le type de mesure le plus significative, leurs séquences et combinaison ainsi que les 4 ou 5 problématiques clés à traiter. Pour cela il faut tenir compte de plusieurs dimensions et se garder de plusieurs erreurs fréquemment commises en justice transitionnelle.
La première est que la justice transitionnelle est trop souvent conçue comme un outil en soi et se présente comme une réponse technique et « neutre » aux problèmes de la transition. Cette visée technique peut-être sous certains aspect utile mais elle est insuffisante car elle évacue une dimension politique qui demeure au cœur même des enjeux de la justice transitionnelle. Cela implique, comme Mariella Villasante Cervello l’a montré, une analyse profonde sur la nature du conflit et une identification des acteurs du conflit.
La question de la formulation des enjeux et des initiatives à prendre est également importante pour obtenir le soutien et l’implication des acteurs locaux. Il faut sortir des concepts importés et des grilles préfabriquées de la justice transitionnelle « institutionnalisée ».
La délimitation des missions de la justice transitionnelle fait elle aussi l’objet de vifs débats, or la réalité est complexe ; la JT doit s’adapter à cette complexité et pas l’inverse.
Les acteurs de la JT : De nombreux secteurs restent exclus des processus de justice transitionnelle, comme les secteurs de sécurité ou le secteur privé. Mô Bleeker plaide pour que les mécanismes s’adaptent aux réalités et soient au service d’un processus durable. La question du temps est cruciale. Auparavant Farah Hached avait déjà souligné qu’il y avait une contradiction fondamentale en justice ou transitionnelle avec d’un côté, le besoin de réformes institutionnelles juridiques qui prennent forcément du temps, et de l’autre côté, la nécessité de mener le processus de reconnaissance des droits, dans un temps court. Mô Bleeker pointe elle aussi les « équations impossibles » de la justice transitionnelle et en tire plusieurs conclusions : la capacité de pouvoir être autocritique sur les capacités réelles de la justice transitionnelle. A cet égard, la question des moyens est centrale. Mô Bleeker donne l’exemple de l’arrivée de Louis Joinet à Timor-Leste, où il ne put rencontrer qu’un seul avocat. Il faut donc à la fois être attentifs aux manques de moyens, pour y remédier si c’est possible, et réalistes sur ce qu’il sera possible de faire à court, moyen et long terme. La vision extensive des domaines de la justice internationale ne traduit donc pas une prétention idéaliste car elle va de pair avec une modestie et une conscience de ses limites. Cette désacralisation de la justice transitionnelle, loin d’en minimaliser l’importance, doit au contraire appeler un déplacement des ambitions dans une persévérance accrue dans le temps. Il est en effet difficile de définir quand commence et se termine une « transition ». Mô Bleeker propose donc de penser les mécanismes en Court/moyen et long terme plutôt qu’en terme de “transition” pour pouvoir s’inscrire dans la durée. Elle termine son propos en enjoignant à se saisir de problématiques laissées au second plan, et qui sont cruciales. La semaine précédente, avec l’Argentine et le Maroc, la Suisse a lancé une résolution visant à demander à la réalisation d’un rapport sur les liens entre justice transitionnelle et la répétition des violations dans des contextes avec un héritage d’atrocités du passé, afin de dégager des leçons des expériences passées car il semble bien que nous soyons encore loin de ce que nous pourrions et devrions atteindre.
En conclusion
Pour clore, après les débats avec la salle, l’après-midi, Antoine Garapon a expliqué que en organisant la table-ronde, les représentants français avaient voulu se garder d’une simple présentation de leur stratégie et souhaité donner la parole à des ressortissants d’autres pays parce que, justement, cette stratégie se garde bien de se présenter sous la forme d’une panoplie préfabriquée. Comme il n’y a pas de modèle valable de justice transitionnelle « en kit », il n’y a pas non plus de « modèle français » de la justice transitionnelle. Il y a par contre une prise de conscience de l’importance de cette question. En partant d’une compréhension des contextes et de la nature des violences commises, elle s’intéresse à tous les sujets, comme celui de la sécurité ou des inégalités qui ne peuvent en être extraits. La table-ronde a à la fois voulu montrer la diversité des situations et des problématiques. Elle a aussi rappelé le dynamisme et l’importance du rôle de la société civile et de ses associations ainsi que l’appui indispensable des Etats étrangers. La justice transitionnelle n’est pas réduite à une « formule magique » mais est considérée comme une idée régulatrice.
(synthèse par Joël Hubrecht et Pierre Osseland)