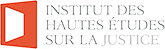À quelques semaines des prochaines élections au Parlement européen, nous inaugurons la publication d’une série d’articles consacrés à « l’idée d’Europe ». Issus d’un séminaire d’initiation à la philosophie politique organisé par l’École nationale de la magistrature en partenariat avec l’IHEJ et la revue Esprit, ces différents textes s’efforcent de retracer la genèse et le développement de l’Europe comme forme politique, et d’interroger les figures, les concepts et les débats qui permettent aujourd’hui de penser son avenir. Dans cette première livraison, Lucien Jaume revient sur le double héritage de la cité grecque et de la philosophie politique du XVIIIesiècle, pour caractériser un certain « esprit européen ».
– – –
L’intitulé de ce séminaire[1] me convient particulièrement dans sa perspective, car l’idée d’Europe renvoie à la question de l’existence d’un esprit européen, ou sens commun européen, pouvant se définir par opposition à la notion d’identité européenne[2]et par affinité à la démocratie et au libéralisme politique.
L’invention de la démocratie à Athènes (et dans d’autres cités grecques) a consisté à promouvoir, en théorie, la liberté et l’égalité des citoyens. Comme Aristote le montre de façon précoce et très claire, si la démocratie ne se donne pas de limites, la puissance du peuple (le kratos) peut s’exercer jusqu’à la détruire. La hantise, par exemple, du leader trop populaire, hantise symbolisée par l’institution de l’ostracisme, est caractéristique d’une conscience de ce risque[3].
Par la suite, l’Europe a continué cette interrogation sur les moyens de préservation du gouvernement de la liberté : le « libéralisme politique »[4]a posé des exigences et des limites pour que la puissance du peuple ne se dévoie pas par ses propres emportements. Le libéralisme et la démocratie pouvaient donc et ont pu se marier pour aboutir à la démocratie libérale – chacun des deux éléments agissant sur l’autre, de façon à réfréner, pour une part, la tendance élitiste du libéralisme et, pour une autre part, à obvier aux tendances despotiques ou autodestructrices de la démocratie. Un avatar possible de la démocratie prend la forme du combat contre le libéralisme : on passe alors du mariage au divorce. Aujourd’hui, diverses formes de régimes se reconnaissent dans la « démocratie illibérale » dénommée ainsi par Viktor Orbàn, au point d’entrer en conflit avec le gouvernement de l’Union européenne.
Esprit européen et démocratie
Un fil rouge traverse les périodes d’Athènes, de l’humanisme de la Renaissance et des Lumières : l’idée selon laquelle « la liberté se fortifie par la règle ou par la loi ». Cette constante ne vaut pas que dans le domaine politique ; elle s’exprime dans l’art – ainsi la découverte de la perspectivedans la peinture, en Italie et dans les Flandres – ou dans la vie sociale – par exemple le règne de l’opinion dans la naissance de la société civile qui engendre des règles autonomes par rapport à la normativité de l’État[5]. Dans le domaine de la pensée politique, John Locke établit, dans le Second traité politique (1690), que l’être humain doit être considéré comme susceptible de se donner des lois : il est « capable of a law ». Locke, protestant, faisait d’ailleurs écho en cela aux premiers Pères de l’Église, à la doctrine homo capax Dei. L’idée que reprendra ensuite Pascal est celle des virtualités, souvent insoupçonnées, de l’être humain, à la fois comme individu et comme membre du genre humain. L’Europe retiendra un grand axiome de Locke : « Là où il n’est pas de loi, il n’est pas de liberté »[6].
Une telle idée de la fécondité de la norme présuppose une philosophie de l’homme, qui définit, en premier abord, l’esprit européen : dans son traité sur l’enfance, Erasme écrit que l’enfant ne naît pas homme, mais qu’il se forge tel (fingitur)[7]. L’homme est donc tout d’abord un être éducable, qui reçoit et donne éducation. En second lieu, l’individu humain se forge par la règle qu’il reçoit ou par la loi à laquelle il a contribué – loi dont, par ailleurs, il se différencie grâce à sa capacité de juger.
Dans ce rapport à la normativité et dans cette liberté envers la même normativité s’inscrit le fondement en conscience de l’autorité, jugée comme légitime, ou, éventuellement, comme illégitime. La légitimité est une problématique essentielle de l’esprit européen. Une telle formulation de l’esprit européen ne peut toutefois être considérée comme une identité : elle n’a pas de contenu matériel, d’image fixe, particularisée, qu’il convient de conserver comme clé d’une religion, d’une doctrine, ou d’une nation particulière. L’esprit européen est un héritage intellectuel et moral, donnant une façon de voir le monde (cf. la question de Kant « Qu’est-ce que l’homme ? ») et de transformer les choses. L’histoire de l’esprit européen constitue un acquis, mais pas un conservatoire figé ou un musée : il s’agit de connaître, de travailler, d’éduquer, de faire société, de dialoguer avec les autres civilisations, etc. L’esprit européen est autant un projet (pro-jet, ce que je jette en avant) qu’une mémoire. Tandis que les identités sont très souvent un signe de fixisme, de conservation d’un passé primordial, et, finalement, d’exclusivisme. L’identité suscite très vite la séparation Nous/les Autres, allant jusqu’à motiver des guerres : Les Identités meurtrières, selon l’écrivain Amin Maalouf[8].
L’esprit européen a par ailleurs un lien inévitable avec la démocratie, à savoir l’idée première de la puissance du peuple, entité formée d’individus libres et égaux détenteurs du jugement en légitimité. Le formidable défi de la démocratie est que la légitimité (l’affirmation que telle autorité mérite respect ou obéissance) est, en droit, l’affaire de tous. Cependant, on peut débattre de la légitimité, jugements contre jugements, et on peut aussi entrer dans des conflits de légitimité comme l’Histoire nous en montre tant d’exemples. Aux sources de la démocratie, Sophocle nous en donne une illustration dans le personnage d’Antigone.
Celle-ci oppose une loi non écrite (venue de la famille, le genos, et des dieux souterrains) à la loi de la Cité que défend le roi Créon. Elle a contre elle sa sœur Ismène qui estime que tout cela n’est pas l’affaire des femmes, mais aussi l’opinion publique. J’utilise à dessein ce terme anachronique (on fait dater l’opinion publique du XVIIIesiècle ap. J.C.), car, dans la tragédie, le chœur dit ce qu’On pense dans la Cité et pourquoi On n’approuve pas le geste d’Antigone qui prodigue les funérailles à son frère, tué à la guerre en ayant combattu contre Thèbes, chez l’ennemi. Antigone répond que cette opinion des citoyens n’est pas si ferme que cela, mais que la peur du pouvoir (Créon est dit tantôt roi, tantôt tyran) agit sur la pensée des Thébains. Cependant, elle hésite maintes fois sur son choix, ce qu’elle exprime en termes troublants, et finit par sombrer dans la folie en même temps qu’elle entre au tombeau de ses ancêtres ; Créon l’a condamnée à y résider, morte vivante. Elle se pend, faisant écho par sa mort à la symbolique tragique de son nom : « Antigone » est celle qui est « non véritablement engendrée et vivante ».
La tragédie grecque a pour finalité de faire réfléchir les citoyens sur les difficultés de la vie sociale et politique ; pendant trois jours, les Athéniens entendaient des milliers de vers et ils devaient, à la fin, par un vote, distinguer les meilleurs auteurs, qui recevaient une récompense. La tragédie est une leçon, une activité éducative, au sein de cette paideia jugée indispensable pour former à la vie civique. La légitimité, très incertaine, de la désobéissance est abordée avec éclat par Sophocle.
Autre exemple, la théorie du pouvoir chez John Locke, une conception qui marie les conditions de possibilité du gouvernement du peuple avec les semences de la rupture individuelle ou collective. Tout est suspendu au consentement (the consent) de l’individu ; au sortir de l’état de nature, vient d’abord l’« autorisation » que chacun donne à former la société (society), puis le consentement à adopter la règle de majorité, enfin un investissement de la représentation électorale à travers le trust : ce concept veut dire à la fois confiance, délégation, et finalité à remplir une mission. Les lois produites par le Parlement et le chef de l’État (monarque de préférence) ne valent qu’autant que l’individu leur accorde son consent : pour cela il doit comparer le contenu de la loi avec les finalités assignées au pouvoir politique, ainsi qu’avec les prescriptions de la loi naturelle (imposée par Dieu, natural law) et les motivations de l’intérêt particulier qui le concernent individuellement. L’homme et le citoyen ainsi associés ont à juger de la valeur de la loi qui est prescrite par le gouvernement. Si la loi est jugée illégitime, alors se produit la rupture, le breach of trust : cette rupture peut être collective, mais aussi individuelle. Si elle est collective, la society subsiste après avoir chassé le parlement ou le roi, et se donne un nouveau pouvoir investi du trust. Si la rupture est individuelle, l’homme en répondra tout seul « au jour du Jugement dernier ». Car, lorsqu’il n’y a personne sur terre pour décider de la question de savoir « qui jugera dans ce conflit ? », il faut que l’individu prenne sur soi, « dans sa propre conscience », le devoir de trancher[9]. Le fondateur du libéralisme politique est à la fois un théoricien de l’équilibre du gouvernement de la liberté et de ses causes d’effondrement ! Des causes qu’on ne peut abolir une fois pour toutes : la liberté, l’individualité, l’opinion de chacun. Ainsi trouvons-nous au cœur de l’esprit européen une double exigence : l’ordre, les institutions, la contrainte, et, en même temps, le jugement sur le juste et le légitime, le droit et le devoir de juger.
L’apport du libéralisme à la démocratie
La démocratie étant donc en son fondement la puissance du peuple rendue consciente de soi, le risque est de tendre vers l’absence de limites. Il y a trois tentations de la démocratie dont l’expérience grecque (Sparte, Athènes, et d’autres cités) porte témoignage : l’exigence de l’égalité absolue, l’exigence d’un contrôle poussé de tous sur chacun, l’exigence d’une uniformité totale de l’opinion. De son côté, le libéralisme est une idée moderne (à partir de la crise du scepticisme et de la montée de la Réforme protestante), tandis que la démocratie est une idée ancienne. La définition du libéralisme sous l’angle historique conduit à souligner la lutte contre les deux souverainetés : souveraineté politique pour ce qui concerne la monarchie absolue, souveraineté spirituelle du côté de l’Église catholique, qui invente d’ailleurs pour la papauté le concept même de souveraineté (plenitudo potestatis)[10]. Le mouvement d’émancipation, en faveur de l’individu et en faveur de la société,que ce soit dans le protestantisme, dans le développement de l’esprit critique ou dans l’exigence de pluralisme de l’opinion, est la source du libéralisme politique.
Le libéralisme a ainsi voulu limiter et encadrer la démocratie, à la fois par la constitution (au sens moderne, différent de celui d’Aristote, du fait du pouvoir constituant) et par trois séparations réellement fondatrices et notamment mises en œuvre avec la Révolution française.
La première de ces séparations passe entre le citoyen et l’État. Tout en étant redevable au corps civique, le citoyen ne se confond pas avec le pouvoir gouvernant. En ce sens, Rousseau distinguait ce qui est le souverain (toujours le peuple) et ce qui est le gouvernant (aristocratique, monarchique ou démocratique). Le citoyen a certains droits octroyés par le gouvernant (sous l’effet des lois et des textes administratifs), mais aussi vis-à-vis ou à l’encontre de l’État gouvernant : expression de l’opinion, liberté d’association, de manifestation, etc.
Dans l’expérience du fascisme italien, les doctrinaires du mouvement entendaient réaliser l’absorption du citoyen dans l’État. Voici un développement lyrique écrit en 1930 :« Dans l’État, l’homme réalise les plus hautes valeurs morales de sa vie et dépasse ainsi tout ce qu’il y a en lui de particulier : convenances personnelles, intérêts, la vie même, si besoin est. Dans l’État nous voyons l’actualisation des plus grandes valeurs spirituelles : continuité par-delà le temps, grandeur morale, mission éducative de soi et des autres[11] ». Chez cet idéologue, qui a été ministre des Corporations et ministre de l’Éducation nationale ensuite, ce n’est pas seulement le citoyen qui s’incorpore à l’État, mais aussi l’homme. Mussolini a parfois présenté le fascisme non seulement comme une nouvelle civilisation mais aussi comme une religion.
La deuxième séparation qu’institue le libéralisme est entre l’homme et le citoyen. Ici, le contraste avec Aristote est net, même si, à certains points de vue les historiens nous montrent une séparation du privé et du public (un privé assez différent de ce que nous considérons comme tel)[12]. Pour les temps modernes, l’homme est séparé du citoyen parce qu’il doit pouvoir jouir de ce qui n’est pas redevance au corps civique. L’opinion de l’homme, religieuse par exemple, ne se confond pas avec une religion nationale, une religion d’État, si elle existe, ou un culte civique (comme à Rome et comme le voulait Hobbes). Ce fut l’enjeu des terribles guerres religieuses : pas de religion de l’homme par la volonté de l’État ; en d’autres termes, liberté de conscience.
La Révolution française, en réalité, a eu peur de l’indépendance de l’homme et du citoyen. D’une part, le légicentrisme français fait qu’il n’est aucun des droits de la Déclaration de 1789 qui ne soit limité par la loi, votée par les représentants de la nation[13]. Ce qui évidemment retentit sur le contenu de ces droits soumis à la loi « expression de la volonté générale », telle qu’elle est interprétée par les députés. D’autre part, la Constitution civile du clergé, promulguée par l’Assemblée constituante, a intégré le corps ecclésiastique à la fonction publique, a fait élire par les citoyens (de statut censitaire) les évêques et les curés et a imposé la transmission des principes révolutionnaires à la pastorale de l’Église[14]. La liberté de conscience et la liberté religieuse sont reconnues, mais, en même temps, le clergé est sommé de se rallier à l’Église « régénérée » qui exerce à la fois une fonction de morale nationale et révolutionnaire et un service public, entièrement encadré par l’État. Cela aboutit au schisme dans l’Église et aux affrontements en Vendée et ailleurs, drame qui imposera à Bonaparte de revenir à la solution concordataire, de type antérieur (concordat de Bologne).
La troisième séparation est celle de la société civile et de l’État, une conception que l’absolutisme s’employait à empêcher. Par exemple, dans la Politique de Bossuet, la société, au nom de la sécurité, n’existe qu’incorporée à l’État (surtout chez le prince chrétien). Pour le libéralisme, la société civile possède une vie véritable qui est différente de la vie politique et peut même élaborer une normativité (mœurs, cultes, règles du marché) qui se distingue du droit élaboré par les organes de l’État.
Dans ces trois séparations – ce qui ne signifie pas trois ruptures ou confrontations hostiles -, le libéralisme vise à préserver les éléments de particularité ou de pluralisme contre les tendances majoritaires qui peuvent être oppressives. Tocqueville a insisté sur la faiblesse de l’individu démocratique devant l’opinion majoritaire, et cela selon une contradiction remarquable : chacun est fier de pouvoir juger par lui-même (car la valeur des opinions est réputée égale), mais se sent craintif devant l’opinion de tous lorsqu’elle est supposée connue[15] ; si tous ont des lumières (supposées) égales, comment la majorité pourrait-elle se tromper ? et comment ne pas donner tort à ceux qui, isolés, ont un autre avis ? Cette inquiétude de l’individu taraude le lien que chacun entretient avec l’opinion publique.
Le libéralisme veut aussi préserver les éléments de particularité présents dans la société vis-à-vis du pouvoir de l’État exercé « au nom du peuple »(selon la formule qu’a introduite la Révolution française).
La crise démocratique et la crise de l’Union européenne
La démocratie est aujourd’hui contestée ; les enquêtes sur dix ans menées au CEVIPOF ou à la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) confirment que de nombreux Français répondent favorablement à l’idée qu’« un autre système que la démocratie pourrait être essayé »,ou qu’un dirigeant serait habilité de façon légitime à gouverner sans tenir compte du Parlement et des élections[16]. Anne Muxel, spécialiste de la jeunesse, nous précise à ce titre que « les jeunes de moins de 35 ans sont toujours plus nombreux que les plus âgés à répondre positivement : 38,5% en Europe (+ 15 points par rapport aux 60 ans et plus), 39% aux États-Unis (+ 17 points) »[17].
Dans ce désamour envers la démocratie, il s’agit de la démocratie libérale : représentation parlementaire, séparation des pouvoirs, juge constitutionnel, libertés du pouvoir judiciaire, liberté de la presse – entre autres. Un modèle fait recette au sein de l’Union européenne, celui de la « démocratie illibérale » selon Viktor Orbàn.
Ce dernier, à la suite du rapport sur la Hongrie de la députée européenne Judith Sergentini, a répliqué en session du Parlement européen, le 11 septembre 2018 : « Vous pensez mieux savoir que les Hongrois ce qui est bon pour eux. (…) Vous allez juger une Hongrie qui fait partie depuis mille ans de la famille des peuples chrétiens d’Europe ». Prétendant s’appuyer sur la devise européenne « Unité dans la diversité », le Premier ministre hongrois dénonce une immixtion intolérable. En effet, dans sa résolution du même jour, le Parlement européen considère que, ne limitant pas l’article 7 du traité UE à ce qui concerne l’application stricte des traités, il a droit à « apprécier l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes dans des domaines relevant des compétences des États membres ».Orbàn affirme que la Hongrie a une autre conception de la famille, de l’identité nationale, etc. Douze griefs sont énoncés contre le pouvoir hongrois dans la résolution du 11 septembre 2018 : corruption, conflits d’intérêts, violations des droits des minorités (dont les Roms et les Juifs), atteintes directes à l’indépendance de la justice vis-à-vis de l’exécutif et du législateur, etc.[18].
La procédure de l’article 7 du traité sur l’Union européenne est donc ouverte contre la Hongrie, après la Pologne et avant, probablement bientôt, la Roumanie. Viktor Orbàn a déclaré à plusieurs reprises qu’il entend maintenir une forme de démocratie, mais que celle-ci ne passe plus par les règles procédurales classiques du libéralisme : une forme de divorce est déclarée entre le libéralisme et la démocratie. Le conflit avec l’Union européenne, que Viktor Orbàn entend continuer à habiter, semble découler d’un affrontement interne : ce dirigeant (qui a remporté deux victoires électorales) ne veut pas laisser des ressources à son opposition ; les cibles principales, et bien caractéristiques, sont la justice, la presse, et la formation universitaire (notamment l’ouverture internationale apportée par l’Université qu’a fondée George Soros).
Ainsi, la philosophie et les principes de ce que certains parmi nous continuent à appeler l’esprit européen sont mis à mal, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe, et aux États-Unis dans une certaine mesure. Il est urgent de revenir sur les grandes questions que les politiques ne traitent pas comme telles : quel lien voulons-nous assurer entre l’ordre et la liberté ? Comment éviter la fuite des problèmes dans la formation de communautés et d’identités qui, tôt ou tard, sécrètent la scission et les guerres ? On conçoit que l’une des toutes premières créations de la culture européenne, l’idée du citoyen, soit à revisiter. Mais le type d’éducation, d’instruction publique, que l’on adoptera, touche directement à cette question. Si le citoyen est « seulement » l’acteur du souci écologique (ce qui n’est pas négligeable) ou, de façon plus grave, le consommateur votant sur le produit préférable, au prix le plus compétitif, alors les intérêts privés et la dépolitisation l’emportent. Si le représentant en démocratie est « celui qui doit nous ressembler », là aussi l’idée démocratique – et républicaine pour ce qui concerne la France -, est méconnue.
Quand l’Europe a conçu le mariage entre la démocratie et le libéralisme, elle entendait articuler de façon riche et complexe trois types d’intérêts : l’intérêt privé, l’intérêt général et le droit universel de l’humanité. Il restait à savoir si l’intérêt général pouvait s’identifier à l’intérêt national et si ce dernier pouvait entrer en divorce avec les droits universels. De fait, l’Union européenne a, premièrement, dans l’édifice institutionnel, plutôt choisi le libéralisme contre la démocratie et deuxièmement, elle a opéré un saut au-dessus des nations, qui était un saut… périlleux.
À regarder le développement de l’idée de citoyenneté, dans l’Antiquité comme au moment des Lumières et de la Révolution française ou américaine, nous pouvons constater que le citoyen est celui qui suit l’élaboration de la loi par ses représentants et qui, en outre, s’exprime pendant cette élaboration (presse, pétitions, meetings, etc.). Le fils de Madame de Staël, vers 1825, admirait la façon dont en Angleterre, les cultivateurs de tous les coins du royaume pouvaient interpeller leurs députés venus expliquer les décisions législatives, et comment, d’un village éloigné à la capitale, en un après-midi, les journaux pouvaient retracer les débats qui avaient eu lieu le matin[19]. On appelait cela la vie de l’opinion publique : public opinion as a tribunal. Qui d’entre nous aujourd’hui peut se dire informé des sujets des directives européennes en débat ? Et qui, à moins d’être un spécialiste de la question, peut suivre le déroulement du débat ? Cette carence affaiblit beaucoup le concept de citoyen de l’Europe.
Le statut des nations est également à repenser. La représentation des individus, à travers leurs partis politiques, est sans doute insuffisante en l’absence de ce que la Constitution américaine a prévu dès 1787 : une représentation des États divers de la République américaine. Représenter la diversité de l’Europe apparaît comme une nécessité, faute de quoi le « grand saut » opéré entre l’individu, citoyen d’un État, et le gouvernement qui est « là-haut », reste tout simplement abstrait. La formule consacrée est celle de « déficit démocratique ». Mais, sans céder au populisme – qui ne doit pas nous intimider – c’est aussi un déficit nationalitaire. Il suffit de songer à la question des langues, question par laquelle ce que l’on a chassé par la porte (au profit d’un anglais « globish ») revient vite par la fenêtre. Il serait raisonnable, s’il est encore temps, de refonder cette union des peuples et de la vivre cette fois comme un produit de notre histoire, dans ses gloires et ses misères. L’économie, le grand marché, tout cela ne peut servir d’ersatz à la conscience européenne.
[1]« L’idée d’Europe » était le thème du séminaire d’initiation à la philosophie politique organisé par l’École nationale de la magistrature entre le 28 janvier et le 1er février 2019, Ce texte est adapté d’une conférence prononcées à cette occasion.
[2]L. Jaume, Qu’est-ce que l’esprit européen ?, coll. Champs Essais, Paris, Flammarion, 2010, p.171
[3]Voir notre étude : « “Popularité” : une hantise sous la Révolution française”, Commentaire, n° 162, été 2018, p. 665-672.
[4]Définition provisoire : le mouvement d’émancipation de l’individu et de la société vis-à-vis des deux souverainetés,la monarchie absolue et l’Église catholique. Ce mouvement se développe en Europe entre le XVème siècle et le XVIIIème.
[5]Voir Qu’est-ce que l’esprit européen ?,Deuxième partie (« Le sujet et le marché. La théorie de la société civile »).
[6]Where there is no law, there is no freedom, Second Traité, dans J. Locke, Two Treatises of Government, P. Laslett ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1988, § 57.
[7]Erasme, Traité de l’éducation des enfants, 1529.
[8]A. Maalouf, Les Identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998.
[9]« De cela je suis seul juge dans ma conscience » (Of that, I am the only judge in my own conscience) :Second Traité, éd. cit., § 21
[10]Sur ce point, voir Alexandre Passerin d’Entrèves, La Notion de l’Etat, Paris, Sirey, 1969.
[11]Giuseppe Bottai, « Stato corporativo e democracia », Lo Stato, mars-avril 1930, cité par Emilio Gentile, Qu’est-ce que le fascisme ?, 2002, Gallimard, 2004, coll. Folio Histoire, p. 352.
[12]Un ouvrage qui fait référence : Mogens H. Hansen, La démocratie athénienneà l’époque de Démosthène, Paris, Les Belles Lettres, 1993, Tallandier, 2009. Le livre couvre une période en-deçà et au-delà de Démosthène.
[13]Fait exception le droit de résistance à l’oppression. Ce sera d’ailleurs l’objet d’une intense controverse entre Condorcet, la Gironde, d’un côté, les Montagnards de l’autre.
[14]Voir notre ouvrage, Le Religieux et le politique dans la Révolution française. L’idée de régénération, Paris, P.U.F., 2015, 163 p.
[15]Sur cette thèse de Tocqueville, voir notre ouvrage, Tocqueville : les sources aristocratiques de la liberté, Paris, Fayard, 2008, 473 p. Notamment p. 93 et suiv. : le Public comme autorité non institutionnelle.
[16]Baromètre de la confiance politique, CEVIPOF et Opinion Way, www.sciencespo.fr:« Avoir à sa tête un homme fort qui n’a pas à se préoccuper du parlement et des élections », constitue une réponse approuvée autour de 45% en moyenne, entre décembre 2014 et décembre 2018.
[17]A. Muxel, « L’effritement de la confiance démocratique par le renouvellement des générations », dansOù va la démocratie ?, sous dir. D. Reynié, Enquête internationale de la Fondapol, Paris, Plon, 2017, p. 45.
[18]La résolution a été votée par 448 voix, contre 197, qui refusent donc le passage aux sanctions, et 48 abstentions, www.europarl.europa.eu
[19]Auguste de Staël, Lettres sur l’Angleterre, Paris, Treuttel et Würtz, 1825.