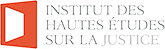À quelques semaines des prochaines élections au Parlement européen, nous poursuivons la publication d’une série d’articles consacrés à « l’idée d’Europe »(1). Il s’agit dans ces différents textes de retracer la genèse et le développement de l’Europe comme forme politique, et d’interroger les figures, les concepts et les débats qui permettent aujourd’hui de penser son avenir. Pour cette seconde publication, Guy Samama revient sur ce que Stefan Zweig entendait par « Europe de la culture, des arts et des sciences ».
—
« Le nationalisme, c’est la guerre », déclarait François Mitterrand. Un Président de la République française aujourd’hui énonce un propos analogue lorsqu’il dénonce une fascination pour le repli, la violence et la domination qui conduisent l’Europe au bord du suicide, et déclare que le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme qui en est la trahison.
Bien avant eux, Stefan Zweig ne s’exprimait pas autrement. Mais autant il avait une idée juste – à la fois pertinente et conforme à l’idéal de justice – de ce que devait être l’Europe, autant il restait pusillanime face à sa réalisation. Tel est l’essentiel de notre propos.
Une idée juste de l’Europe : une Europe apolitique, cosmopolite, supranationale, purifiée de toute haine et de toute défiance ; une Europe de la culture, des arts et des sciences. Une Europe conçue comme le principe opposé à la gangrène du nationalisme et comme une modalité contemporaine du cosmopolitisme.
Zweig avait peut-être inconsciemment peur que cette idée prît consistance en s’accomplissant, par défiance de principe envers l’inévitable dimension politique de la construction européenne. Il était convaincu que celle-ci ne pourrait s’accomplir qu’à partir des talents de la société civile, non à partir des institutions et des partis politiques. Il critiquait ainsi la Société des Nations « en raison d’un appareil trop lourd, d’une domination excessive de la diplomatie, d’un trop-plein professoral au détriment de la jeunesse (2) . » Il pensait que, pour elle, la politique comptait plus que la culture. Or, son idée de l’Europe, c’est une Europe des idées.
La folie des nationalités
Dans une conférence prononcée le 28 mars 1946 au McMillin Theater, Albert Camus constatait que la génération à laquelle il appartenait vivait dans la négation : « Ce qu’il y a de nouveau, c’est que ces hommes de cette génération, étrangers à toute valeur, devaient prendre position par rapport d’abord à la guerre, ensuite au meurtre et à la terreur. À cette occasion, ils ont eu à penser qu’il existait peut-être une Crise de l’homme, parce qu’ils ont eu à vivre dans la plus déchirante des contradictions. Car ils sont entrés dans la guerre comme on entre dans l’Enfer, s’il est vrai que l’Enfer est le reniement. Ils n’aimaient ni la guerre, ni la violence ; ils ont dû accepter la guerre et exercer la violence. Ils n’avaient de haine que pour la haine […] (3) ». Il qualifiait la situation, que ce soit à l’intérieur des nations, ou dans le monde, de maladie. La méfiance, le ressentiment, la cupidité, la course à la puissance fabriquent un univers sombre et désespéré où chaque homme se trouve obligé de vivre dans le présent, le mot seul d’« avenir » lui figurant toutes les angoisses. Parmi les cinq remèdes proposés par Albert Camus pour guérir cette maladie, le deuxième est de décongestionner le monde de la terreur qui y règne, le cinquième est de créer un universalisme où tous les hommes de bonne volonté pourraient se retrouver. La condition en est de remplacer l’homme politique et historique par l’homme réel, avec ses valeurs. Camus avait compris que la crise de l’Europe devait s’inscrire dans une crise plus générale : celle de l’homme.
Or, Stefan Zweig dans une conférence prononcée en 1932, qui prolonge celle sur « La pensée européenne dans son développement historique » où il appelle à des « États-Unis d’Europe », cite Nietzsche déclarant qu’il faut en finir avec les « patriotarderies », évoquant notamment un passage de Par-delà le bien et le mal qui résume sa pensée : « La folie des nationalités explique pourquoi les peuples européens sont devenus de plus en plus étrangers les uns aux autres, et cette pathologique ignorance réciproque dure encore aujourd’hui ; elle a porté au pinacle des politiciens à la vue courte et à la main leste, qui ne se doutent même pas que leur politique de désunion ne peut être nécessairement qu’un intermède [...]. On feint de ne pas voir […] les signes qui annoncent avec le plus d’évidence que l’Europe veut s’unifier » (4) . Combien ces mots se révèlent être prophétiques au moment où les tendances protectionnistes, obscurantistes et nationalistes reviennent au galop !
Une proximité, sinon une parenté intellectuelle, entre Nietzsche, Zweig et Camus nous apparaît manifeste, à tort ou à raison : tous les trois regardaient la crise politique de l’Europe avant tout comme une crise psychologique et morale. En témoigne par exemple le titre symptomatique de la conférence de Stefan Zweig à Rome : « La désintoxication morale de l’Europe ». Il y appelle de ses vœux une union culturelle de l’Europe avant son union politique, militaire et financière, mais reconnaît qu’elle se heurte à des tendances farouchement opposées : « Si nous considérons l’Europe comme un organisme intellectuel unique – deux mille ans d’une culture édifiée en commun nous en donnent sans réserve le droit – nous ne pouvons éviter de reconnaître que cet organisme, au moment présent, a succombé à une grave crise psychique. Dans toutes les nations ou presque se manifestent les mêmes phénomènes de forte et brusque irritabilité malgré une grande lassitude morale, un manque d’optimisme, une méfiance prête à s’éveiller en toute occasion et la nervosité, l’humeur chagrine qui résultent du sentiment général d’insécurité. Pour se maintenir en équilibre, les humains doivent faire constamment un effort psychique, de même que les États ne doivent pas relâcher leurs efforts en matière d’économie ; on ajoute foi aux mauvaises nouvelles plus facilement qu’à celles qui rendent l’espoir et les individus autant que les États, plus qu’à d’autres époques du passé, semblent prêts à se haïr. La défiance mutuelle se révèle infiniment plus forte que la confiance. » (5).
Ce texte semble produire mutatis mutandis une photographie en grandeur réelle de l’Europe actuelle, moins déchirée entre d’un côté nationalistes et populistes, de l’autre progressistes et humanistes, qu’empoisonnée par la défiance, la violence et la haine mutuelles entre individus et États. Stefan Zweig anticipait peut-être le virus de l’euroscepticisme, et préfigurait déjà ces mouvements de colère, d’irritation, qui font perdre la raison à des esprits échauffés.
Dès 1932, Stefan Zweig avait diagnostiqué que l’Europe était malade, et que sa maladie était moins technocratique, économique, financière, encore moins politique, mais bien psychologique.
La crise de l’Europe est d’abord morale, celle-ci étant gangrenée par le ressentiment, la violence, la haine entre les peuples de différentes nations soucieuses de se protéger en défendant leurs frontières. Il y voyait, dans un texte-reportage à la Croix-Rouge, « un horrible schéma pathologique de l’histoire de notre maladie psychique depuis août 1914 jusqu’à nos jours » (6) . S’il est possible de changer procédures et réglementations, voire lois et institutions, comment changer des esprits ?
Non seulement les frontières politiques sont labiles, changeantes, surtout en Europe centre-orientale, la Mitteleuropa, mais elles coïncident rarement avec les frontières culturelles, moins encore avec la carte mentale de l’imaginaire. L’Histoire nous apprend aussi que les Traités de paix deviennent sitôt conclus, sous la pression de peuples vaincus et humiliés ne cherchant qu’à prendre leur revanche, des vistemboires (mot inventé par Jacques Perret dans le Machin), des objets sans plus d’utilité. Une exposition récente au Musée de l’Armée, À l’Est la guerre sans fin 1918-1923, nous rappelait qu’après l’effondrement des quatre grands Empires, colosses aux pieds d’argile, qui dominaient l’Europe centrale et orientale en 1914 – l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Russie, l’Empire ottoman de manière résiduelle – les ambitions des vainqueurs étaient partiellement contradictoires : l’Américain Wilson préconisait une politique idéaliste des nationalités ; le Britannique Lloyd George soutenait la tradition d’un équilibre européen ; le Français Clemenceau était hanté par la persistance d’une menace potentielle allemande ; l’Italie s’estimait mal récompensée de son engagement. La question se posait des réalités territoriales et nationales enchevêtrées, s’accordant mal avec le modèle de l’État-nation homogène. Les populations étaient consultées, mais occasionnellement, et les résultats étaient parfois faussés pour des motifs stratégiques. C’est ce tableau de l’Europe, incluant des déplacements fréquents de frontières, et dessinant chaque fois une nouvelle carte géographique, militaire et politique, que Stefan Zweig avait sous les yeux lorsqu’il écrivait les textes parus pour la plupart dans la Neue Freie Presse à Vienne, et réunis sous le titre Seuls les vivants créent le monde (7).
Une Europe apolitique
D’où venait cette attitude, constante chez Stefan Zweig, de rester au seuil du réel sans oser jamais l’affronter ? Un exemple frappant en est donné par sa rétractation après avoir accepté en mai 1933 de collaborer à la revue antinazie animée par Klaus Mann, Die Sammlung, et après avoir annoncé l’envoi d’un chapitre de son Érasme. Le 11 septembre 1933, il demande à Klaus Mann de retirer son nom de la liste des contributions annoncées dans sa revue, puis écrit à son éditeur, Anton Kippenberg, directeur des éditions Insel, pour l’assurer de son hostilité à la ligne politique de la revue. Cette lettre à Kippenberg, publiée le 14 octobre 1933 dans le journal de la librairie allemande contrôlé par les nazis, est apparue comme un geste de ralliement affligeant et vain. Attitude rémanente chez celui qui préfère se cacher derrière ses textes plutôt que d’avoir à affronter un public, et de devoir s’expliquer.
De même, en 1936 lors d’un congrès du Pen Club, au Brésil, invité à s’exprimer sur la montée du fascisme en Allemagne, jugeant sa position d’exilé trop facile, il laisse un confrère mineur, Emil Ludwig, prononcer à sa place le discours d’avertissement enflammé que toute l’assistance attendait. Ces grandes manifestations mondaines, il les appelle « foires aux vanités ». Plus tard, durant l’année 1941 à New York, chez son ex-épouse Friderike, accablé par les sollicitations d’autres exilés, il éprouve avec angoisse l’impossibilité d’écrire des lettres de recommandation. Désespéré, il s’interroge à haute voix : « Que pèse mon travail face à cette réalité ? ».
Dans l’idée qu’il se faisait de l’Europe, où la dimension économique est souvent absente, s’imposent le rôle de la presse – plus généralement de l’imprimé – de l’éducation, d’une académie européenne, d’une université européenne dont les sessions se dérouleraient dans telle capitale ou dans telle autre, des échanges linguistiques et culturels entre jeunes gens dans différents pays européens pour apprendre une langue commune – préfiguration d’ Erasmus – l’idée d’une capitale tournante de l’Europe, un peu sur le modèle du Saint Empire. Stefan Zweig propose que soit désignée chaque année une nouvelle capitale de l’Europe à l’extérieur du groupe des grandes métropoles comme Londres, Paris ou Berlin, où seraient regroupés les congrès internationaux de toute nature. Il faudrait somme toute inculquer « l’esprit de Genève » à toutes les villes européennes à tour de rôle afin d’y diffuser le cosmopolitisme et de multiplier les rencontres entre individus ainsi que les contacts entre groupes socio-professionnels. Genève a souvent été pris pour modèle de solidarité par Stefan Zweig, notamment la Croix-Rouge internationale dont la vocation est de porter assistance et secours, par-dessus les frontières en feu, à des millions de personnes de toutes nationalités enfermées « dans des baraquements et des camps clos, à la façon de bêtes sauvages » (8).
Mais il convient d’abord de ne pas entendre apolitique à contresens, par exemple au sens des Considérations d’un apolitique de Thomas Mann, son journal pendant la guerre de 1914-1918, défense très contestable du nationalisme allemand : « J’étais un homme apolitique, ce que le littérateur de la civilisation appelle un esthète […]. Mais le patriotisme ne ressort-il pas à la politique ? Ne reste-t-il pas, en tant que politique, une excentricité pour l’artiste ? Car la politique est inhumaine, l’objet de l’artiste, au bout du compte, est, sinon l’humanité, du moins l’humain (9)».
Apolitique chez Stefan Zweig prend un sens tout à fait précis et particulier. Par-delà une aversion réitérée à l’égard de la politique – seuls deux mouvements politiques trouvent grâce à ses yeux, la social-démocratie et le sionisme de son ami Theodor Herzl – il conviendrait de l’entendre, selon Jacques Le Rider, comme une antipolitique dans le sillage de l’esthétisme chez Nietzsche, à la lumière de l’antipolitique antitotalitaire de György Konrad suggérant qu’il y aurait au XXe siècle une tradition antipolitique propre aux intellectuels de la Mitteleuropa et à la manière de Musil. Au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, au palais de la Mutualité à Paris en juin 1935, il suscitait la consternation générale en déclarant : « Comment défendre la culture, et contre quoi, voilà un problème infini […]. Ce que je veux en dire ici et aujourd’hui est apolitique. Toute ma vie, je me suis tenu à l’écart de la politique, parce que je ne me sens pour elle aucun don. On objecte qu’elle requiert chacun de nous, parce qu’elle est quelque chose qui concerne chacun de nous ; objection que je n’arrive pas à comprendre. L’hygiène aussi concerne chacun de nous ; néanmoins, je n’en ai jamais traité en public, parce que je me sens aussi peu doué pour faire un hygiéniste que pour faire un industriel ou un géologue » (10). Il estime que l’Europe a moins besoin de politiques et de diplomates que de « bons Européens » dégrisés des passions politiques nationales et désintoxiqués des addictions idéologiques qui ont rendu possible la Première Guerre mondiale (11). Il ajouterait peut-être, selon Le Rider, le refus de toute forme de nationalisme et l’affirmation d’un cosmopolitisme humaniste (12).
Dans une lettre à Joseph Roth du 27 mars 1934, écrite depuis Londres, l’on perçoit bien les ambiguïtés de l’attitude de Stefan Zweig : il refuse énergiquement d’être mêlé aux compromissions de la politique, et en même temps il écrit, avec les meilleures intentions du monde, une conférence prête depuis une année, peu de temps après la venue de Hitler à Strasbourg, qu’il s’interdit de prononcer en demandant si quelqu’un d’autre ne peut pas parler à sa place. Car cela aurait donné prétexte à des attaques si justement à Strasbourg, où tout le monde comprend l’allemand, il avait parlé français comme écrivain allemand. Il appelle cela sa discrétion jusqu’à l’hystérie. Cette prudence excessive et systématique, cette discrétion, sont qualifiées par ses amis – Romain Rolland au premier chef – de pusillanimité. Joseph Roth l’avait bien compris. Dans une lettre du 7 novembre 1933, il écrit : « Rolland a raison. Sous aucun prétexte, un homme droit ne doit redouter la “politique” […]. C’est de la morgue de vouloir être plus olympien que Hugo et Zola […]. Tout vient de votre attitude hésitante. Tout le mal. Tous les quiproquos. Tous les petits articles débiles sur vous. Vous risquez de perdre le crédit moral du monde et de ne rien gagner dans le IIIe Reich (13) ».
C’est dans ce contexte plus général qu’il conviendrait de comprendre, selon nous, d’où vient l’apolitisme chez Stefan Zweig : une lucidité, mais abstraite, sans aucune efficacité réelle ; un romantisme (14) qui le fait appartenir, jusqu’à la fin, à la Vienne effervescente de sa jeunesse, celle de la Belle Époque, et au Monde d’hier ; une incapacité, qui est une peur, à décider quoi que ce soit.
En résumé, cet apolitisme, d’un côté, traduit négativement un refus d’apparaître en public même au côté des siens, de se compromettre dans des combinazione et des basses intrigues qui accompagnent toujours toute forme d’action politique ; de l’autre, il traduit positivement l’affirmation de la valeur suprême, transfrontières, de la littérature et de la culture. Affirmation dans laquelle il s’est enfermé.
La force des idées
La construction, ou la reconstruction, de l’Europe pour les générations futures exige aussi de contrebalancer les contre-vérités, les injures, les diffamations propagées par des imprimés. À cette fin, devrait être créée selon Stefan Zweig une instance supranationale « ayant le pouvoir et le devoir de démentir toute fausse nouvelle ou accusation publiée dans un pays au sujet d’un autre pays et les journaux ou revues de tous les pays devraient s’engager ou être contraints par l’État à publier ces rectificatifs. Si nous disposions d’une telle instance, nous obtiendrions une convention unifiée, en vigueur dans tous les pays d’Europe, mettant en place l’office chargé de couper court énergiquement à tous les mensonges avant qu’ils se diffusent dans le monde, et il y aurait ainsi dans tous les États européens infiniment moins de poussées de colère et de défiance envers les États voisins » (15). En se voyant assigner une moralité supérieure, la corporation des gens de plume (journaux, revues) aurait une mission de paix. Le besoin de haïr serait éradiqué. Ce rôle central de la presse est précurseur des mensonges diffusés par les tweets et les réseaux sociaux, mais Stefan Zweig n’envisageait pas la démarche inverse : l’information garante des libertés, contre-pouvoir opposé à toutes les insinuations, tous les mensonges qui circulent partout dans le monde.
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse (16)». Ces mots de Camus dans le Discours de Suède confient peut-être aux générations futures le soin de consacrer leur énergie à ce qu’au moins la classe d’âge d’après la guerre ne succombe pas à la mentalité haineuse qui décompose l’Europe et la livre à ses anciens démons. C’est le rôle de l’éducation. On éduquerait, dans tous les pays en même temps, une élite connaissant les langues et les mœurs étrangères, une sorte d’état-major de l’armée intellectuelle dont la mission serait de conquérir l’avenir. Tous les pays disposeraient d’un large milieu de personnes ayant un point de vue à la fois national et européen. Les rapprochements pacifiques et amicaux feraient obstacle à tous les malentendus nourrissant la haine et déclencheurs de conflits. En actionnant en même temps ces trois ou quatre leviers – le lycée et l’université ; le rôle de la presse ; l’idée d’une capitale tournante de l’Europe ; la formation d’une société civile européenne – Stefan Zweig pensait pouvoir contribuer à construire une Europe de la culture.
Or, avec lucidité, dans ce même Discours de Suède, Camus mettait en garde l’artiste, l’écrivain, contre la tendance à l’isolement. Il est soumis à la vérité la plus humble et la plus universelle. « Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous » (17). Sans le vouloir sans doute, Camus ne décrivait-il pas une attitude constante de Stefan Zweig préférant un splendide isolement au contact fraternel avec d’autres hommes, et croyant qu’il servait ainsi mieux son propre idéal : un indéniable talent d’écrivain ?
Au début de l’été 1939, Stefan Zweig écrivait pour lui : « Chaque jour, ma prière du matin est : “Seigneur, rends-moi égoïste et fais que je ne perde pas entièrement une journée à m’occuper d’autrui”. Les gens veulent tous quelque chose et, de même que des chiens qui n’ont pas encore appris la propreté laissent chez vous leur crotte, ils laissent un peu de leurs soucis et de leurs misères dans votre tête, de telle sorte qu’elle prend regrettablement l’aspect et l’odeur d’une étable ». Tordrait-il ainsi le cou à l’idéal européen, ou bien, selon celle qui l’a le mieux connu, Friderike, ne serait-ce pas plutôt une expression d’extrême vulnérabilité et de grande souffrance ?
C’est néanmoins le même homme qui, après une visite à la Croix-Rouge internationale de Genève, dans un reportage publié en 1918 sous le titre Le cœur de l’Europe, n’avait pas de mots assez élogieux, dithyrambiques même, pour cette organisation de la solidarité et de l’entraide dont le titre de gloire était selon lui de « s’être élevée au-dessus des préjugés d’un monde tombé en état de démence furieuse et de n’avoir pas craint de réunir sous son toit, pour un travail pacifique et amical, des Français, des Allemands, des Anglais, des Serbes et des Bulgares (18)» : exemple d’ « oasis de véritable internationalisme, des rapports amicaux entre hommes de tous les peuples, dans un sentiment de fraternité et non d’hostilité (19)». Il n’était pas loin de faire de cette organisation internationale un modèle pour l’Europe. Car la construction européenne est un travail communautaire, et l’Union est plus que jamais nécessaire.
Dans sa conférence de 1934, L’unification de l’Europe, soit un an après la prise de pouvoir par Hitler le 30 janvier 1933, Stefan Zweig est conscient que le temps presse, qu’il convient de passer du stade des idées, stériles, à celui de l’action créatrice. Ce n’est pas le moindre des paradoxes chez cet homme qui, en acceptant toutes les invitations à des rencontres, débats, conférences, colloques, etc., déclare s’en défier, et croit agir par la seule force de l’idée.
Comment rendre visible cette idée, c’est l’objet de cette conférence. Alors que le nationalisme dispose de tous les leviers, pouvant compter sur l’enseignement, l’armée, l’uniforme, les journaux, les hymnes et les insignes, la radio, la langue, alors qu’il fait vibrer les masses et maîtrise l’art de se mettre en scène, Stefan Zweig fait une proposition : regrouper dans le temps et dans l’espace tous les congrès internationaux de sorte qu’ils se déroulent toujours, pendant l’année en cours, dans une ville et durant un mois. Cette ville pourrait acquérir le statut d’une capitale de l’Europe.
L’appel de Stefan Zweig à cette conversion opérée de l’hostilité en émulation au service de l’esprit de communauté et d’hospitalité s’opère encore par l’esprit. Stefan Zweig parle de congrès internationaux. Mais il reste prisonnier de sa représentation d’un idéal de l’Europe : idéal qui s’éloigne chaque jour davantage.
Dans une « Réponse à une enquête sur l’esprit européen », publiée dans les Nouvelles littéraires le 4 juillet 1936 et citée par Jacques Le Rider, Stefan Zweig déclarait que l’esprit européen « existe, sans aucun doute, mais il est encore à l’état latent. Nous avons de cela la même certitude que l’astronome qui voit apparaître dans sa lunette un astre dont ses calculs lui ont révélé l’existence. Bien que l’esprit européen ne se soit pas encore manifesté, nous savons avec une certitude mathématique qu’il existe (20) ».
Comment entendre ces mots au moment où l’Europe vacille et s’effrite de tous côtés ? Cette étoile lointaine, assombrie par un ciel d’orages où éclatent et explosent les divisions, les violences, les appels à la haine, aura-t-elle la force de puiser en elle-même l’énergie de briller à la manière d’une étoile ?
Une Europe non plus enlevée par Zeus déguisé en taureau d’une éclatante blancheur, transi de désir amoureux pour sa beauté, mais devenue objet scientifique incertain pour astrophysicien à venir au milieu d’un tourbillon de menaces.
1 « L’idée d’Europe » était le thème du séminaire d’initiation à la philosophie politique organisé par l’École nationale de la magistrature entre le 28 janvier et le 1er février 2019, en lien avec l’Institut des hautes études sur la justice et la revue Esprit. Ce texte est adapté d’une conférence préparée à cette occasion.
2 Stefan Zweig, « La désintoxication morale de l’Europe », in Appels aux Européens, Bartillat, 2014, p. 96.
3 Albert Camus, La Crise de l’homme, in O. C. Pléiade II, p. 738.
4 Stefan Zweig, « La pensée européenne dans son développement historique », in Derniers messages, éd. Bartillat, 2013, p. 70, retraduit par Jacques Le Rider.
5 Ibid., p. 71-72.
6 Stefan Zweig, Le cœur de l’Europe, Une visite à la Croix-Rouge internationale de Genève, éd. du Carmel, Genève, paru initialement le 23 décembre 1917 dans la Neue Freie Presse, édité en 1918, p. 12.
7 Stefan Zweig, Seuls les vivants créent le monde, éd. Robert Laffont, 2018.
8 Stefan Zweig, Le cœur de l’Europe, Une visite à la Croix-Rouge internationale de Genève, 1918, p. 9.
9 Thomas Mann, « Contre le droit et la vérité », in Considérations d’un apolitique, éd. Grasset, 2002, p. 133.
10 Ibid., « Conférence. Paris », p. 292.
11 cf. Jacques Le Rider, « Préface » aux Appels aux Européens, p. 53.
12 Ibid., p. 54.
13 Ibid., p. 137 et 139.
14 Sur le romantisme de Zweig, cf. Stefan Zweig/Joseph Roth Correspondance 1927-1938, Bibliothèque Rivages 2013, lettre 90 citée de Joseph Roth du 24 juillet 1933, p. 126 et 127.
15 Ibid., « La désintoxication morale de l’Europe », p. 101-102.
16 Albert Camus, Discours de Suède du 10 décembre 1957, éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, O. C. IV, 1957-1959, 2008, p. 241.
17 Albert Camus, Discours de Suède, ibid., p. 240.
18 Stefan Zweig, Le cœur de l’Europe, Une visite à la Croix-Rouge internationale de Genève, éditions du Carmel, 1918, p. 11.
19 Ibid.
20 Il s’agit de l’astronome et mathématicien Urbain Le Verrier (mars 1811-sept. 1877), découvreur de la planète Neptune par le calcul, non par l’observation. Cette planète fut découverte par l’astronome Johann Galle (1812-1910) à l’Observatoire de Berlin le 23 septembre 1846.