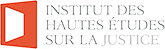À quelques jours des élections au Parlement européen, nous concluons par dernier texte la publication de notre série d’articles consacrés à « l’idée d’Europe »*. Homme politique et essayiste, député au Parlement européen pendant 18 ans, Jean-Louis Bourlanges s’interroge sur la difficulté de l’Union européenne à se définir elle-même et les incertitudes qui en résultent, au moment même où ses valeurs fondamentales doivent, plus que jamais, être défendues.
—
Jacques Delors avait coutume de définir l’Union européenne comme un « OPNI », un objet politique non identifié. L’un des problèmes fondamentaux de l’Union européenne est en effet que les dirigeants politiques de tous les pays et de tous les partis s’ingénient à ne pas répondre à trois questions en apparence simples mais pourtant difficiles : qui, quoi, comment ?
La première question est de savoir qui est membre de l’Union européenne ou a vocation à le devenir. Or les Européens continuent d’éluder cette question des frontières. Il est significatif, à cet égard, qu’au moment où le Royaume-Uni quitte l’Union européenne, il se trouve dans l’incapacité totale de dire où passera sa frontière avec l’Union européenne.
Deuxièmement, que faisons-nous réellement, au plan européen ? Quelle est la clé de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États ?
Troisièmement, comment s’organise un pouvoir politique commun à un ensemble de sociétés qui se reconnaissent dans les principes fondamentaux de la démocratie et des libertés ? La question se complique quand certains pays, rentrés dans l’Union européenne en reconnaissant ses principes, s’en détournent aujourd’hui tout en en restant membres. Toute la prédication du premier ministre hongrois, Viktor Orban, repose sur le concept insolite et toxique de démocratie « illibérale », c’est-à-dire une démocratie qui serait fondée sur un pouvoir du peuple organisé en dehors du système de liberté qui en permet le fonctionnement harmonieux.
En général, on postule l’idée que la démocratie c’est le pouvoir du peuple – d’un demos. Il existe une correspondance entre un peuple, un État, et un système politique plus ou moins majoritaire, organisé pour articuler l’action de l’État au pouvoir du peuple. Nous rencontrons ici deux difficultés : l’Union est composée d’une trentaine de peuples et ce concept de peuple n’a lui-même, à la différence de ceux d’État ou de citoyen, jamais été défini de façon rigoureuse. Ne serait-il donc pas nécessaire que la démocratie de l’Union présente un caractère « dual », certains diront « fédéral » et qu’elle s’enracine simultanément dans le pouvoir des États, qui s’exerce au travers des Conseils, et celui des citoyens, qui s’exerce dans les pouvoirs du Parlement européen ?
La deuxième difficulté, c’est que les pourfendeurs de déficit démocratique se trompent de cible. Ce qui fait défaut à l’Union ce n’est pas l’enracinement de ses pouvoirs dans la volonté des citoyens mais le peu d’effectivité de son système – tant par rapport aux forces économiques mondiales que par rapport aux forces des États. L’euroscepticisme aujourd’hui me semble très largement fondé sur ce déficit de kratos.
L’Union européenne se saisit – verbalement, procéduralement, médiatiquement – de tous les problèmes, mais elle n’est en mesure de délivrer une réponse précise que dans un petit nombre de domaines. Pensons aux attitudes vis-à-vis de l’euro. La Banque centrale européenne – une institution certainement plus technocratique que démocratique – mène une politique monétaire précise et cohérente, qu’on l’approuve ou non. À partir du moment où Angela Merkel a estimé qu’on pouvait donner à la Banque centrale européenne à peu près les prérogatives d’une banque centrale ordinaire, c’est-à-dire celles de prêteur en dernier ressort, le mouvement de « sortie » de l’euro a cessé. Le premier à avoir abandonné le combat sécessionniste a été Alexis Tsipras, en 2015, et la dernière, semble-t-il, la présidente française du Rassemblement national, qui a tiré cette leçon de son échec à l’élection présidentielle. Le système euro, qui est un système fédéral d’essence technocratique et efficace, recueille l’approbation alors qu’un grand nombre de politiques menées dans des formes très démocratiques à Bruxelles – entre le Parlement, la Commission, le Conseil des ministres – sont critiquées. C’est bien le manque d’effectivitié de l’action de l’Union qui est la cause du scepticisme.
Ces trois questions fondamentales ne sont jamais abordées. L’Union européenne semble avoir fait sienne la devise du célèbre président de la Cour d’assises dans l’affaire Dreyfus, qui a répondu, pendant toute la durée du procès : « La question ne sera pas posée ». On en vient à se demander si le premier problème de l’Union européenne n’est pas, comme le soleil ou la mort selon Héraclite puis La Rochefoucauld, de ne pas pouvoir se regarder en face.
Si la question n’est pas posée, c’est peut-être que l’on craint de s’apercevoir qu’aucun peuple, aucun État n’y apporterait les mêmes réponses. L’ensemble de l’édifice serait alors menacé, non par son déficit démocratique, mais par son déficit d’identité.
Une fois encore, la campagne électorale de mai 2019 porte sur de tout autres sujets. Pourtant, tant que l’on n’aura pas répondu à ces questions, on ne sera pas en mesure d’organiser un débat chargé de sens sur la question européenne.
Qu’est-ce qu’un Européen ?
Qui fait partie de l’Europe ? Qui a vocation à faire partie de l’Union européenne ? Ce sont deux questions distinctes. Le Royaume-Uni, par exemple, s’apprête à quitter l’Union européenne – on verra s’il le fait et dans quelles conditions – mais personne n’imagine que le Royaume-Uni cessera d’être un État européen, et même à bien des égards, un État matriciel de l’Europe d’aujourd’hui.
Appartenir à l’Union européenne implique des choix institutionnels de supranationalité et d’organisation des pouvoirs. La question est de savoir si l’on pourrait imaginer que l’Union européenne soit plus large que l’Europe. Nos dirigeants ont apporté à cette question une réponse très ferme, empirique et contestable à Helsinki quand ils ont affirmé que la Turquie, qui est très partiellement européenne, avait vocation à rejoindre l’Union. Les opinions sur ce point ont beaucoup évolué, mais ce décalage estintéressant à observer.
Que signifie appartenir à l’Europe ? Au plan géographique, l’Europe se définit par ses limites au Nord, elle estprotégée par les glaces qui forment une barrière naturelle assez forte. À l’Ouest, elle est protégée par l’océan Atlantique, ce qui n’empêche pas d’avoir fait de la Communauté européenne un sous-ensemble de la communauté atlantique pendant la période de la guerre froide. Au Sud, c’est déjà beaucoup moins clair. La Méditerranée est-elle une frontière ? Sous l’Empire romain, le mare nostrum était davantage une sorte de centre générateur et la civilisation gréco-romaine, puis hellénistique, était répandue tout le long de la Méditerranée. Celle-ci est devenue une frontière progressivement pour des raisons historiques, notamment l’invasion musulmane au Sud. À l’Est, des congrès de géographie nous disent que l’Europe s’arrête au milieu de Kazakhstan, dans le prolongement des monts Oural, là où la rivière Oural sépare le Kazakhstan en deux parties. Au plan politique, comment considérer qu’une partie du Kazakhstan aurait vocation à être européenne et que l’autre partie aurait vocation à être asiatique ? L’Europe est un « petit cap du continent asiatique », comme l’avait définie Paul Valéry, « un isthme de l’Asie » selon Fernand Braudel. La géographie est donc d’une aide incertaine.
La deuxième observation est de nature historique. Au milieu du premier millénaire, un certain nombre de mutations historiques, culturelles et religieuses se produisent, dont on peut considérer qu’elles sont le point de départ de l’Europe. Le point de départ se situe autour de la chute de l’Empire romain, de la révolution augustinienne, de l’effondrement de la religion arienne par rapport au catholicisme trinitaire, suivi assez rapidement de la révolution islamique et de l’invasion musulmane qui conditionnent assez largement cette histoire. On touche là plusieurs éléments féconds.
C’est à ce moment-là que l’ensemble des points centraux du pouvoir politique se déplace du Sud (Rome) vers le Nord, un espace compris entre la Seine et le Rhin, organisé autour des royaumes qui deviendront les royaumes mérovingiens et francs.
Le deuxième élément fondamental est le passage à la domination chrétienne, qui organise nos imaginaires politique et religieux sous une forme qui aboutira, comme l’a montré Jacques Le Goff, à un ordre laïc. Rémi Brague rappelle que les termes de « laïcité » et de « sécularisation » sont des termes d’Église. La vision chrétienne du monde accrédite le partage entre ce que Pascal appellera plus tard les trois ordres : l’ordre des corps (l’ordre du pouvoir physique, donc du pouvoir politique, du contrôle territorial des êtres humains), l’ordre intellectuel (l’ordre de la raison, de l’innovation intellectuelle et scientifique, déterminant la croissance) et l’ordre du cœur (l’ordre de la charité, de la foi, qui se définit indépendamment des deux autres). La distinction de ces trois ordres crée une relation tout à fait originale à l’intérieur de la société. Le monde musulman de l’époque organise également de façon cohérente, mais assez profondément différente, le lien entre la prédication religieuse, l’organisation politique et la conquête militaire.
À cette époque, l’augustinisme, c’est à dire le dogme de la Sainte Trinité, l’emporte sur l’arianisme, qui nie la divinité du fils. Or nier la divinité du fils, c’est soumettre l’homme à Dieu, donc soumettre l’homme au clergé. Tout le pouvoir wisigothique était organisé de cette façon, dans des sociétés d’ailleurs plus développées et raffinées que les sociétés franques. Le dogme trinitaire postule au contraire l’égalité du fils et du père, donc l’égalité de l’homme par rapport à Dieu – une relation d’alliance et d’indépendance réciproque. Celle-ci définit un espace politique dualisé dès le Moyen-Âge. La lutte permanente des pouvoirs et la division de la chrétienté à partir de la Réforme aboutiront finalement à un partage qui donnera l’État laïc qui permet, d’un côté, l’autonomie de l’activité scientifique – donc le développement d’une société de croissance – et de l’autre une religion qui se réfugie progressivement dans le for intérieur et non plus le contrôle, en tant qu’Église, de la Cité.
Le troisième élément fondateur de cette histoire est la pluralité des États. C’est une erreur très profonde que de voir l’Europe comme un empire. Ni Charlemagne, ni Charles Quint, ni Napoléon n’ont régné sur de vrais empires. L’Europe est une pluralité de royaumes qui donnent progressivement naissance à des États indépendants. Cette évolution culmine, au XVIIIesiècle, par des rivalités d’État maitrisées. Pierre Chaunu a montré que la concurrence entre les États a permis le progrès. Or, à partir du XIXeet du XXesiècles, cette concurrence entre les États aboutit à la destruction du système. Là se trouve le nœud de la fatalité européenne. L’apparition d’un État national démocratique et laïc est le véritable marqueur de l’histoire européenne, et en même temps, l’instrument de sa destruction. Comment surmonter cette contradiction ? À partir de 1945, la question que posait Hobbes au XVIIesiècle, comment faire pour que l’homme ne soit pas un loup pour l’homme, se pose enfin pour les États. La solution de Hobbes est le Léviathan – le pouvoir absolu de l’État – que d’autres penseurs comme Locke ou Rousseau s’ingénieront ensuite à apprivoiser. Après la Seconde guerre mondiale, l’idée est la même, transposée des individus aux États : comment rendre l’État, qui fait partie de l’ADN de l’Europe historique, inoffensif ? Comment éviter qu’il ne soit à l’origine d’une destruction pure et simple ?
L’empire romain fonctionnait sur un système prébendier, appuyé d’une part sur l’esclavage d’une sous-humanité exploitée, et d’autre part sur un prélèvement fiscal massif et une redistribution par la cour de Rome de prébendes à l’ensemble de la classe dirigeante romaine. C’est un système hérité en réalité du monde perse, l’aboutissement des conquêtes d’Alexandre. Lorsque l’Empire romain s’effondre, ce n’est pas l’Empire d’Auguste ni la République romaine qui s’effondre mais l’Empire de Caracalla. Les vaincus d’Actium ont pris le pouvoir à Rome à partir du IIIesiècle et installé un pouvoir administratif confiscatoire qui ne suppose aucune relation contractuelle avec les administrés.
L’effondrement de l’Empire romain marque la naissance d’un nouveau système économique, et d’un nouveau système de droit. D’une part, au plan local, la société est désormais fondée sur un contrat entre ceux qui produisent et ceux qui les protègent, les paysans et les seigneurs. L’Église étant le garant du contrat, les seigneurs exercent un prélèvement sur la richesse produite. L’origine de la richesse n’est donc plus le prélèvement impérial mais une relation contractuelle et asymétrique entre un producteur et un protecteur. Le suzerain est supérieur au vassal mais à l’issue de la prestation de serment, il s’agenouille, relève son vassal et l’embrasse.
La relation contractuelle est à l’origine de la relation démocratique. Dans L’Ancien régime et la Révolution, Tocqueville montre bien cette origine aristocratique de la démocratie. Le « gentleman »était au départ un seigneur, pour désigner finalement chacun. Les tribunaux joueront ensuite un rôle essentiel dans la formation et le développement de cette relation politiquement contractuelle[1].
À compter du Ve siècle enfin, on entre dans une ère de progrès économique ininterrompu. Les innovations technologiques qui apparaissent dans le monde mérovingien seront décisives. Les deux que l’on cite ordinairement sont le moulin à eau, et le harnais du cheval, qui permettent des progrès d’abord très lents, parce qu’ils sont contrariés par la rigueur et la violence des temps, puis décisifs dès le Xesiècle. En termes d’urbanisation, de recul des forêts, ou encore de développement des classes intermédiaires, l’Europe de la Chrétienté change complètement de visage entre le Xeet le XIIIesiècle.
Aujourd’hui, être européen, c’est d’abord être fidèle à cette histoire-là, qui nous a donné la démocratie représentative, la laïcité, la croissance, l’économie d’ouverture, tout un ensemble de choses qui nous ont permis d’être une communauté, même si cette civilisation a tout fait, au XXesiècle, pour essayer de se détruire. La question des droits fondamentaux est donc essentielle, or ce trésor est menacé. Il est menacé un peu partout et aujourd’hui à l’intérieur même des frontières de l’Union, dans la Hongrie de Viktor Orban par exemple. Accepter le principe d’une « démocratie illibérale », d’une soumission de la justice, d’un refus du contrôle constitutionnel, d’un refus de la liberté de la presse, d’un refus des franchises universitaires, remet en cause des éléments essentiels du pacte fondateur de l’Europe.
On ne peut dire de quelqu’un qu’il n’est pas européen parce qu’il est musulman, ou parce qu’il est né du mauvais côté de la rivière Oural. En revanche, on est fondé à dire, énergiquement, que l’appartenance à l’Europe – au sens plus large que la seule Union européenne – représente quelque chose de très précis en termes d’organisation de la société. C’est en cela que l’Histoire est féconde pour l’Union européenne d’aujourd’hui. La querelle sur les origines laïques, religieuses ou chrétiennes est absurde. En revanche il existe bien – et c’est ce que dit Le Goff – une civilisation européenne, très originale, qui a contribué au développement de l’ensemble de l’humanité.
Pourquoi s’unir ?
Suffit-il d’être européen pour appartenir à l’Union européenne ? Non. Être européen signifie que l’on est attaché à ces valeurs, aujourd’hui menacées : par l’islamisme, par l’autoritarisme, par une mondialisation qui sépare, en Chine, le capitalisme de la démocratie, par l’enfermement des États-Unis d’Amérique dans une dérive populiste, et par la remise en cause, partout, d’une gestion pluraliste et organisée des relations internationales, fondée sur la sécurité collective et le développement de règles de droit entre les États. L’appartenance à l’Union suppose d’aller au-delà.
Trois périodes caractérisent notre histoire depuis 1950. Tout d’abord une première phase de vulnérabilité où les valeurs de l’Europe sont menacées au-delà d’une frontière bien établie, le rideau de fer. Confrontés à ces menaces précises nous avons créé la Communauté européenne, à ceci près que nous n’étions pas capables, au plan européen, de résister militairement à l’Union soviétique. Nous nous sommes donc interdits d’être une véritable communauté politique et avons cantonné notre action dans la réconciliation des peuples, le développement des libertés de circulation et le règlement de nos conflits intérieurs par des voies juridiques, pacificatrices. La solidarité atlantique et l’Union européenne se développaient de conserve, comme en témoigne le discours de François Mitterrand, en janvier 1983, où il demande l’installation de missiles Pershing en Allemagne pour résister au SS-20 soviétiques. Par cet acte il réaffirme un engagement pro-européen et relance le pacte franco-allemand, d’où sortiront le marché intérieur et l’Euro.
Une seconde période s’ouvre à partir de Maastricht. C’est la paix générale. Une sorte de dissolution se produit. L’Europe se replie sur elle-même et ne se développe pas. Elle perçoit les dividendes de la paix. Bref, elle digère ses succès. En ne donnant pas de prolongement politique à l’adoption de l’Euro et en s’ouvrant d’une façon démesurée, notamment à la Turquie, l’Union crée une situation difficile qui aboutit aux crises en chaine de ce début du troisième millénaire : la crise institutionnelle avec le référendum français, la crise irakienne en 2003 et la crise économique de 2008-2009. L’Europe est désarmée parce qu’elle ne s’est pas donné les moyens d’agir au lendemain de la fin de la Guerre froide.
La troisième période, celle que nous vivons aujourd’hui, est marquée par l’incertitude de nos réactions face à ces menaces extérieures et à ces risques d’autodestruction – qui réapparaissent aujourd’hui, sous les différentes formes évoquées. Il s’agit de savoir si on défend ces valeurs fondamentales, ce trésor européen.
Que fait l’Union européenne ?
La réponse des pro-européens est de dire que nous devons agir ensemble et nous doter pour cela d’un système de décision qui nous permette de fonctionner. Ce système de décision s’appelle l’Union européenne. L’appartenance n’est donc plus l’appartenance à l’Europe mais à un système institutionnel. C’est ce que Habermas appelle le patriotisme institutionnel, qui ressemble à bien des égards au patriotisme américain, très profondément lié au respect de la Constitution et de la loi. Plus ou moins laborieusement, nous avons créé un système qui nous permet de fonctionner, malgré les difficultés que pose la participation de vingt-sept ou vingt-huit États souverains.
Dans un premier temps, jusqu’à Maastricht pratiquement, l’Europe a assumé qu’elle ne faisait pas de politique. Le transfert qui s’était opéré au profit des institutions européennes était donc double. C’est d’abord un transfert un transfert des capitales nationales vers un pouvoir européen, que l’on n’ose pas qualifier de fédéral bien qu’il le soit en réalité, dès le traité de Paris de 1951. Mais c’est également un transfert du pouvoir politique vers un pouvoir en partie technocratique. Le Parlement n’a alors aucun pouvoir législatif réel mais simplement un pouvoir assez théorique de censure sur la Haute Autorité, qui deviendra la Commission.
On associe en revanche les gouvernements, c’est à dire les technocraties nationales. Cet ensemble est donc fondé sur la combinaison d’une technocratie qui catalyse – la Commission de Bruxelles – et des technocraties nationales, associées à l’élaboration d’une règle commune.
Les grandes compétences politiques sont exercées au niveau de l’Alliance atlantique ou demeurent de la compétence des États nationaux. L’Union européenne gère alors des questions techniques : la concurrence – qui a toujours relevé d’une autorité administrative indépendante et à terme d’une Cour de justice – et le commerce extérieur, dans un contexte de consensus très large sur l’abaissement des frontières douanières dans le cadre des négociations successives du GATT. La seule réelle politique menée est la politique agricole commune, à la demande de la France. Celle-ci a toujours été toujours considérée comme une anomalie, une concession faite à la France pour qu’elle renoue avec le projet européen au moment du Traité de Rome, après l’échec de la Communauté européenne de défense.
L’Europe ne dispose pas vraiment de compétences politiques ni d’institutions représentatives. Elle fonctionne dans un cercle de la raison, animé par des Commissaires choisis pour leurs compétences et pour leur indépendance (et qui sont donc le contraire d’hommes politiques).
À partir de Maastricht, au moment de l’effondrement de l’Union soviétique, la question politique est posée, puis écartée à nouveau. Le traité de Maastricht ne permet toujours pas de définir des frontières. Des critères seront définis à Copenhague mais ils restent assez vagues. L’idée prévaut alors que l’élargissement tient lieu de politique extérieure de la Communauté européenne. C’est une promesse d’extension indéfinie.
La deuxième idée qui prévaut à Maastricht est de fonder la politique économique sur la monnaie. En réalité, la politique monétaire est confiée à une banque centrale indépendante, sans politique budgétaire commune. Il s’agit surtout de fixer des règles de droit. Or la politique commence là où s’arrête la règle de droit.
Depuis ce moment, le projet européen est miné par une incertitude sur sa nature profonde. Nous vivons une contradiction entre un principe d’Europe universelle et un principe d’Europe européenne. La première repose sur l’idée qu’il ne sera possible d’échapper à la barbarie de la Seconde guerre mondiale qu’à la condition de retrouver le chemin des valeurs universelles. Un Français et un Allemand se rapprochent d’abord non pas en tant qu’Européens, mais en tant qu’êtres humains. Par une forme de contiguïté conquérante, ce projet aurait vocation à s’étendre au monde entier. La politique européenne consiste à réduire une altérité et non pas à exprimer une identité. En termes de contenu politique, l’objectif n’est pas la puissance, ni la défense d’intérêts particuliers, ou même de valeurs, dans la mesure où elles seraient différentes des valeurs des autres. Il s’agit d’installer un pouvoir kantien, fondé sur la raison, sur l’exemplarité. Cette idée était très présente dans les années 1990, adossée à la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l’Histoire : les valeurs européennes semblent être devenues les valeurs de tout le monde, et l’Europe est chargée de veiller sur l’accroissement des échanges, migratoires, économiques ou politiques jusqu’à engendrer une sorte d’humanité globale, réconciliée, dont l’Union européenne aura été la préfiguration.
À ce moment d’euphorie a succédé la rupture de l’unité du monde : attentats du 11 septembre, apparition du terrorisme islamique global, rejet des valeurs démocratiques et libérales par la Chine, retour d’une politique de puissance russe, de concurrences économiques extrêmement dures, et de relations commerciales qui ne s’apparentent pas au « doux commerce » de Montesquieu mais bien plutôt à la lutte darwinienne pour la survie. Cela conduit à considérer l’Europe comme une puissance politique particulière, avec des frontières et des intérêts à défendre. Nous en sommes à ce moment précis de bascule du projet européen. Si l’Union européenne ne s’est pas effondrée au cours des dix dernières années, c’est parce qu’elle a pris conscience de ces menaces. Et certains pays qui s’opposaient à l’Euro ont découvert que c’était une clé du vivre ensemble européen, comme en atteste la conversion d’Alexis Tsipras, et de tous les partis de droite profonde et de gauche profonde en Autriche, aux Pays-Bas, en Espagne et maintenant en France.
Que prétend défendre un parti d’extrême droite comme le parti de Pim Fortuyn et de Geert Wilders aux Pays-Bas ? Les valeurs européennes ! Il s’attaque aux musulmans en invoquant le droit des femmes, le droit des homosexuels, le droit au blasphème, et donc, la laïcité. Mais il s’estime trahi par l’Europe universelle qui, selon lui, pactise avec les non-Européens. L’Europe ayant été emportée par ce mouvement d’universalisation, on ne lui fait plus confiance pour protéger : ni pour défendre ses frontières, ni pour défendre la réciprocité dans les échanges commerciaux, ni pour répondre aux enjeux démographiques. On ne lui fait pas confiance pour assurer une sécurité intérieure, une sécurité militaire, et dans ce mouvement de défiance on se replie sur des positions préparées à l’avance, c’est-à-dire les positions nationales.
Où en sommes-nous ?
L’Union européenne en est à ce stade, mais personne n’ose penser cette hésitation. Les pro-européens refusent de poser la question des frontières et celle du transfert de compétences parce qu’ils craignent que les compétences nationales soient trop populaires pour être confiées à cet ensemble qui inspire de la méfiance. Ceux qui proposent l’inverse, le repli, tournent le dos aux grandes conquêtes européennes des années 1950. Dans les années 50, à travers la construction européenne, les Européens ont consolidé la démocratie, ils ont développé l’économie, ils se sont ouverts dans une économie ouverte et régulée, ils ont assorti le développement économique d’un développement massif de la protection sociale, et ils ont développé le multilatéralisme dans l’approche et le traitement des problèmes internationaux. Il faut défendre ces acquis, qui bénéficient à tout le monde.
Le deuxième élément à considérer est d’ordre institutionnel. La vérité des élections européennes qui s’annoncent est terrible parce que notre problème fondamental est un problème constituant, le problème que Mirabeau avait soulevé, en 1789, quand il disait que la France était un agrégat de peuples inconstitués et qu’il fallait en faire une nation. Nous sommes, en Europe, un agrégat de peuples inconstitués dont on doit faire non pas une nation mais un ensemble capable de fonctionner et de décider.
La démocratie européenne ne peut pas être de même nature que nos démocraties nationales. Elle repose sur une autre base. C’est une démocratie de négociation et non une démocratie de confrontation. La démocratie n’est pas le pouvoir de la majorité sur la minorité, mais un système qui permet de faire accepter par l’ensemble d’une société des décisions qui ne sont souhaitées que par une partie de celle-ci. Tout le monde ne peut pas être d’accord : il faut donc que certains décident et que d’autres acceptent. Comment y parvenir ? La première variable d’ajustabilité est le degré de cohésion de la communauté politique. En Europe, cette cohésion est faible : rassembler la France n’est pas un défi de même envergure que de rassembler les Suédois et les Portugais. La deuxième variable est le respect de ceux qui pensent autrement. Dans notre système, le symbole de ce respect est la majorité qualifiée. La majorité simple est une majorité qui oppose le Sud au Nord, les pauvres aux riches, l’Est à l’Ouest. C’est une promesse de confrontation, voire de sécession. L’unanimité, quant à elle, garantit que rien ne fonctionnera. Si quelqu’un peut tout bloquer, on n’arrive à rien. La majorité qualifiée est un mouvement vers l’autre : il faut s’impliquer dans le débat, écouter les demandes des autres, en évaluer la sincérité, répondre à leurs intérêts légitimes. Et à l’inverse, pour pouvoir s’opposer, il faut argumenter et convaincre un tiers des États et des populations. Tout le monde est donc contraint : les uns à l’ouverture et les autres à la bonne foi.
Troisièmement, se pose la question des compétences. Il est évident que plus les compétences sont contraignantes, plus elles font l’objet de rejets. Les compétences des États doivent être transférées vers l’Union de façon extrêmement pragmatique et prudente pour éviter les blocages. Prenons l’exemple des impôts. Il ne faut surtout pas demander de décision à la majorité qualifiée en matière d’impôts pour les particuliers. Le rejet serait massif. En revanche, il existe une attente beaucoup plus forte pour une fiscalité commune sur les entreprises. Il serait possible dans ce domaine d’introduire un certain nombre des transferts à la majorité qualifiée, par exemple sur une fourchette minimax pour l’impôt sur les sociétés, une politique de contrôle des rescrits… En restant modérés, on pourrait réaliser de vrais progrès.
La question fondamentale est donc bien la question institutionnelle. Hélas, pour revenir au procès de Rennes du camarade Dreyfus, « la question ne sera pas posée ».
*« L’idée d’Europe » était le thème du séminaire d’initiation à la philosophie politique organisé par l’École nationale de la magistrature entre le 28 janvier et le 1erfévrier 2019, en lien avec l’Institut des hautes études sur la justice et la revue Esprit. Ce texte est adapté d’une conférence prononçée à cette occasion.
[1]Françoise Autrand, notamment, a montré le rôle central du Parlement, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris, 1345 -1454, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981.